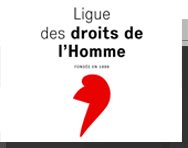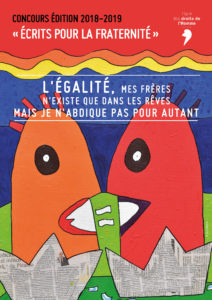Le Groupe EDUCATION aux droits et à la citoyenneté
Journée d’échange et de formation du groupe régional Ile de France
« éducation aux droits de l’Homme et à la citoyenneté »
du 29 septembre 2018
Une quinzaine de personnes participent à cette journée au siège de la LDH.
Robert SIMON, délégué régional Ile de France accueille les ligueurs présents et donne trois informations:
-
la LDH a décidé d’obtenir un agrément d’organisme de formation. Il ne sait pas quelles conséquences cela aura sur notre thématique d’éducation aux droits de l’Homme et à la citoyenneté.
-
Le réseau canopé (réseau de création et d’accompagnement pédagogiques) a des documents sur l’éducation à la citoyenneté:
-
Le comité régional Midi Pyrénées de la LDH a obtenu de la LDH un contrat de jeune en service civique pour participer à l’animation des interventions en milieu scolaire. Il serait bon de savoir comment cela s’organise et quel en est l’impact.
-
Echange d’expérience : Exemples d’interventions en milieu scolaire en Ile de France :
-
La quatrième année au collège Valmy (75010) : Irène Rodgers, coordinatrice de l’action au collège Valmy, rappelle l’historique de cette action expérimentale : 17 intervenants de la LDH vont au cours de cette année scolaire faire une intervention de 2 h chaque trimestre devant toutes les classes (en demi classes) du collège Valmy. Pour les élèves de 3ème ce sera la quatrième année qu’ils auront eu une séance par trimestre avec 2 ligueurs.
L’équipe se pose maintenant la question de l’évaluation. Les élèves, les enseignants qui y ont participé, l’administration du collège se disent satisfaits de l’intervention de la LDH. Comment faire une évaluation quantitative? Qu’est ce que cela a changé pour les enfants? Pour les enseignants? Pour l’administration? Y a t il un impact sur l’institution? Les parents en ont ils eu des échos? Il serait intéressant de contacter l’association de parents d’élèves. Comment engager une réflexion avec les enseignants et l’administration du collège sur les pratiques inconsciemment discriminantes de l’école? Comment travailler avec la commission d’éducation à la santé et à la citoyenneté?
Comment utiliser cette action expérimentale ? Pour la dupliquer il faut des forces militantes que la LDH n’a pas. La section de Fontenay sous bois intervient devant une classe de 4ème mais ne peut pas répondre à la demande d’intervenir devant toutes les classes de 4ème.
La section du 12ème arrondissement est sollicitée par le centre de loisirs d’une école primaire. Elle ne sait pas trop comment répondre. Irène ira avec la section rencontrer les responsables de ce centre de loisirs.
-
-
Concours de plaidoiries à Rosny sous bois (93) : Gilles Brutel présente une vidéo du concours de plaidoiries réalisé en 2017-2018 au lycée de Rosny. Six classes ont participé. Tous les élèves devaient faire une plaidoirie en groupes de 3 maximum. Une finale par classe déterminait qui participerait à la finale pour le lycée. Les plaidoiries devaient durer entre 5 et 8 mn. Gilles présente les critères d’évaluation élaborées pour le jury.
Cinq ligueurs de la section de la LDH ont fait deux interventions devant chaque classe pour présenter la Ligue et le concours. Les lycéens ont une heure par semaine d’octobre à février consacrée à la préparation des plaidoiries. Il serait bon de faire venir des comédiens ou des élèves avocats pour former les lycéens à l’art oratoire. Gilles mentionne le concours Eloquentia organisé par l’unversité Paris 8 Vincennes St Denis depuis 4 ans. https://www.univ-paris8.fr/Eloquentia-Saint-Denis
Pour cette année, 8 classes participeront mais pas de terminale. 15 professeurs sont mobilisés pour encadrer les lycéens.
-
-
Reflexions sur l’utilisation du clip « la licorne » et du clip réalisé à Paris pour les interventions en milieu scolaire (CM2 à 4ème). La petite vidéo réalisée par Denis Mercier, Mes droits, tes droits, nos droits sur financement de la ville de Paris, et présentée par Colette Crémieux, est appréciée de tous comme un bon outil pour les enfants.
Une version pour les cinémas existe. Il est possible de demander à des cinémas de présenter cette version avant la projection d’un film pour enfants. Il y a aussi un guide pédagogique.

La déclaration simplifiée des droits de l’enfant peut être achetée auprès de la boutique de la LDH ; c’est gratuit pour les sections parisiennes car c’est la fédération de Paris qui les a fait imprimer.
-
-
Débat sur la laicité. Colette Crémieux présente des présentations power point que l’on peut utiliser sur le thème de la laicité. Elle invite aussi à regarder dans la base de données documentaire de la LDH sur l’éducation aux droits de l’Homme et à la citoyenneté. Il est possible de L’expérience de Colette sur cette thématique est que les enfants musulmans considèrent que le thème de la laicité est hostile à l’islam; ils soulèvent la question du voile. Betty répond qu’il existe dans le Coran des versets plaidant pour le vivre ensemble.
-
Les écrits de la fraternité 2017 et 2018. Evelyne Clavier présente son expérience d’utilisation du concours « les écrits de la fraternité » dans son dispositif Ulis (Unité localisée pour l’inclusion scolaire) depuis 3 ans. Chacun est invité à proposer ce concours aux enseignants de tous niveaux, y compris dans le champ de l’éducation populaire et des centres de loisirs. Chacun est invité aussi à proposer son appui à l‘équipe qui organise ce concours (contacter communication@ldh-france.org). Certains considèrent qu’il serait bon de donner à l’avance les critères d’évaluation utilisés par le jury.
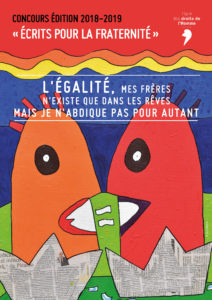
-
Evelyne Clavier souhaiterait que la LDH travaille sur l’éducation inclusive, sur le droit à une pédagogie non discriminante. Beaucoup d’élèves sont en grande souffrance à l’école. Ils ont le sentiment d’être des élèves en trop, des élèves rejetés par le système scolaire. Elle propose de créer un groupe de travail régional pour réfléchir à cette thématique. Quelles propositions faire pour que l’école n’exclue par tant d’enfants? Comment s’inscrire dans la démarche de lutte contre le décrochage scolaire par exemple? Comment pousser l’école à être plus accueillante et accessible tant sur le plan logistique que pédagogique pour les enfants handicapés ou malades? Les personnes intéressées par cette réflexion sont invitées à contacter Evelyne Clavier evelyne.clavier.c@gmail.com ; elle pourra vous transmettre l’enregistrement audio d’une grande conférence sur l’éducation exclusive.
L’école française est entrée dans une phase de transition inclusive dont le cadre a été posé par deux lois : celle du 11 février 2005 qui prône « l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » et celle de la loi de Refondation de l’école du 8 juillet 2013 qui vient à la fois consolider et élargir la première en inscrivant pour la première fois dans le Code de l’éducation le principe d’inclusion et de non discrimination. « Le service public d’éducation (…) doit veiller à l’inclusion de tous les enfants sans distinction ». Les droits des élèves ne deviennent toutefois effectifs que lorsque les lois sont appliquées.
Le groupe de travail régional pourra réfléchir aux moyens d’action à mettre en oeuvre pour réduire l’écart entre les lois et la réalité de terrain. Proposer des formations aux équipes pédagogiques et éducatives via la DASEN et le Rectorat en serait un. Il s’agirait de les construire avec l’idée que l’éducation inclusive participe à démocratisation de l’école et à la réduction des inégalités scolaires et sociales grâce à des pratiques accessibles à chaque élève.
3) Robert Simon évoque les ressources possibles pour les sections de la LDH qui veulent s’investir dans des interventions en milieu scolaires: il existe des outils: réseau canopé, educadroit, la base de données documentaire sur l’éducation aux droits de l’Homme et à la citoyenneté (demander un droit d’accès à cette base de données à la fédération de paris: fedeparis@ldh-france.org ) , et des ressources financières possibles: le fonds d’expérimentation pour la jeunesse, la dilcrah, les aides de la DRJSCS pour la formation des bénévoles (fonds de développement de la vie associative à solliciter en janvier)
Déjeuner
4) Comment utiliser le film sur « l’histoire des immigrations en France » dans les établissements scolaires par Jean Luc Millet, son réalisateur ? Comment susciter des demandes de la part des établissements sur cet aspect de notre histoire qui éclaire des questions actuelles?
Jean Luc Millet nous a présenté le DVD « Histoire des immigrations en France » qu’il a réalisé pour le Réseau Canopé avec la participation du Musée national de l’histoire de l’immigration, et le soutien du Commissariat général à l’égalité des territoires.
Afin de comprendre la place et le rôle de l’immigration dans l’histoire de France, ce double DVD propose deux approches :
-
L’une, historique, avec 10 films correspondant à des périodes clés de 1870 à 2008, commentés par des historiens et des spécialistes reconnus : Marie-Claude Blanc-Chaléard,Denis Peschanski, Gilles Manceron, Serge Slama,Benjamin Stora, Catherine Whitol de Wenden.
-
L’autre, transversale et contemporaine, qui répond à des questions d’actualité : crise des migrants, politique de la ville et immigration, nationalité et citoyenneté, être immigré en France…
Pour la pratique en classe, des séquences pédagogiques construites à partir du DVD sont disponibles gratuitement en ligne. https://www.reseau-canope.fr/histoire-des-immigrations/
Les films sont destinés aux enfants à partir de la 4ème. Il faut en parler aux chefs d’établissements et aux enseignants que nous connaissons. Ils peuvent servir d’appui à des échanges animés par des sections de la LDH.
Lors de la présentation du film sur l’immigration lors de la 1ère guerre mondiale, il mentionne l’existence d’un seul monument aux morts dédiés aux soldats africains morts pendant la première guerre mondiale : ce monument est à Reims mais n’a jamais été inauguré. . On peut également voir le travail d’une classe de troisième sur ce monument sur le site en ligne dédié. https://www.reseau-canope.fr/histoire-des-immigrations/E31
Jean-Luc Millet précise qu’il est toujours d’accord et disponible pour présenter ce double DVD aux sections franciliennes intéressées.
5) Maher Tangour, de SOS homophobie, explique le travail effectué depuis 13 ans par SOS Homophobie dans les établissements scolaires visant à faire reculer l’homophobie.
SOS homophobie compte environ 1300 adhérents dont 450 actifs. Pendant l’année scolaire 2017/18 le nombre d’élèves sensibilisés s’est élevé à 27000 dont 5900 en lle de France dans 26 collèges et 15 lycées; soit 264 classes au total. SOS homophobie a pour objectif d’intervenir auprès de toutes les classes d’un même niveau quand ils sont sollicités par un établissement. SOS homophobie a un agrément national du Ministère de l’Education Nationale qui leur permet d’intervenir à partir de la 4ème. Pour intervenir auprès des 5ème et 6ème il faut un accord spécifique au niveau de l’établissement. La formation des intervenants se compose d’une journée de formation générale, puis plusieurs séances en observation. Si le candidat est validé il bénéficie d’une deuxième journée de formation. Les intervenants sont à 60% des hommes. Ils ont en Ile de France 55 intervenants qui font généralement 1 à 2 journées d’interventions par mois. Ils demandent à ce qu’un adulte de l’établissement soit présent. Les interventions durent 2 heures. Les deux intervenants, toujours en binôme, ne sont pas côte à côte. Les élèves et les intervenants sont assis en cercle.
Les intervenants posent les règles du débat et après une introduction soulèvent des questions touchant aux discriminations : racisme, sexisme, religions (christianophobie, islamophobie, antisémitisme), handicap, … L’objectif est de déconstruire les stéréotypes, en particulier les stéréotypes de genre, qui sont à la base des discriminations.
Le deuxième module explique le sigle LGBT, on parle d’orientation sexuelle construite sur l’attirance, l’amour, la sexualité (on ne mentionne pas la sexualité en 6ème/5ème, de manière générale on ne parle pas de sexualité en détail, ce n’est pas une intervention sur la sexualité). Les intervenants expliquent par des mots simples les notions de trans ou transgenres, en distinguant l’identité de genre de l’orientation sexuelle.
Le troisième module soulève la question des actes et propos homophobes, leur manifestation, leurs conséquences, les solutions; ce que dit la loi.
Pour favoriser l’émergence des questions, il y a une séance des petits papiers où les élèves posent des questions de manière anonyme. Cette séance a pour but de créer le débat entre les élèves afin de déconstruire les stéréotypes et de faire réfléchir aux concepts fondamentaux de consentement, de respect, d’égalité, …. Les intervenants utilisent le jeu d’accord/ pas d’accord où chacun se déplace pour se positionner par rapport à une phrase énoncée illustrant un préjugé. Ils utilisent aussi des exercices de mise ne situation en interrogeant les élèves: tu fais quoi si…?
Sur les questions touchant aux religions, ils répondent que ce n’est pas le lieu de débattre du contenu des textes religieux. Ils mentionnent néanmoins l’existence d’interprétations diverses et de personnes qui souhaitent vire pleinement leur foi et leur orientation sexuelle et qui se sont organisées en associations.
Puis ils donnent un questionnaire d’évaluation aux enfants.
Robert Simon invite les sections qui font des interventions en milieu scolaire à proposer aux collèges et lycées où elles interviennent de proposer à ces établissements des interventions de SOS Homophobie en complément des interventions de la LDH car dans tous les établissements il y a des enfants qui se découvrent ou vont se découvrir Lesbienne, gay, bi ou trans. Les statistiques disent entre 5 et 10%. Pour ces enfants et pour leur entourage scolaire, il est important de voir que le collège ou le lycée les inclut et qu’en cas de discrimination ou de harcèlement la loi les protège.
-
Le questionnaire de SOS Homophobie à l’intention des élèves
_________________________________________________________________________________
L’histoire de l’immigration n’est pas seulement l’histoire des immigrés. C’est aussi l’histoire de la société française toute entière : celle d’où l’on part, faite d’exil et d’émigration, celle où l’on arrive faite d’accueil et d’hospitalité. C’est donc l’histoire des interactions constantes entre les immigrés et la société d’immigration.
Le double DVD « Histoire des immigrations en France », réalisé en partenariat avec le Musée de l’Histoire de l’Immigration (MNHI) et le soutien du CGET, en étroite collaboration avec le département éducatif du MNHI, met à disposition de la communauté éducative un ensemble de ressources (interviews d’historiens et de spécialistes reconnus, témoignages, documents etc.) permettant de mieux comprendre la contribution de l’immigration à l’histoire de France tout au long du XXe siècle.
Introduction de Benjamin Stora : Pourquoi enseigner l’Histoire des immigrations ? Durée :5mn 8s
Dix périodes historiques de 1870 à 2000.
L’approche historique de l’immigration en France de 1870 à 1984 est abordé en dix grandes périodes, à partir de documents d’archives des fonds du musée de la Résistance nationale , de l’INA, de Pathé-Gaumont, de l’ECPAD, de « Génériques » et de films d’archives du CNDP. Ces archives seront commentées et analysés par quatre historiens, Marie-Claude Blanc-Chaléard, Catherine Wihtol de Wende, Gilles Manceron et Denis Peschanski.
Période 1 : 1870-1914. La France, terre d’asile et d’immigrations ? Durée : 18mn 5s
Période 2 : 1914-1918. Une première forme de mondialisation. Durée : 21mn 42s
Période 3 : 1919-1932. L’ouverture de la France à l’Europe et au Monde. Durée : 15mn 30 s
Période 4 : 1932-1939. Le tournant des années trente. Durée : 13mn 30s
Période 5 : 1939-1945. Le temps de tous les dangers et de tous les engagements. Durée :21mn 15s
Période 6 : 1945-1974. Les trente glorieuses. Durée :21 mn 55s
Période 7 : 1974-1981. La fin de l’immigration de travail. Durée : 20 mn 40 s
Période 8 : 1981-1986. Les temps difficiles de l’intégration. Durée : 25 mn 7s
Période 9 : 1984-1998. A la recherche d’une politique de l’immigration. Durée : 18 mn 20s
Période 10 : 1998- 2008. Entre intégration inaboutie et mobilités mondialisées. Durée : 16mn 52 s
Contenus du DVD 2
Exposition Frontières au MHI. La mondialisation accélère-t-elle les migrations ?
Visite de l’exposition Frontières, présentée au MHI en 2015 et 2016, avec les commentaires des deux commissaires de l’exposition : Catherine Wihtol de Wenden, directrice de recherche du CNRS au Centre d’études et de recherches internationales (Ceri) et Yvan Gastaut, historien de l’époque contemporaine à l’université de Nice Sophia Antipolis.
Dans cette exposition un parcours thématique évoque l’évolution des frontières et de leur contrôle et le rapport qu’entretiennent les migrants avec ces frontières. Durée :35 mn 53 s
L’apport du témoignage dans l’Histoire des immigrations avec un focus sur la galerie des Dons du MHI.
Présentation par Aude Lux de la Galerie de dons du Musée de l’histoire de l’immigration et de l’apport du témoignage. La Galerie des dons met au centre du propos l’histoire familiale et illustre la force du récit.
Durée :10 mn 4s
4 témoignages qui montrent la diversité des parcours migratoires.
Félicia Novacovici. Née en 1977 à Caransebes, en Roumanie, Irina est arrivée en France clandestinement en 2000. Durée : 12mn 35s
Frida Rochocz. Née en Argentine en 1959. Ses parents, un immigré juif allemand et une immigrée espagnole, se sont rencontrés à Buenos Aires, dans un contexte politique et économique qui commençait à se durcir au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Durée : 12 mn 30 s
Natrajan Soundirrasane. Né dans un comptoir français en 1950.« Pour me présenter, je dis souvent : « Je suis né en 50, je fais 50 kilos et un mètre 50. » Comme j’ai la nationalité française, j’ai eu la chance de venir en France pour faire un diplôme de tournage et mécanique. Au début, je voulais retourner, je pensais rester un peu seulement. Quand je suis en France, l’Inde me manque et quand je suis en Inde, la France me manque. » Durée : 10 mn 11s
Jacques Bédrossian qui parle du parcours de ses parents arméniens. Durée : 12mn 5s
-
Réflexions sur la question de la nationalité et la citoyenneté française.
Serge Slama, maître de conférences en droit public, à l’Université Paris Ouest-Nanterre détaille les évolutions du statut juridique des étrangers depuis la révolution française et les étapes à franchir pour l’acquisition de la nationalité française. Il aborde également suite à la crise des réfugiés depuis 2015, la liberté de circulation dans l’espace européen. Durée : 31mn6s.
Histoire de banlieues et de quartiers
Ce film reflète à la fois l’histoire de l’immigration dans les banlieues et les quartiers (naissance d’actions collectives, marche pour l’égalité, représentations et catégorisations des publics, mise en place de la politique de la ville etc…), mais aussi le parcours des générations qui se sont succédées dans les quartiers depuis les années 60.
Durée : 30 mn.
Ecrit par rozenn, le 22 octobre 2018