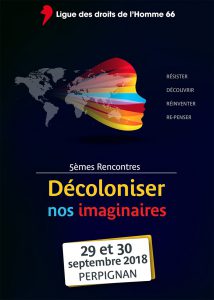Quelles réflexions inspirent le film J’accuse de Polanski, si on se limite à parler du film lui-même ? Si on laisse de côté la question des raisons du cinéaste d’aborder le sujet de l’affaire Dreyfus à ce moment de sa vie et de sa carrière, de savoir si elles relèvent ou non d’une volonté d’assimiler les accusations dont il est l’objet dans sa vie personnelle aux persécutions qui ont frappé Dreyfus[1]. Indépendamment de ces interrogations, nous sommes confrontés à une œuvre cinématographique qui doit pouvoir être jugée en tant que telle.
Étant entendu, par ailleurs, que l’évocation par la presse des abus sexuels dont l’homme est accusé d’avoir été l’auteur est parfaitement légitime et les réactions qui ont lieu à ce sujet à l’occasion de la sortie du film doivent pouvoir se développer librement dans le cadre de la liberté d’expression et de manifestation. Mais, comme l’a affirmé clairement l’Observatoire de la liberté de création, cela n’autorise personne à s’opposer à la diffusion d’une œuvre en empêchant le public d’y accéder et de la juger en toute liberté.
Le film est une fiction, en décalage avec l’histoire
En ne prenant en considération que le film, force est de constater que c’est à tort que le réalisateur affirme, comme il l’a fait, par exemple, lors de l’avant-première qui a eu lieu le lundi 11 novembre au cinéma Publicis des Champs-Elysées, que « tout est vrai dans ce film ». C’est une œuvre de fiction, inspirée d’un roman, et non un documentaire historique. Il ne dit pas l’histoire, il la transforme librement. Le scénario a été écrit à partir du roman de Robert Harris, reporter et réalisateur à la BBC puis auteur de « thrillers historiques », à qui, a-t-il écrit, Roman Polanski avait suggéré au début de 2012 d’aborder ce thème dans son prochain livre. D’abord publié en anglais en 2013 sous le titre, An Officer and a Spy, sa traduction française est parue chez Plon en 2014 dans la catégorie « Roman », sous le titre de D., puis en 2019 en collection de poche, avec l’affiche du film en couverture, sous le même titre que le film de Polanski, J’accuse. Son auteur a reconnu lui-même avoir « adapté les faits », expliquant qu’« un romancier peut imaginer les choses autrement » : « Je suis seul responsable de toutes les erreurs qui demeurent, factuelles ou stylistiques, ainsi que des tours de passe-passe dans la narration et la caractérisation des personnages nécessaires au passage des faits à la fiction ». On lui en donne acte aisément. Son choix a été d’écrire un récit dont le narrateur est un personnage, le colonel Picquart, pour lequel il a inventé un rôle que le réel Picquart n’a pas joué. C’est son droit comme romancier. Mais ce qui n’est pas admissible, c’est que le cinéaste présente son film comme fidèle à l’histoire, alors qu’il accentue encore le caractère fictionnel du roman en se concentrant encore plus sur ce personnage, et en écartant encore davantage que le livre ceux qui ont joué un rôle décisif dans l’Affaire, c’est-à-dire les dreyfusards.
Ainsi, le film ne fait aucune mention de personnalités, pourtant nommées dans le livre, dont le rôle a été essentiel, comme le publiciste anarchiste Bernard Lazare, le leader socialiste Jean Jaurès, ou le juriste Ludovic Trarieux, premier président de la Ligue des droits de l’Homme. Où d’autres fondateurs de cette association comme Séverine, Octave Mirbeau, Gabriel Monod ou Victor Basch, qui ont pris part à la grande bataille dreyfusarde lors du procès Zola puis du procès de révision de 1899 à Rennes. Le personnage qui occupe toute la place dans le film est un officier, un personnage de colonel Picquart à qui est attribué un rôle différent de celui qu’a joué son homonyme dans la réalité.
Dans son livre, Le faux ami du capitaine Dreyfus. Picquart, l’Affaire et ses mythes (Grasset, 2019), l’historien Philippe Oriol cite un mémoire inédit envoyé par Picquart à son avocat, Fernand Labori, à l’été 1898, soit six mois après la publication du « J’accuse ! » de Zola, qui parle des « manœuvres des juifs », en particulier de la famille Dreyfus, qu’il fait surveiller et dont il intercepte la correspondance. Il est vrai qu’en 1897, quand il a découvert qu’Esterhazy était probablement l’auteur des faits d’espionnage pour lesquels Dreyfus avait été condamné, il a rendu visite à l’avocat Louis Leblois, un ancien camarade du lycée de Strasbourg, et lui a confié des papiers indispensables pour sa défense, montrant que son enquête sur Esterhazy avait été faite avec l’accord de ses supérieurs et ne pouvait pas lui être reprochée. Il lui a fait savoir qu’il avait décidé de poursuivre son travail dans l’armée avec discipline sans s’occuper de l’affaire Dreyfus et lui a interdit de communiquer ces documents à la famille Dreyfus et à ceux qui l’aidaient à établir la vérité, bien qu’ils démontraient que l’état-major voulait étouffer l’affaire et qu’ils les auraient considérablement aidés. Ce à quoi Leblois, tenu au secret professionnel, a d’abord obéi, au désespoir de ses amis dreyfusards qui le suppliaient de leur en donner copie pour obtenir le retour de Dreyfus et la révision. Malgré ses demandes à Picquart de lever cet interdit, ce dernier a tenu bon et a mis fin alors à leur correspondance, la seule lettre que Leblois lui enverra par la suite, il la jettera au feu sans même l’ouvrir. Le vrai dreyfusard que fut Bernard Lazare dira que Picquart ne s’est préoccupé que de sa situation personnelle, qu’il « n’a pas marché pour le droit », il était le « type de militaire qui ne sait plus rien accomplir en dehors de sa règle et de sa discipline. Il est dans la vie et l’action, comme un infirme privé de ses béquilles habituelles ». Le film fantasme quand il montre un Picquart dreyfusard, qui suggère — invraisemblance totale ! — à Zola d’écrire son article « J’accuse ! ». Dans la réalité, c’est Bernard Lazare, quant à lui dreyfusard de la première heure, qui a partagé ce projet avec Zola et lui a suggéré la litanie des accusations finales qui donnera son titre à l’article.
Il est vrai que Picquart a témoigné au procès intenté à Zola, mais il s’est tenu à l’écart des témoins dreyfusards comme Jaurès, Ranc, Séailles, Anatole France, Duclaux, Quillard ou Guyot. Ou de Trarieux, qui, lors d’une suspension d’audience après l’évocation du « faux Henry », a invité dans la salle des témoins quelques uns d’entre eux à se retrouver à son domicile, le dimanche 20 février, veille du réquisitoire de l’avocat général et des plaidoiries des avocats, pour fonder, selon le mot d’Ernest Psichari, qui hébergeait alors Zola et qui deviendra le premier secrétaire général de l’association en vue, « de former un groupe ou une association, de fonder une ligue — le mot ne se précisait peut-être pas encore dans sa pensée — quelque chose qui serait la sauvegarde des droits individuels, la liberté des citoyens et leur égalité devant la loi ». C’est l’origine de la LDH. Picquart, au contraire, est resté silencieux lors du procès sur les preuves qu’il détenait de l’innocence de Dreyfus, se limitant au cadre précis que les autorités politiques et militaires lui avaient fixé. Ce qui n’empêche pas qu’il a été ensuite sanctionné par l’armée, mis en réforme et emprisonné « pour fautes graves dans le service ». Mais c’est Jaurès qui publiera Les Preuves, un livre qui sera ensuite la grande référence de Pierre Vidal-Naquet lors de sa publication, en 1958, de L’Affaire Audin, ouvrage emblématique de la pérennité de l’engagement dreyfusard contre les mensonges de l’armée et de l’Etat. Or, dans ce film qui prétend être une évocation historique de l’affaire Dreyfus, Jaurès est le grand absent.
Ensuite, il est vrai aussi que, libéré, Picquart était à Rennes lors du procès en révision de juillet 1899, mais en se tenant, là encore, à l’écart des dreyfusards dont le quartier général était la maison de Victor Basch, un jeune universitaire juif germanophone né en Autriche-Hongrie et récemment naturalisé, président de la section locale de la LDH, où Picquart ne voulu pas résider, comme le faisaient Jaurès et d’autres dreyfusards ; c’est pourtant là, au Gros-Chêne, que Labori, après l’attentat qu’il a subi, passa ses huit jours de convalescence avant de reprendre sa place au procès. Et, quand Dreyfus a accepté la grâce présidentielle qui lui rendait la liberté, Picquart a eu pour lui des mots insultants, l’accusant de se satisfaire d’avoir « la peau sauve » et d’abandonner « pour des raisons pécuniaires » la cause de sa réhabilitation. Preuve de ce qu’il restait, malgré son rôle dans l’Affaire, profondément imprégné de préjugés antisémites. Non pas d’un antisémitisme forcené à la Drumont, mais d’un antisémitisme insidieux, d’une judéophobie tenace et diffuse qui est probablement encore plus redoutable.
Le film invente une amitié étroite entre Picquart et l’avocat Louis Leblois. Ils s’étaient connus comme lycéens à Strasbourg, puis l’un était devenu avocat et l’autre officier. C’est à lui que Picquart, en juin 1897, lorsqu’il s’est senti menacé en raison de son enquête sur le véritable traitre, Esterhazy, a confié des papiers en lui faisant promettre de ne rien révéler de leur contenu à ceux qui défendaient l’innocence de Dreyfus, sauf si lui-même venait à disparaître. Leblois, dreyfusard lui-même, en a parlé à ses amis qui l’ont supplié de leur en montrer le contenu, et il finit par rompre sa promesse à Picquart, et, au prix d’une violation du secret professionnel, leur communiqua les documents[2]. Ce dreyfusard engagé, avec qui Picquart se brouilla avant la publication de l’article « J’accuse ! » de Zola, devint en 1900 l’un des conseillers juridiques de la LDH dont il avait été l’un des fondateurs et il remplacera en 1903 Lucien Herr à son comité central. De retour en Alsace en 1918, il présida sa section de Strasbourg et travaillera à un livre sur l’Affaire qui paraitra au lendemain de sa mort en 1928. Une trajectoire bien différente de celle de Picquart, qui, devenu général puis ministre de la Guerre en 1907, sera, par exemple, attaqué violemment à la Chambre par Jaurès qui dénonçait le massacre délibéré de toute la population d’un village, quelque 150 personnes, y compris femmes et enfants, lors de la conquête du Maroc, massacre que Jaurès qualifiait d’« attentat contre l’humanité », pour avoir dissimulé un témoignage sur ce crime, reproduisant les pratiques de l’état-major lors de l’Affaire : « Voilà où en est celui qui fut le colonel Picquart », dit-il en avril 1908[3].
A quoi conduisent les inventions du film ?
En inventant ainsi un personnage nommé Picquart, qui serait, comme l’écrit l’éditeur de la traduction française du roman, celui qui, « contre les préjugés, contre l’Armée, contre un pays tout entier », aurait « fait surgir l’indicible vérité », le film construit une fiction. Il donne le beau rôle à un officier d’une armée qui avait pourtant de lourdes responsabilités dans l’affaire et qui est restée largement, pendant un siècle, dans le déni de l’injustice qu’elle avait commise. Il invente une belle histoire d’amitié entre un officier supérieur et un avocat dreyfusard, qui enjolive cet épisode de l’histoire. Et cette polarisation du film sur un tel personnage fictif, dont le rôle est enjolivé, est grave, puisqu’il s’agit de l’image donnée à nos concitoyens d’un épisode fondateur de notre République. Cela conduit à l’occultation de l’action des vrais dreyfusards qui, en réagissant à l’injustice commise, ont inauguré un engagement universaliste pour les droits de tous les hommes, dont on peut constater qu’il reste en 2019 une aspiration durable dans notre société, y compris lorsqu’il faut s’opposer à des décisions injustes des institutions de la République. Ce moment fondateur ne peut être réduit à des histoires d’espions, d’indics et d’experts en analyses graphologiques, qui font certes le charme d’un roman, ou à des conflits de personnes dans le milieu étroit des officiers de l’armée d’alors. L’« insurrection des consciences » qui a été celle des dreyfusards s’opposait à des forces politiques et idéologiques conservatrices qui avaient largement partie liée avec l’Eglise catholique d’alors, profondément antirépublicaine et imprégnée d’antisémitisme. Leur engagement a constitué un approfondissement de la notion de droits de l’homme formulée pendant la Révolution française et à laquelle les dreyfusards se référaient fortement. Ils y ont intégré la nécessité de refuser les discriminations raciales au même titre que toutes les injustices. On a affaire à un tournant important dans l’histoire contemporaine de la France. L’image qu’en donne un film qui lui est consacré n’est pas indifférente.
A partir de cet événement, la problématique de la défense des droits de l’homme a été affirmée dans la société française. Y compris en prenant en compte les droits sociaux. L’universitaire Victor Basch a écrit, par exemple : « Toujours je me souviendrai du soir où, le cœur un peu battant, je m’en allais vers la Bourse du travail de Rennes demander aux chefs ouvriers de nous venir en aide. Toujours je me souviendrai de l’accueil qu’ils me firent et du magnifique dévouement qu’ils déployèrent : durant trois semaines, ils vinrent nous chercher, Jaurès, Labori et moi, deux fois par jour, pour nous reconduire du Conseil de guerre au Gros-Chêne, dernière maison de la ville à l’orée de la banlieue, où j’habitais. C’est grâce au concours du peuple que nous fûmes victorieux. » Et la plupart des dreyfusards ont pris en compte dans leur combat pour les droits de l’homme les aspirations à la justice émanant des travailleurs qui demandaient la reconnaissance de leurs droits sociaux. En 1910, les dreyfusards se sont mobilisés pour défendre le « Dreyfus ouvrier », Jules Durand, charbonnier du Havre, fondateur d’un syndicat, qui avait été victime à son tour d’une machination judiciaire. On retrouve dans les pétitions en sa faveur les noms du président d’alors de la LDH, Francis de Pressensé, et aussi de Pierre Quillard, Anatole France, Emile Durkheim, Victor Basch, Lucien Herr et bien d’autres. Alfred Dreyfus lui-même s’est joint aux protestataires. Mais inutile de dire qu’on y chercherait en vain celui du général Georges Picard devenu ministre, acquis à une République pour qui les droits de l’homme ne s’étendent, dans les faits, ni aux ouvriers ni aux indigènes des colonies. Comme l’a écrit Jaurès, qui s’est aussitôt engagé pour ce « Dreyfus ouvrier », il est un combat plus dur encore à mener que celui contre « la raison d’Etat militariste » : c’est celui contre « la raison d’Etat capitaliste ».
Faut-il voir ce film, faut-il encourager le public à le voir ?
Chacun est libre de voir ce film qui, il est vrai, a d’indéniables qualités cinématographiques. Les décors et les images sont belles — malgré une utilisation de l’infographie parfois discernable —, les dialogues, ciselés et tranchants, tirent le meilleur parti du roman de Robert Harris, les personnages sont incarnés par des comédiens de valeur, à commencer par Jean Dujardin dans le rôle du colonel Picquart. Roman Polanski a apporté dans ce film une nouvelle preuve de son talent de cinéaste. Et son film a quoi qu’il en soit le mérite de transmettre quelques idées fortes sur l’affaire Dreyfus, sur la présence importante de l’antisémitisme autour de 1900 dans la société française et les résistances qui, grâce à Zola et à d’autres, lui ont été opposées. Les spectateurs peuvent en déduire aussi que l’affrontement est parfois nécessaire avec les institutions de la République quand leurs actes sont liberticides, qu’il peut être indispensable de les dénoncer, et que les combattre est parfois le meilleur moyen de les améliorer et de préparer l’avenir. Leçon utile en 2019 où nombre de politiques publiques suscitent l’indignation.
Faut-il encourager le public à le voir ? Ses défauts évoqués ci-dessus incitent cependant à en douter. Le projeter devant un public scolaire ou dans le cadre d’un ciné-débat implique de faire la critique historique sérieuse des trouvailles de son scénario. Or, tous les textes et tous les mots qui pourront l’entourer auront moins de poids que ce film habilement réalisé par un grand cinéaste, même si ses inventions fictionnelles risquent de renforcer des ignorances et des idées fausses. A chacun de choisir.
[1] Comme semble l’indiquer, dans le dossier de presse diffusé lors de la présentation du film à la Mostra de Venise, cet échange entre Pascal Bruckner et Roman Polanski : à la question « En tant que juif pourchassé pendant la guerre, que cinéaste persécuté par les staliniens en Pologne, survivrez-vous au maccarthysme néoféministe d’aujourd’hui ? », il a répondu : « Il y a des moments de l’histoire que j’ai vécus moi-même, j’ai subi la même détermination à dénigrer mes actions et à me condamner pour des choses que je n’ai pas faites. »
[2] Gilles Manceron, Emmanuel Naquet et Philippe Oriol, « Louis Leblois, l’avocat qui joua davantage qu’un second rôle », in Gilles Manceron et Emmanuel Naquet, Être dreyfusard hier et aujourd’hui, PUR, 2009.
[3] Jean Jaurès, Vers l’anticolonialisme. Du colonialisme à l’universalisme. Textes réunis par Gilles Manceron, Les Petits matins, 2015.