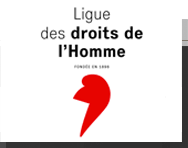François Hollande, un président qui rétrécit
Mediapart.fr
Son allocution au lendemain des européennes en est une nouvelle illustration. La chronique du hollandisme se donne à lire comme une suite incohérente de contre-performances, une succession de couacs, de tête-à-queue idéologiques, de télescopages entre la vie privée et la vie publique, de trahisons et de scandales d’État. Ce n’est pas seulement à la chute de la maison Hollande que nous assistons mais aux derniers jours de la Ve République.
Pendant sa campagne de 2011-2012, François Hollande avait beaucoup maigri. Depuis deux ans, c’est un président qui rétrécit. Il rétrécit la politique. Il rétrécit la gauche. Il rétrécit la France. Jusque-là, les sondages en donnaient une vague idée ; les élections municipales et européennes viennent d’en montrer l’étendue. La politique est discréditée, la gauche, divisée comme jamais, la France désorientée.
En deux ans, l’homme maigre de 2012 a repris du poids. Il craque à nouveau dans ses coutures. C’est sa stature présidentielle qui ne cesse de s’effilocher. Le candidat « allégé » des primaires est devenu un président plombé par l’impopularité. Il avait fait de sa diète spectaculaire une preuve de sa volonté d’être candidat. Sa chute dans les sondages compromet chaque jour davantage sa capacité à se représenter.
Il a déçu ses soutiens et conforté ceux qui le combattaient. Il a trahi ceux qui l’ont élu et mobilisé ses opposants. Il a dispersé la gauche (« les sept gauches » devrait-on dire), et favorisé une recomposition inédite de la droite (« la droite pour tous »). L’abstention atteint des sommets. La gauche est à son plus bas niveau historique sous la Ve République. La France, en proie à ses vieux démons, s’enfonce dans la régression.
On peut invoquer toutes sortes de raisons pour expliquer cette situation, la principale étant l’orientation politique suivie par le gouvernement contrairement aux engagements pris pendant la campagne, au contrat noué avec les Français au moment de l’élection. De ce point de vue, la déception des électeurs socialistes est à la mesure des réformes ajournées : réforme du traité européen de stabilité budgétaire, taxe à 75 % des hauts revenus, réforme bancaire, réforme fiscale transformée en pause fiscale, droit de vote des étrangers, récépissés pour les contrôles policiers… Des batailles perdues parfois sans combat et parfois sans ennemis déclarés ou face à des ennemis imaginaires, des fantômes d’ennemis, fabriqués et agités par les médias.
Le discrédit qui frappe François Hollande à mi-mandat ne se résume pas à une liste de promesses non tenues, ni même à l’absence de résultats économiques en matière de croissance, de chômage. L’écart entre les discours de la campagne et l’orientation politique n’est devenu explicite qu’au début de l’année 2014, avec l’annonce du pacte de responsabilité. Son discrédit est bien plus ancien ; il date des premiers mois de son mandat.
Dès l’automne 2012, la presse n’a pas eu de mots assez durs pour dénoncer l’amateurisme de l’exécutif, le défaut de communication ou de cap, bref l’absence d’un récit structurant qui serait le péché originel du hollandisme. C’est en effet l’illusion fréquente des communicants, qui appliquent à la vie politique les recettes du marketing. L’identification avec un président de la République n’est pas simple « connexion » avec une marque. C’est un enjeu symbolique complexe, qui dépend du succès ou de l’échec d’une série de performances : la cohérence du récit politique, le système de métaphores utilisé, le contrôle de la réception et de la diffusion de ce récit sur les réseaux sociaux. C’est une bataille qui oppose des forces sociales, des institutions, des narrateurs sur une scène – la médiasphère – où chacun intervient, usant d’un langage de persuasion.
Le modèle est ici moins le feuilleton ou la série TV que le jeu vidéo avec ses « plateaux ». L’acteur politique traverse une série d’épreuves ou de tests au cours desquels il perd des points « de vie » ou de popularité dans les sondages. Il dispose pour cela d’un crédit, c’est-à-dire d’un capital initial de sympathie qui va diminuer pendant l’exercice du pouvoir, mais qui ne doit jamais s’épuiser complètement.
Ce champ de bataille est autant une affaire de conviction et de courage que de communication, c’est une arène politique, un champ de bataille idéologique et culturel. C’est le dissensus au cœur de la démocratie. Quand la trahison gagne les états-majors, que les troupes désertent et que le défaitisme s’empare des populations, les fins se perdent, la démocratie dégénère en manœuvres, en intrigues, en complots. Le récent remaniement en fut l’épilogue navrant. Il est le résultat d’une série de batailles symboliques perdues, au cours desquelles le président est apparu de moins en moins « en contrôle », au point de se voir imposer le choix de son premier ministre.
Plutôt que des séquences qui se suivent et s’enchaînent de manière linéaire, la chronique du hollandisme se donne à lire comme une suite incohérente de contre-performances, une succession de couacs, de décisions sans lendemain, de tête-à-queue idéologiques, de télescopages entre la vie privée et la vie publique, de trahisons et de scandales d’État, comme la ténébreuse affaire Cahuzac qui condense tous les éléments d’une crise générale de crédibilité de la parole publique. Ainsi peut-on décrire le demi-mandat de François Hollande comme une série de coups performatifs ratés qui sont comme les étapes successives de son discrédit.
1. L ‘épreuve des mots
Le premier plateau que doit traverser l’acteur politique, c’est le champ lexical. Un véritable champ de bataille, qui a pour enjeu le contrôle des mots. Si vous cédez sur les mots, disait Freud, vous cédez sur les choses. Si vous voulez changer les choses, il faut savoir changer les mots. Face au cryptage néolibéral des enjeux de la crise, forger une nouvelle « lingua franca » politique n’est pas chose aisée. Les éléments de langage n’y suffisent pas.
Dès les premiers mois de son mandat, François Hollande s’est fondu dans un univers lexical de droite (« coût du travail », « compétitivité », « charges sociales », attractivité des investissements étrangers), un ralliement que le ministre de l’économie, Pierre Moscovici, qualifia de « révolution copernicienne ». À l’automne 2013, l’introduction dans le débat public de l’expression « pause fiscale » rendit évidente l’influence des thèses néolibérales sur le gouvernement. C’est une version française du fameux « tax relief » (« soulagement d’impôt ») des républicains après l’élection de George Bush. En « soulageant » la nation des impôts, la fiscalité était identifiée à un fléau ou à une maladie et le président Bush à un médecin capable de soulager la nation de ses maux.
En parlant de pause fiscale, le gouvernement accréditait l’idée d’une pression excessive de l’impôt et lui donnait une connotation négative au lieu d’insister sur sa signification redistributive.
Pris dans des filets rhétoriques tissés depuis trente ans par la révolution néolibérale, le gouvernement s’est trouvé dans la situation de ces élites colonisées contraintes de traduire leur expérience dans la langue du colonisateur, une forme d’acculturation néolibérale. Cette acculturation s’est manifestée tout au long du mandat, elle s’est aggravée d’une conférence de presse à l’autre, jusqu’à accréditer un tournant social-démocrate qui n’était qu’une reddition néolibérale qualifiée de « pacte de responsabilité ».
2. La guerre des récits
Dès l’automne 2012, ceux qui reprochaient à Nicolas Sarkozy son storytelling permanent ont pris pour cible l’incapacité de François Hollande à raconter une histoire, l’absence d’un récit cohérent. En vérité, si le cap politique choisi par le président manquait de lisibilité, ce n’était pas faute d’un récit cohérent mais par excès de récits contradictoires.
Un simple examen des discours et des déclarations du gouvernement au cours des six premiers mois du mandat de François Hollande fait apparaître au moins deux lignes narratives, déclinées en plusieurs variantes selon les auditoires et les circonstances. Le premier de ces récits – l’appel au « patriotisme économique » – est un récit de guerre qui s’inscrit dans un champ lexical cohérent : « bataille », « front », « bras armé », « puissance ». Le deuxième de ces récits, c’est « l’épopée des inventeurs », qui évoque un nouvel âge industriel dont les héros seraient les ingénieurs, les techniciens, les créateurs.
La geste guerrière constitue ce qu’on pourrait appeler le moment « Iliade » de l’épopée du changement. Il permet d’afficher la détermination de l’État, de mobiliser l’opinion en désignant un ennemi, de réveiller et de stimuler l’orgueil national. L’« épopée des inventeurs », c’est le moment « Odyssée » du changement. Il exalte le génie français et les grandes aventures industrielles du passé (Ariane, Airbus et le TGV). Il met en scène l’ingénieux Gallois, Ulysse moderne aux mille expédients, capable d’affronter tout à la fois la baisse de compétitivité, la désindustrialisation et la concurrence déloyale des Chinois et des Coréens.
Tout oppose bien sûr la geste guerrière, d’inspiration néolibérale, et l’épopée de l’ingéniosité, dans sa version néorooseveltienne. Mais il y a d’autres versions de chacun de ces récits, ce qui multiplie les combinaisons et les contradictions possibles. La notion de « patriotisme économique » est à l’origine un thème de droite d’inspiration néolibérale. Mais elle existe aussi en version néokeynésienne, celle d’Arnaud Montebourg par exemple, qui cite souvent « La fin du laisser-faire » de Keynes à l’appui de ses thèses protectionnistes. Quant à l’épopée des inventeurs, elle se décline elle aussi en deux variantes. L’une, néolibérale, exalte le rôle de l’entrepreneur privé en butte aux interventions tatillonnes de l’État ; l’autre, néorooseveltienne, défend le rôle de l’État dans le redressement productif et inspire un colbertisme new look, participatif, voire coopératif.
Faute de choisir entre ces différentes lignes narratives, le gouvernement a multiplié les lapsus, les couacs et les équivoques. On ne peut être à la fois Achille et Ulysse, a fortiori Reagan et Roosevelt. Or ces deux postures cohabitent dans le discours des ministres, et même chez le seul ministre du redressement productif. Parfois c’est l’une qui prend l’ascendant sur l’autre. Depuis le remaniement, elles ont fusionné, donnant naissance à un hybride affreux, qui parle la novlangue – le Vallsebourg –, amalgame de discours sécuritaire et de patriotisme économique, accouplement républicain de la matraque et de la marinière.
3. La trahison des images
La télévision par câble et l’explosion d’Internet ont imposé une forme de téléprésence des gouvernants et substitué à l’incarnation de la fonction, la surexposition de la personne des présidents.
Dès sa prise de fonctions, les images à l’Arc de triomphe du nouveau président trempé sous la pluie, les lunettes embuées, le visage ruisselant constituaient l’anti-portrait d’un président en majesté… La photo officielle du président réalisée par Raymond Depardon est venue confirmer la contre-performance de la cérémonie d’investiture. Le photographe de la France rurale et des gens simples réalisa le portrait d’un président non plus simplement normal mais banal, un « monsieur Tout-le-Monde » égaré dans les jardins de l’Élysée, figé, les bras ballants, un sous-préfet aux champs.
Cette image est en contradiction avec le décorum monarchique lié à l’exercice de l’État. Un conseiller à Matignon observait qu’il est « extrêmement difficile » pour la gauche de gouverner la France dans un « décor de droite : des hôtels particuliers, entourés de gardes républicains, avec des huissiers qui ont des chaînes, dans des escaliers en marbre, et des bureaux couvert d’or et de miroirs, ces hôtels qui ont appartenu soit à la Pompadour, soit au prince de Monaco, etc. »
Arrivé à Matignon en pleine affaire Cahuzac, ce même conseiller doit trouver un lieu pour que le premier ministre fasse une déclaration. « J’allais de bureaux en salons, et je ne voyais que de l’or, du stuc, des tableaux de maître… Et je me disais « où trouver un décor de gauche ? ». On ne va pas y arriver. J’ai fini par choisir un salon ouvert sur le parc et les jardins. »
L’image présidentielle se joue sur deux scènes concurrentes. L’une, traditionnelle, est celle du protocole. L’autre, transmédiale, est celle de l’opinion. Le nouvel élu doit se conformer aux règles de ces deux ordres que tout oppose : un pied dans la théâtralité du pouvoir, l’autre dans la téléréalité, l’un sur la scène monarchique, l’autre sur les réseaux sociaux. Il doit épouser la majesté institutionnelle et la proximité transmédiale. L’étiquette et le Selfie. Ainsi se trouve-t-il placé dans une situation inconfortable : proche et lointain, souverain et accessible. Sous les ors de l’Élysée, le président s’étire, se hausse jusqu’à la fonction, mais il doit aussi rester proche des gens. On le siffle, on le houspille ; il se prête à la ferveur de ses fans, signe des autographes, serre des mains, se fait photographier à leurs côtés.
Nicolas Sarkozy transgressait l’étiquette. Il fit entrer le smartphone et le jogging à l’Élysée. François Hollande, lui, est piégé par le dispositif. Nulle volonté de transgression chez lui, c’est l’acte manqué qui domine. Tout son mandat n’est qu’une succession d’erreurs de catégorie. De la rue du Cirque au cireur de chaussures d’Aquilino Morelle, il est trahi par les images.
Cela éclata au grand jour lors du dialogue mis en scène par les chaînes d’info entre un président en exercice intervenant de l’Élysée et la jeune Leonarda, une lycéenne expulsée avec sa famille au Kosovo. Ce fut plus manifeste encore avec les photos volées du président à la une d’un tabloïd, le visage dissimulé sous un casque intégral rendant visite à sa bien-aimée, juché sur un scooter. Loin de la mise en scène de la visite de Nicolas Sarkozy et de Carla Bruni à Disneyland, qui relevait du conte de fées ou du genre de l’idylle, les photos volées de la rue du Cirque révélaient une situation vaudevillesque typique, le dévoilement d’un jeu de ménage à trois, avec le mari volage qui est démasqué alors même qu’il apparaît le visage masqué sous un casque intégral. Un jeu de dupes à double détente, au cours duquel le trompeur masqué est démasqué, le dupeur est dupé par son stratagème, le simulateur confondu par le complot ou l’agencement des images.
Il en est de même de la désastreuse image, et qui n’est que mentale celle-là, du conseiller du président, Aquilino Morelle, se faisant cirer les chaussures sous les ors de l’Élysée. À la différence de Barack Obama, que le photographe Pete Souza met en scène jusque dans sa vie privée, François Hollande est constamment piégé par les images. Ce que l’iconographie de la présidence nous donne à voir, ce n’est pas l’image d’une autorité mais la dispersion aléatoire des images et des signes d’autorité.
4. Le démenti des chiffres
Celui qui fut auditeur puis conseiller référendaire à la Cour des comptes, avant de devenir le secrétaire de la commission des finances à l’Assemblée nationale, s’est employé pendant de longues années à cultiver sa crédibilité de gestionnaire. Par chance pour lui, c’était le moment : depuis la crise de 2008, l’électorat tournait le dos aux excès du néolibéralisme et se choisissait des leaders plus rassurants que Berlusconi, Bush ou Blair. Un ethos de crise que Karl Lagerfeld sigla en 2009 avec sa collection : « une nouvelle modestie ». En politique, cela donna le nouveau look : « comptable à lunettes ». Budget en équilibre. Président équilibré. Après Berlusconi, Monti en Italie. Après Zapatero, Rajoy en Espagne. Après Sarkozy, Hollande en France.
Comme un pilote privé de visibilité qui vole aux instruments, Hollande gouverne aux chiffres. C’est sur eux qu’il demande à être jugé. Réduire la dette. Maîtriser la dépense. Emprunter à taux bas. « Ce que j’ai appris, a-t-il déclaré le 4 mai 2014 au Journal du Dimanche, c’est que la France compte si elle a de bons comptes. » Ce fétichisme des chiffres a fini par s’épanouir en une véritable pensée magique, avec la prophétie de l’inversion des chiffres du chômage avant la fin de l’année 2013.
« Faire une telle prévision, c’était s’exposer au démenti des chiffres, constate un ex-conseiller à Matignon. Quand on annonce à l’avance qu’un truc va se passer et que rien ne se passe, on perd toute crédibilité. Et quand bien même il se passerait quelque chose, les gens n’y croient plus, ils crient à la manipulation des chiffres. Les mois suivants, les chiffres ont été mauvais, nous obligeant à publier des éléments de langage de plus en plus psychotiques… La promesse de l’inversion de la courbe du chômage s’est retournée contre le président, elle est devenue l’inverse d’une promesse, c’est-à-dire un mensonge ou plus exactement la promesse d’un mensonge. »
5. La bataille des valeurs
Depuis l’effondrement du communisme et la fin des grands récits émancipateurs, les socialistes conçoivent la politique comme un théâtre moral où s’affrontent des « valeurs ». Qu’il s’agisse du social ou du sociétal, de l’économie ou de la diplomatie, ils se sont institués en ardents défenseurs des « valeurs » : humanisme, laïcité, droit d’ingérence, honnêteté, rigueur comptable, etc. Voilà l’ADN du hollandisme. C’était l’enjeu central de l’élection présidentielle, le terrain d’affrontement choisi par François Hollande avec l’ex-président Sarkozy – les valeurs – dont il fit l’éloge et l’inventaire dans l’interminable anaphore du débat de second tour.
Le président normal promettait un retour au fonctionnement normal des institutions. Il proposait un exercice décent du pouvoir (tout à la fois modeste, intègre, et « moral ») qui s’opposait à l’indécence supposée de l’ancien président (son rapport décomplexé à l’argent, son égotisme et son absence de scrupules). L’apologie de la rigueur morale coïncidait avec le programme de rigueur budgétaire et d’austérité qui repose, comme l’a écrit Paul Krugman, sur « une pièce morale, une fable où la dépression est la conséquence nécessaire de péchés préalables, en conséquence de quoi il ne faut surtout pas l’alléger ».
C’est cette construction mythologique qui a volé en éclats avec l’affaire Cahuzac. Que celui qui était chargé de la lutte contre l’évasion fiscale dissimule un compte en Suisse et un montage de comptes à Singapour a soudain réduit à néant tous les discours sur l’impartialité de l’État, sur l’équité des efforts exigés de chacun.
« C’est le traumatisme du quinquennat ! affirme un conseiller ministériel. Cahuzac a rendu possible une connexion entre des wagonnets qui auraient mieux fait de ne pas s’accrocher ensemble. Premier wagonnet : celui de la gauche et l’argent. Deuxième wagonnet : la gauche social-traître. Un court-circuit qui se produit au pire moment de la politique d’austérité, provoqué par celui-là même qui est chargé de demander des efforts aux Français ! »
En outre, le mensonge public du ministre du budget devant la représentation nationale sapait les deux piliers (déjà bien branlants) de la souveraineté de l’État. 1. Il jetait le soupçon sur la signature de l’État puisque son grand argentier était un fraudeur fiscal. 2. Il achevait de décrédibiliser la parole de l’État et la rhétorique rocardienne du « parler vrai », à laquelle Jérôme Cahuzac avait recours chaque fois qu’il s’agissait de plaider pour la rigueur et l’austérité.
Après avoir échoué à l’épreuve des mots, déserté la guerre des récits, subi la trahison des images, s’être vu infliger le démenti des chiffres, François Hollande perdait ainsi la bataille des valeurs. Cinq défaites pour un demi-quinquennat : et une confirmation par le verdict des urnes, prononcé dans le silence accablant de l’électorat socialiste aux élections municipales et européennes. C’est le prix d’une défaite symbolique sans précédent sous la Ve République.
Les derniers jours de la Cinquième République
L’impopularité de François Hollande ne peut être uniquement attribuée, comme l’équipe au pouvoir s’acharne à le croire, à l’absence de résultats de sa politique. Elle atteint des niveaux inégalés qui menacent sa légitimité.
S’il est dans l’essence même du pouvoir de se donner à lire comme une intrigue, d’exciter la curiosité, de retenir l’attention, ce n’est pas l’exercice du pouvoir qui intrigue chez François Hollande, deux ans après sa prise de fonctions, mais son impossibilité à l’exercer, non pas les mystères de son incarnation présidentielle, mais son incapacité à assumer la fonction présidentielle, non pas la figure de la souveraineté, mais l’insouveraineté de la figure présidentielle…
L’exercice du pouvoir présidentiel sous la Ve République apparaît plus problématique que jamais. L’instauration du quinquennat et l’inversion du calendrier électoral ont redistribué les pouvoirs entre les deux têtes de l’exécutif. Les chaînes en continu exposent la fonction présidentielle à une téléprésence de tous les instants, hyperprésence plutôt qu’hyperprésidence, qui a eu pour effet de banaliser la figure du président et de décrédibiliser durablement la parole publique… La souveraineté de l’État fuit de partout. La désacralisation de la fonction atteint des niveaux inégalés, rendue sensible et obtenue par le passage du protocole à la performance, du secret à la téléprésence, de la rareté à la prolixité de la parole présidentielle ; bref, de l’incarnation de la fonction à la surexposition de la personne.
L’impopularité de François Hollande est un effet de structure qui ruine à terme non pas seulement le statut présidentiel et ses représentations symboliques, mais la fonction présidentielle C’est ce qui rend le demi-mandat de Hollande si fascinant à observer et si inquiétant. On y voit se décomposer pièce par pièce toute l’architecture de la Ve République. C’est une déconstruction lente, invisible à l’œil nu, masquée par l’enchaînement intrigant des épisodes.
Au prisme de cette descente aux enfers du hollandisme, se donne à lire un véritable processus de décomposition des institutions de la Ve République. Ce n’est donc pas seulement à la chute de la maison Hollande à laquelle nous sommes conviés, mais aux derniers jours de la Ve République, qui joue à guichets fermés ses dernières représentations.
La boîte noire :Pour préparer cet article, je me suis entretenu avec un certain nombre de conseillers et de ministres du gouvernement. Pour des raisons évidentes, ils ont souhaité rester anonymes. C’était le prix d’une plus grande liberté de parole et je les en remercie. Manuel Valls et ses conseillers sont les seuls à avoir refusé de répondre à mes questions.
———-
Christian Salmon, chercheur au CNRS, auteur notamment de Storytelling – La machine à fabriquer des histoires et à formater les esprits (2007, La Découverte), collabore de façon à la fois régulière et irrégulière, au fil de l’actualité politique nationale et internationale, avec Mediapart. Ses précédents articles sont ici.
En mai 2013, il a publié chez Fayard La Cérémonie cannibale, essai consacré à la dévoration du politique. On peut lire également les billets du blog de Christian Salmon sur Mediapart.
Partager la publication "François Hollande, un président qui rétrécit"