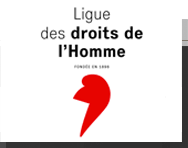En chantant la Grândola
Imaginez six millions de manifestants dans les rues de Paris, de Lyon et de Marseille. Eh bien, c’est ce qui est arrivé samedi au Portugal, où près d’un dixième de la population a défilé pour dénoncer, pêle-mêle, le gouvernement de centre-droit, le Fonds monétaire international et l’Union européenne. À Lisbonne et à Porto, le cortège a entonné la « Grândola, Vila Morena », l’hymne de la Révolution des œillets d’avril 1974. « À Grândola, ville brune, terre de fraternité, c’est le peuple qui commande », dit à peu près la chanson. Sans céder à l’illusion lyrique du grand soir, on doit méditer l’événement dans un Portugal saigné par une terrible politique d’austérité.
La cible, cette fois, n’est pas la dictature, mais un gouvernement qui, à peu de chose près, ressemble au nôtre. Et la cible, c’est aussi l’Europe. Une colère antieuropéenne qui monte de toute part et sous toutes les formes. D’autant que les démagogues sont à l’affût. On n’ose imaginer ce que donnerait aujourd’hui le référendum que réclame Marine Le Pen pour que la France sorte de l’Europe. Quel argument lui opposer ? Depuis 1992, c’est-à-dire depuis le traité de Maastricht, l’Europe pratique la contrebande idéologique. Derrière le bel idéal – que nous partageons – d’abolition des frontières et de dépassement des nationalismes, l’Union européenne fait passer une camelote infiniment moins glorieuse. Les marchés en sortent renforcés, et la démocratie y est affaiblie. L’arme de la monnaie nous a été retirée, la concurrence fait rage au sein même du Vieux Continent, le dumping social et les délocalisations en direction de pays membres aggravent le chômage. Il faut avoir l’âme chevillée au corps pour affirmer que cette Europe-là nous protège. Cette semaine encore, Bruxelles a remis un sérieux coup de pression sur le gouvernement français pour la résorption des déficits. La Commission contribue à rendre quasi obsessionnelle cette question dans le discours politique (voir à ce sujet l’entretien d’Henri Sterdyniak, p. 11). Bien sûr, l’Union européenne ne vient pas de nulle part. La gauche n’est pas pour rien dans sa dérive, elle qui, par exemple, a fait vigoureusement campagne pour le traité de Maastricht. L’Europe n’agit jamais que par procuration. C’est un peu, comme dans le poème de Goethe, le balai qui échappe à l’apprenti sorcier. À moins que l’apprenti sorcier ne soit finalement trop content de désigner un autre coupable que lui-même, pour une politique qui, au fond, est bien la sienne. Le problème, c’est que les peuples ne s’embarrassent plus aujourd’hui de toutes ces subtilités. Ils mettent MM. Barroso, Hollande, Passos Coelho, Monti et Mmes Lagarde et Merkel dans le même sac. Puisque, de toute façon, c’est toujours la même politique.
L’amalgame est particulièrement douloureux pour le Président français, dont la campagne électorale laissait espérer qu’il ne rentrerait pas aussi vite dans le rang des dirigeants néolibéraux. Le chômage vient d’atteindre chez nous la barre de 10,3 % de la population active, et il n’est question dans le discours gouvernemental que de déficit qu’il faut résorber. Ou, à la rigueur, d’une meilleure formation des chômeurs, comme si ces derniers étaient responsables de leur situation. Tout le monde sent bien qu’un acte de rupture est nécessaire. Plus personne ne croit au discours incantatoire sur le retour de la croissance, ou alors à quel prix ? Quant aux engagements d’inversion de la courbe du chômage avant la fin de l’année, ils avaient les charmes du volontarisme ; ils relèvent à présent de l’enfumage intellectuel. La vérité, c’est qu’il faudrait pouvoir repenser la période que nous vivons en des termes radicalement différents. Le seul mot « crise » nous induit déjà en erreur. Il répand l’illusion que nous allons tôt ou tard nous sortir d’affaire. Il est l’instrument d’une pression intolérable sur les peuples : accepter des sacrifices, nous dit-on, c’est juste un mauvais moment à passer. C’est aujourd’hui l’accord Medef-CFDT, et ce sera demain l’aggravation de la réforme Sarkozy des retraites. Dans un entretien tout à fait remarquable au Nouvel Économiste, Michel Rocard repose la question de la réduction massive du temps de travail. Cet éternel franc-tireur, capable du meilleur comme du pire, développe, chiffres à l’appui, une argumentation que nous avons parfois évoquée ici même.
La réduction du temps de travail s’opère aujourd’hui, mais de façon anarchique et inégalitaire. Cela s’appelle le chômage. Pourquoi ne pas l’organiser en répartissant mieux le temps de travail ? D’autres solutions existent qui, de toute façon, posent le problème de la répartition des richesses. Mais quelle force de frappe politique peut ruer dans les brancards ? Les socialistes en auraient les moyens, ils n’en ont pas la volonté. La gauche de la gauche en aurait la volonté, elle n’en a pas les moyens. Le système européen est ainsi fait qu’il désarme les peuples et déresponsabilise (ou déculpabilise) nos gouvernements. Jusqu’à quand nous fera-t-on croire que la politique n’est plus qu’une fatalité ? Plus très longtemps, semblent nous dire les manifestants portugais.
Partager la publication "En chantant la Grândola"