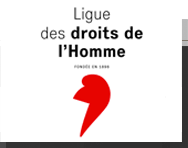Le dérèglement climatique pousse toujours plus de migrants sur les routes
Mediapart.fr
Les hausses des températures modifient les déplacements de population à travers le monde. Au moment où les experts du Giec rendent public leur cinquième rapport, un livre consacré aux migrations internationales explique les effets du changement climatique sur l’urbanisation accélérée de la planète.
Recensés dans le volumineux cinquième rapport du Groupe intergouvernemental d’experts de l’ONU sur l’évolution du climat (Giec), notamment dans son deuxième volet paru en avril 2014, les effets du réchauffement climatique sur les déplacements de population dans le monde font l’objet de débats politiques et juridiques aussi nombreux que passionnants. Mais les réalisations susceptibles d’améliorer le sort des personnes concernées restent balbutiantes et insuffisamment coordonnées.
Pour comprendre les enjeux liés à cette question multidimensionnelle, la publication de l’ouvrage compact de Christel Cournil, maître de conférences en droit public à l’université Paris-13 et membre de l’Institut de relations internationales et stratégiques (Iris), et Benoît Mayer, doctorant en droit à l’université nationale de Singapour et coordinateur d’un programme de recherche sur les migrations environnementales de l’université McGill à Montréal, Les Migrations environnementales, aux Presses de Sciences-Po, tombe à point nommé.
La situation est alarmante, puisque des dizaines de millions d’individus à travers la planète sont à la merci des mutations en cours, certaines causées par la main de l’homme, d’autres aux origines naturelles sans lien avec l’intervention humaine. Le parti pris du livre est toutefois d’éviter la polémique. Pas de prévisions catastrophistes, ni d’acteurs cloués au pilori. Tout en exposant les controverses, les auteurs invitent à renoncer aux visions simplificatrices en définissant aussi rigoureusement que possible le sujet pour identifier la terminologie pertinente et les solutions juridiques adéquates.
Au-delà de la variété des configurations des migrations environnementales (individuelles ou collectives, temporaires ou permanentes, volontaires ou contraintes, proches ou lointaines), des traits saillants sont repérables. Les changements climatiques poussent le plus souvent les personnes à quitter leur région mais pas leur pays. Alimentant un mouvement ininterrompu d’urbanisation, ils les incitent à se diriger en priorité vers les métropoles régionales, comme en témoignent, au Bangladesh et au Nigeria, les paysans chassés de leur terre venus tenter leur chance à Dhaka ou Lagos. Les populations déjà vulnérables vivant dans les pays aux structures politiques et économiques les plus fragiles, c’est-à-dire au Sud du globe, sont les plus touchées. Pour autant, les plus pauvres des pauvres se trouvent fréquemment empêchés de migrer, comme piégés, en raison du manque de ressources financières indispensables pour envisager de partir de chez soi.
Dans un souci de classification et de clarification, les auteurs répertorient plusieurs facteurs naturels déclenchants. Les désastres naturels soudains, comme les inondations, les ouragans, les typhons, les cyclones ou les glissements de terrain, peuvent conduire à l’évacuation forcée de milliers de personnes, généralement sur de petites distances. Beaucoup reviennent une fois la catastrophe passée. Sur les rives du Mékong, au Viêtnam, les populations ne se déplacent ainsi que de quelques mètres lorsque la rivière s’élargit. Dans le Nord-Kivu, en République démocratique du Congo, les fermiers déplacés par des coulées de lave retournent sur leur terre quelques jours après l’éruption, alors que la lave est à peine figée. Lors des inondations de l’hiver 2003, à Jakarta en Indonésie, les familles se sont regroupées aux étages supérieurs de leurs immeubles pendant quelques jours. À l’inverse, après le passage de l’ouragan Katrina, aux États-Unis, en 2005, les personnes ont eu tendance à parcourir des milliers de kilomètres pour retrouver du travail et bâtir une nouvelle vie, rendant leur retour moins fréquent.
La dégradation lente de l’environnement produit des migrations d’un autre type. En écho à la montée du niveau de la mer, à la salinisation des sols ou à la désertification, des personnes sont amenées, de manière plus individuelle, à faire le choix du déménagement. C’est le cas, par exemple, dans le Sahel africain, en Amérique latine et en Asie centrale, où les agriculteurs et les éleveurs voient leurs ressources progressivement grignotées par les intempéries. Certains, ceux qui en ont les moyens, finissent par faire le choix de la migration, le plus souvent vers la ville la plus proche. S’ensuit, de temps en temps, un périple plus long, et parfois clandestin, vers le Nord.
Le cas particulier des petits États insulaires de l’océan Indien ou de l’océan Pacifique menacés d’immersion provoque des déplacements irréversibles vers d’autres pays. Contrairement à une idée reçue, les départs résultent moins de l’élévation du niveau de la mer, qui n’est pas perçue comme un risque immédiat, que de l’appauvrissement des réserves d’eau douce découlant de l’acidification des océans (détruisant les massifs coralliens) et de l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des tornades et des sécheresses. Les auteurs rappellent ainsi que l’urgence nationale a été déclarée à Tuvalu en 2011 à la suite d’une sécheresse de plus de six mois qui a épuisé les réserves d’eau potable.
Dans ces lieux en sursis, les départs sont massifs : près de 3 000 Tuvaluans, soit le quart de la population, vivent et travaillent à Auckland en Nouvelle-Zélande ; en Micronésie, le taux net de migration (différence entre immigrants et émigrants) est négatif (-2 %), de même qu’aux Maldives (-1,3 %), où la production d’eau douce par désalinisation est tout juste suffisante pour la population. Dès septembre 2008, Maumoon Abdul Gayoom, le président de cet archipel dont le point culminant atteint 2,4 mètres d’altitude, a tiré la sonnette d’alarme. Dans une tribune publiée dans le New York Times, il a évoqué les conséquences du changement climatique qui menacent « de réécrire les frontières, de causer des conflits et de violer les droits fondamentaux individuels à une échelle au moins comparable à celles des guerres majeures du XXe siècle ». Son successeur, Mohamed Anni Nasheed, a marqué les esprits en organisant, en octobre 2009, le premier conseil des ministres sous-marin de l’histoire. Il s’est même dit prêt à acheter de nouvelles terres où la population des Maldives pourrait se relocaliser.
«Une personne ne peut pas être persécutée par des facteurs environnementaux»
La décision d’émigrer est rarement le résultat du seul facteur climatique, notent les auteurs. Les raisons économiques, politiques, sociales, démographiques et/ou environnementales s’entremêlent et interagissent. Les éleveurs nomades de Mongolie en sont une illustration : ils migrent actuellement massivement vers Oulan-Bator en raison des pertes importantes de bétails qu’ils subissent sous l’effet combiné des sécheresses estivales (exacerbées par le réchauffement climatique) et des hivers glaciaux. Mais le climat ne fait pas tout. La chute du communisme en 1990 s’est accompagnée d’une désorganisation du secteur agricole, ainsi que d’une concentration des investissements sur la capitale, qui les poussent à se reconvertir pour survivre.
La difficulté à circonscrire le phénomène rend les estimations numériques particulièrement incertaines. Selon les auteurs, les travaux de l’Internal displacement monitoring center (IDMC) et du Norwegian refugee council sont néanmoins les plus crédibles. D’après leurs conclusions, entre 16,7 et 42,3 millions de personnes ont été déplacées chaque année de 2008 à 2012 par des désastres naturels (sans compter les migrations à la suite de changements lents de l’environnement), principalement en Asie.
Réfugiés climatiques, migrants ou déplacés environnementaux ? Comment désigner un processus multifactoriel aussi large et mouvant ? Les auteurs notent que le terme de « réfugié » est souvent mal vécu par les personnes elles-mêmes. En témoigne l’exemple de La Nouvelle-Orléans après Katrina. En évoquant le sort des 1,2 million de « réfugiés environnementaux » de la ville, une partie de la presse américaine s’est attiré les foudres des victimes qui ne se sont pas reconnues dans ce vocabulaire. Le président d’alors, George W. Bush, est même intervenu pour affirmer que ces personnes « ne sont pas des réfugiés. Ce sont des Américains, et ils ont besoin de l’aide et de l’amour et de la compassion de nos compatriotes », comme si le terme de réfugié devait être réservé aux habitants du « tiers-monde ». Le recours à ce mot est par ailleurs problématique juridiquement, dans la mesure où il n’entre pas dans la définition de la Convention de Genève des réfugiés politiques. « Il est difficile de considérer qu’une personne puisse être persécutée par des facteurs environnementaux : la notion de persécution semble renvoyer à un comportement intentionnel, destiné à porter préjudice. À l’inverse, si des facteurs environnementaux peuvent porter préjudice, l’intention est absente, soulignent Christel Cournil et Benoît Mayer. En tout état de cause, la définition d’un réfugié contient une deuxième condition : la persécution doit cibler un groupe particulier. L’appartenance à un tel groupe fait généralement défaut dans le cas des personnes affectées par un phénomène environnemental. »
Le concept est toutefois défendu par celles et ceux qui jugent utile de l’appuyer sur un dispositif existant, pour en étendre le champ d’application. Parce qu’il n’est pas aisé de déterminer dans quelle mesure un événement météorologique donné relève ou non d’un changement du climat provoqué par l’activité humaine, les auteurs du livre semblent préférer la référence aux migrations environnementales plutôt que climatiques. Quant à « déplacé », ce terme renvoie, selon eux, à la contrainte du déménagement et, en ce sens, rend mal compte du fait que d’innombrables migrations environnementales sont volontaires.
Les victimes se comptent par milliers. Mais où sont les responsables ? Les migrants environnementaux, comme les auteurs se résolvent à les appeler, bénéficient pour l’instant de peu de protection juridique. Les débats sur les solutions à apporter s’organisent selon deux axes : soit privilégier la solidarité internationale, en mettant l’accent sur les droits de l’homme, soit insister sur la responsabilité des États, et notamment de ceux du Nord, pour instaurer des taxes de type pollueur-payeur. Les propositions, depuis une dizaine d’années, se multiplient dans le cadre des rencontres internationales entre États, groupes de pressions et ONG.
En raison de la focalisation à l’échelon mondial sur les questions de sécurité, l’adoption d’un traité international sur la protection de ces migrants semble aujourd’hui hors de portée, estiment les auteurs qui jugent les réponses politiques et institutionnelles apportées « fractionnées et insuffisantes ». Les projets ambitieux de conventions internationales, engagés à partir de la fin des années 2000, restent inaboutis. En revanche, des initiatives pragmatiques passant par un droit souple (soft law) suscitent de l’espoir, veulent croire les chercheurs, citant le processus intergouvernemental connu sous le nom de « Nansen », lancé en 2012, visant à trouver, entre États volontaires, un consensus sur la meilleure manière de répondre aux effets migratoires des « catastrophes naturelles lentes et soudaines ».
Certains États agissent d’ores et déjà, comme la Finlande, la Norvège et la Suède, où il existe une protection subsidiaire pour les personnes incapables de retourner dans leur pays d’origine à la suite d’un désastre environnemental. L’absence de « déferlantes » de ces réfugiés n’encourage pour autant pas leurs voisins à les imiter. Au niveau continental, l’Union européenne semble étrangement en retrait sur un sujet recouvrant deux préoccupations prétendument majeures (droits de l’Homme et changement climatique) susceptibles de bouleverser les équilibres mondiaux dans les années à venir.
Partager la publication "Le dérèglement climatique pousse toujours plus de migrants sur les routes"