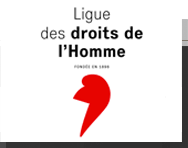Décroissance, travail non précaire, réduction des inégalités sont l’unique feuille de route à une planète équitable et de qualité :
On connaît bien aujourd’hui les effets spécifiques de l’inégalité sur une large gamme de problèmes sociaux. Ainsi, la cohésion sociale (appréhendée par des indicateurs tels que l’ampleur de la délinquance) est amoindrie par les inégalités. De même, la violence est plus répandue dans les sociétés inégales, y compris entre les pauvres eux-mêmes. Les politologues insistent également sur le fait que, dès lors que s’opposent des intérêts par trop contrastés, les démocraties connaissent de réelles difficultés de fonctionnement. Ainsi, dans les relations internationales comme dans le quotidien des relations entre personnes, l’inégalité mine la qualité des échanges et la confiance, et ébranle la légitimité perçue de l’ordre existant.
Au niveau des personnes, alors même qu’on ne peut plus ignorer que d’autres sont (bien) plus riches, quel sentiment vont susciter ces inégalités chez les plus pauvres : de l’envie ou de la honte, un sentiment de moindre valeur ou d’impuissance ? Même s’il est certain que les inégalités mondiales sont moins prégnantes que celles qui existent au sein des pays, il ne fait pas de doute que la globalisation change les références à l’aune desquelles on se juge (relativement) pauvre. Les habitants des pays pauvres risquent donc de se sentir de plus en plus pauvres. Dans un monde où les interactions et les possibilités de déplacement s’étendent de plus en plus, on peut alors s’attendre à davantage de tensions et, tout particulièrement, à davantage de mouvements migratoires.
Il y a certes la thèse libérale classique selon laquelle les inégalités auraient des effets positifs sur la croissance et le développement, notamment parce que, selon un trickle-down effect (effet de ruissellement), l’enrichissement des riches tire les pauvres vers le haut. Aujourd’hui, ces thèses sont largement contestées. L’économiste américain Joseph Stiglitz soutient la thèse selon laquelle l’inégalité rend l’économie moins stable et moins efficace, avec une moindre croissance, une profonde crise de confiance et une subversion de l’idéal démocratique. La crise financière est venue conforter ce sentiment que des inégalités trop fortes sont nuisibles (…). De la même manière, les inégalités de salaires et de pouvoir d’achat entre pays riches et pays pauvres engendrent un modèle économique que l’on peut caractériser comme du « pauvre vers le riche ». Les pays pauvres vendent aux pays riches les produits qu’ils fabriquent à bas coûts, et ils tirent profit précisément des inégalités entre pays. Mais dans ces pays, ce type de croissance néglige à la fois les producteurs – avec de mauvaises conditions de travail et des salaires très faibles – et les consommateurs, puisque le marché intérieur passe après les marchés des pays riches. Dans les pays riches, si les consommateurs profitent de produits bon marché, les délocalisations et le chômage viennent contrebalancer ce bénéfice. Par ailleurs, toujours pour les pays riches, le fait que les pays pauvres deviennent, en s’enrichissant, des clients solvables serait extrêmement bénéfique. Pour les pays pauvres comme pour les plus riches, ce modèle ancré dans les inégalités est donc insoutenable.
Une perspective écologique s’impose alors ?
Oui, car les inégalités sociales elles-mêmes sont susceptibles d’affecter – de fait, d’accroître – les problèmes environnementaux, alors qu’une société moins inégale, au niveau des États comme au niveau de la planète, rendrait davantage possible leur résolution. De manière générale, il y a toujours une interférence entre problèmes environnementaux et inégalités : les pauvres et les pays pauvres subissent davantage les conséquences de la dégradation de l’environnement, alors qu’ils y contribuent moins, ce qui, en tenant compte des responsabilités historiques des uns et des autres, accentue la responsabilité des plus riches.
Un second point à souligner c’est que les inégalités alimentent une comparaison sociale qui ne peut qu’engendrer une translation vers le haut des modes de consommation. Le risque est que, avec la mondialisation et la diffusion d’un certain style de vie (à l’« occidentale », pour faire vite), les inégalités par rapport à cette norme, à la fois au sein des pays et entre pays, engendrent une course à la consommation distinctive ruineuse pour la planète, avec une spirale sans fin de croissance économique, de destruction des ressources et de pollution. De plus, les consommations des riches ont un impact sur le sort des pauvres. C’est le cas quand on choisit les agrocarburants pour les voitures dans les pays riches ou quand les classes moyennes indiennes et chinoises adoptent le régime alimentaire carné des pays riches. Il en résulte, par ricochet, une augmentation du prix des céréales, qui est lui-même responsable des émeutes de la faim de 2008. Il est donc impossible de viser à sortir seulement certains groupes ou certains pays de la pauvreté, sans rien toucher à la situation des autres. Ce sont bien les inégalités en elles-mêmes qui constituent le problème majeur…
En outre, tant qu’il y a des pays riches et des pays pauvres, les premiers ont le pouvoir et la capacité de transférer leurs nuisances et leurs pollutions, dans les seconds. Si les rapports de force étaient moins déséquilibrés, on voit mal ce qui pousserait les pays pauvres à accepter sans broncher d’accueillir sur leur sol tous les déchets des pays riches ou à brader à des firmes étrangères le droit d’exploiter leurs ressources naturelles. Dans ce cas, les pays riches seraient incités, bien plus qu’actuellement, à limiter leur pollution. Plus largement, la définition d’un consensus mondial sur les questions environnementales et la gestion des « biens communs » est d’autant plus difficile que les inégalités entre pays sont marquées. Au total, le butoir écologique constitue l’argument suprême pour défendre la lutte contre les inégalités mondiales.
Alors que faire ?
Bien que les chercheurs y soient en général réticents, je discute dans le dernier chapitre du livre des pistes d’action possibles. En premier lieu, il faut prendre à bras le corps la question de la décroissance, même s’il s’agit d’une notion taboue politiquement, difficile à promouvoir. Pourtant, chacun sait aujourd’hui qu’elle est incontournable -dans un monde fini, on ne peut compter sur l’accroissement de la taille du gâteau- et qu’elle n’a de sens que couplée avec une redistribution des richesses. Le défi est alors de convaincre à la fois les Etats et les personnes, ce qui exige des institutions, des régulations et des mobilisations se situant à des niveaux différents.
Sans lister ici toutes les pistes envisageables, il y a tout ce qui touche à la gouvernance mondiale institutionnelle, et aussi la multiplication des réseaux mondiaux, des think tanks, des ONG, ainsi que les forums sociaux mondiaux, qui illustrent la montée de la société civile. Le rôle de ces régulations internationales est évidemment crucial dans des domaines comme le commerce et la finance, où les enjeux mondiaux sont déterminants et où une perspective de justice globale est impérative. Si le premier des devoirs est de ne pas nuire, il faut systématiquement se demander quelles répercussions nos propres choix – politiques ou en matière de consommation – ont sur les autres. Il est avéré que nombre de nos politiques, généreuses à l’intérieur de nos frontières, sont extrêmement dommageables hors de nos frontières. Des interrogations de même nature concernent le domaine fiscal : du fait de l’absence d’harmonisation des systèmes d’imposition, les pays pauvres peuvent être tentés par le dumping fiscal pour attirer les investissements étrangers, course sans fin qui finit par amoindrir leurs ressources.
Une chose est sûre, si le marché global l’emporte sur un pouvoir politique qui reste national, qui portera les problèmes intrinsèquement globaux et organisera les conditions institutionnelles propres à leur résolution ? Mais si ces conditions institutionnelles sont absolument nécessaires, l’insurrection des consciences est également fondamentale. Car il faut dans le même temps agir sur les cadres cognitifs et le niveau d’information. Si peu de gens ignorent aujourd’hui l’ampleur des inégalités et de la pauvreté globales, il faut faire évoluer les visions du monde, en l’occurrence éclairer les causes et les conséquences des inégalités mondiales.
Ceci passe par la conception et la diffusion de nouveaux indicateurs pour appréhender la pauvreté (et la richesse), ainsi que les inégalités de tous ordres, avec en perspective leur signification en termes de justice. Car notre grille de lecture des réalités est formatée par les chiffres disponibles, ce qui n’est pas sans affecter les opinions quant aux politiques à promouvoir. Ainsi, le soutien aux politiques de redistribution est bien plus fort quand on estime que la pauvreté relève des hasards de la naissance que quand on l’explique par le mérite. Prendre conscience de notre interdépendance avec les pays pauvres et de notre implication dans leur pauvreté elle-même est nécessaire pour convaincre les habitants des pays riches d’agir et, en particulier, de pousser leurs gouvernants à des politiques de redistribution globale. Car si diffuser des idées est fondamental, il faudra bien la force des gouvernants pour rendre acceptables des politiques forcément contraignantes. Le chaînon politique est donc essentiel ; mais, sans mobilisation des personnes et de la société civile, il n’a guère de chances d’être accepté ni mis en œuvre.
En conclusion, les limites de la planète, mais aussi nos intérêts bien compris, sans compter des considérations éthiques élémentaires, font qu’il est urgent et possible de tendre vers un monde moins inégalitaire. Cette perspective laisse certes augurer de conflits à court ou à moyen termes : plus nous sommes inégaux, plus il nous sera difficile de nous mettre d’accord pour réduire les inégalités. Il s’agit d’un défi politique difficile, mais le coût de l’inaction deviendra vite insoutenable : rien ne serait pire que laisser le monde gangrené par ses inégalités, par des mouvements migratoires incontrôlés, des guerres climatiques, des frustrations débouchant sur des conflits ou des mouvements terroristes, qui finiraient par rendre notre (petit) monde invivable. Vivre dans une société cosmopolite est à la fois inévitable et bien plus sympathique, si nous savons l’organiser selon des principes de justice globale
Source – Observatoire des inégalités : Extrait de l’entretien avec Marie Duru-Bellat, professeure de sociologie à Sciences Po-Paris, auteure de « Pour une planète équitable. L’urgence d’une justice globale » / relayé par la LDH fédé91- R. André
Partager la publication "Décroissance, travail non précaire, réduction des inégalités sont l’unique feuille de route à une planète équitable et de qualité :"