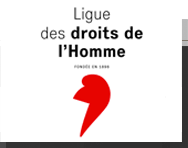Démocratiser l’Europe, peine perdue?
04 mai 2014
À l’heure de la « Troïka » et d’une abstention record attendue aux européennes, l’affaire semble entendue : l’Union européenne n’est pas assez démocratique. Pour répondre à ce déficit, un essai déplace la réflexion : il ne s’agirait pas tant de renforcer les pouvoirs du parlement européen, que de repolitiser les institutions « indépendantes », comme la BCE et la Cour de justice européenne.
La désertion s’amplifie à chaque scrutin. Le taux de participation aux élections européennes n’a cessé de baisser depuis 1979, année de la première consultation au suffrage universel pour le parlement de Strasbourg. À 63 % cette année-là (pour un total de neuf États), le taux a dégringolé, en 2009, à 43 % (moyenne pour 27 États). À l’échelon français, la tendance est identique, passant de 60,7 % (1979) à 40,6 % (2009). Les scores sont encore plus inquiétants chez certains « nouveaux entrants », comme en Pologne (24 % en 2009 – on y attend moins de 20 % cette année) ou en Slovaquie (20 %).
Malgré l’ampleur de la crise qui secoue la zone euro, et les pouvoirs chaque fois plus importants accordés au parlement européen au fil des nouveaux traités, l’abstention pourrait établir un nouveau record en mai. En France en particulier, les européennes continuent d’être considérées comme des élections de second ordre, qui mobilisent encore moins que les cantonales (45 % de participation en 2011). Le parlement européen a beau assurer cette année que « cette fois-ci, c’est différent », vantant la campagne « à l’américaine » des chefs de file désignés pour présider la Commission européenne, il faut une bonne dose de méthode Coué made in Bruxelles pour y croire.
Pour le parlement, ce recul continu de la participation vire au cauchemar. Il fragilise la seule institution, dans le jeu bruxellois, censée incarner une forme de légitimité populaire. Par ricochets, c’est toute la mécanique bruxelloise qui en pâtit : la Commission européenne est touchée, puisque son président tire sa seule véritable légitimité d’un vote des eurodéputés, en début de mandat, sur son nom. Et le Conseil européen, qui représente les intérêts des capitales à Bruxelles, a beau jeu par la suite de passer outre les avis du parlement, cette institution mal élue, éclipsée par le règne de l’« intergouvernemental ».
Les niveaux record d’abstention sont l’une des preuves de la « grande précarité de la légitimité démocratique de l’Union », pour reprendre l’expression de l’universitaire Antoine Vauchez, qui vient de publier un bref essai, Démocratiser l’Europe (République des idées-Le Seuil, 2014). Le constat est net : pour une majorité de citoyens, l’utilité de se rendre dans les urnes, fin mai, ne va pas de soi. C’est l’une des « anomalies démocratiques » de l’Union européenne, malmenée depuis le début de la crise par la pression des marchés financiers.
Après tout, à quoi bon aller élire des eurodéputés, pour cinq nouvelles années, si l’on dresse un bilan rapide du dernier mandat ? L’hémicycle serait menacé d’un devenir « paillasson », sur lequel les capitales s’essuieraient les pieds, selon la formule radicale d’une eurodéputée pourtant peu suspecte d’euroscepticisme, Sylvie Goulard (par ailleurs chef de file dans le Sud-Est pour l’UDI-Modem).
Les élus ont eu du mal à faire entendre leur voix au plus fort de la crise (par exemple concernant le traité « TSCG » sur la discipline budgétaire), ont accepté à contrecœur un budget d’austérité pour l’Union, ou encore ont assisté, muets, à la mise en place de « troïka » dans les pays en crise, en contradiction manifeste avec l’esprit des traités. Quant à certaines directives décisives, par exemple sur les travailleurs détachés, ils n’ont pu intervenir dessus qu’à la marge, tant les compromis entre les capitales se sont révélés serrés et difficiles à dépasser.
Ce bilan brutal est à nuancer : les eurodéputés ont aussi rejeté des accords commerciaux (comme l’accord commercial anti-contrefaçon ACTA en 2012), ou ont énormément légiféré en matière d’environnement ou de santé, dans des dossiers moins médiatisés, mais sur lesquels l’hémicycle montre en général une solide expertise. Ils ont aussi été les seuls, au sein des parlements en Europe, à lancer une véritable enquête, durant plusieurs mois, après les révélations d’Edward Snowden sur l’espionnage américain.
L’Union a beau se rêver, depuis l’adoption du traité de Lisbonne en 2009 (article 8.A), en « démocratie représentative » dont le parlement serait le poumon, le compte n’y est donc pas tout à fait. On en est même très loin. Son fonctionnement au quotidien n’a pas grand-chose à voir avec des mécanismes de « démocratie représentative », comme on peut les connaître à l’échelle d’un État, avec ses jeux de pouvoir et contre-pouvoir (et des interactions, par exemple, entre le gouvernement et l’Assemblée nationale en France).
À Bruxelles, la politique naît plutôt de la mise en concurrence d’institutions aux légitimités différentes, qui tentent de faire valoir leur point de vue – le Conseil, qui représente les capitales, la Commission, censée défendre un hypothétique « intérêt général européen » et enfin le parlement, issu des élections au suffrage direct d’un « peuple européen » encore en devenir.
Symbole de ce jeu à trois si hermétique aux yeux du grand public, tout se joue souvent dans la dernière ligne droite, lors des « trilogues », ces réunions à huis clos durant lesquelles des représentants des trois institutions tentent de se mettre d’accord sur une version finale des lois. Encore faut-il que le parlement ait une compétence sur le sujet – ce qui n’est pas toujours le cas, loin de là. Et bien souvent, à l’arrivée, c’est le Conseil qui gagne. À cela s’ajoute la culture politique qui règne entre les murs du parlement, tellement exotique pour un observateur français : c’est la domination du compromis permanent, avec des débats feutrés en plénière et, surtout, d’infinies réunions en coulisses, pour parvenir à élaborer des consensus souvent difficiles à résumer pour le grand public.
Si bien que les clivages traditionnels gauche-droite tendent parfois à s’estomper. Sur les dix résolutions et directives les plus disputées du mandat qui vient de s’écouler, les conservateurs du PPE (premier groupe au parlement) ont voté avec les socialistes et démocrates (le deuxième groupe) sur sept textes, d’après le décompte de l’ONG Vote Watch. Une pratique qui ne facilite pas la médiatisation des débats, et qui semble impossible à transposer à Paris. C’est bien là tout le problème, lorsqu’on réfléchit à améliorer la légitimité démocratique de l’UE : le réflexe immédiat – mais trompeur – est de transposer le système national à l’échelle bruxelloise.
Ouvrir la « boîte noire » de la BCE et de la Commission
Pour répondre au déficit démocratique de l’UE, ceux qui courent après une parlementarisation de l’Union – par exemple en renforçant les compétences de l’institution, pour qu’elle contrôle mieux la Commission – se tromperaient de bataille. C’est déjà ce que suggérait Nicolas Levrat dans un ouvrage publié en 2012 (La construction européenne est-elle démocratique ?, La documentation française) : « Victime d’un certain « stato-morphisme », l’Union semble vouloir copier à tout prix les structures démocratiques étatiques au gré de ses réformes institutionnelles successives » – et se condamnerait alors à l’échec. Le parlement ne serait pas forcément la bonne cible. L’UE devrait inventer autre chose.
L’initiative citoyenne européenne (qui permet depuis le traité de Lisbonne à un million de citoyens européens de soumettre une proposition législative à la Commission) n’a pour l’instant rien donné. Alors quoi ? Dans le texte qu’il vient de publier au Seuil, Antoine Vauchez, directeur de recherche au CNRS, décale la réflexion. L’accent n’est plus sur le parlement – le taux de participation aux européennes, les compétences des eurodéputés, le dialogue avec les parlements nationaux, etc., mais sur ce qu’il nomme « les indépendantes ». Soit un triptyque d’institutions bien plus puissantes, qui s’abritent en général derrière des habits de neutralité : la Banque centrale européenne (BCE), la Commission et la Cour de justice européenne.
« L’attente d’un grand soir démocratique qui replacerait le parlement au cœur du jeu politique risque de n’être qu’une chimère européenne de plus », prévient Vauchez, qui propose donc plutôt de s’attaquer aux « indépendantes », pour les réintégrer dans le champ de la politique, et les sortir de leur « sommeil dogmatique » (l’expression est du juriste Alain Supiot). « Dans la mesure où elles forment la clé de voûte de l’UE, c’est vers ces indépendantes qu’il faut porter le fer », résume Vauchez. « Le problème n’est pas que les citoyens se détournent des élections parlementaires européennes, mais que la politique elle-même se détourne du parlement européen.»
La Cour de justice, la Commission, et la BCE : ces trois institutions (respectivement basées à Luxembourg, Bruxelles et Francfort) ont construit leur légitimité politique sur leur statut d’indépendance. Elles sont censées incarner un point de vue impartial, pour le « bien commun » de l’Europe. Et, aussi étonnant que cela puisse paraître à certains, c’est parce qu’elles sont imperméables aux aléas électoraux et aux « égoïsmes » des capitales qu’elles se sont rendues incontournables au sein de l’Union. Guidées par des missions en apparence techniques, elles tirent leur raison d’être de leur soi-disant efficacité, sur le terrain.
L’une d’elles, la BCE, est si puissante qu’elle est même parvenue à elle seule – mais pour combien de temps ? – à mettre un terme à la crise des dettes publiques (en annonçant à l’été 2012 qu’elle était prête à racheter des obligations, de manière illimitée, pour contrer l’explosion des taux d’intérêt pour certains pays en crise).
Antoine Vauchez rappelle comment la Cour de justice européenne, de son côté, ne se gêne plus pour investir le terrain du droit du travail – domaine stratégique où les compétences de l’Union étaient restées faibles. Les récents arrêts « Viking » et « Laval » ont ainsi beaucoup fait parler d’eux, dans le débat concernant la directive sur les travailleurs détachés, et les abus qu’elle a causés. Dans ces arrêts, la Cour a fait primer la libre prestation des services à l’intérieur de l’UE sur le droit de grève (Viking), ou encore la liberté d’établissement des entreprises sur les conventions collectives nationales (Laval). En clair, la Cour s’assume dans un rôle très politique, celui de « bâtisseur du marché » unique, loin des fonctionnements d’une cour constitutionnelle classique.
« Ce type d’institutions incarne ordinairement non pas le pouvoir, mais précisément des contre-pouvoirs – et donc un espace périphérique, bien qu’intimement lié au champ politique. Or, au niveau européen, c’est justement par ces institutions de surveillance, de sanction et d’exécution qu’a pu se creuser le sillon d’un premier gouvernement européen distinct de la politique étatique », écrit Antoine Vauchez. Il y a donc bien une « polis européenne », mais qui n’a pas grand-chose à voir avec les rouages d’une démocratie majoritaire, et qui contourne le parlement européen.
Et c’est à démocratiser cette « polis » peu visible pour les citoyens, voire carrément opaque, qu’il faudrait travailler de toute urgence. En clair : ouvrir les « boîtes noires » de ces institutions au grand public.
L’entreprise serait d’autant plus incontournable que l’UE n’est pas aussi « malléable » que les fédéralistes convaincus, comme les partisans d’un retour au national, voudraient le croire, juge le directeur de recherche au CNRS. « On ne revient pas – par la magie d’une crise politique ou d’un grand soir institutionnel – sur un système qui s’est consolidé pendant près de six décennies et prend aujourd’hui racine dans une multiplicité de politiques publiques, de groupes et d’instruments, tout autant nationaux qu’européens », affirme-t-il. Un constat très pragmatique (« partir de l’Europe telle qu’elle est ») qui n’est pas sans rappeler les appels à une certaine « modestie » pour sortir de la crise européenne qui ont été formulés, ces derniers mois, par certains économistes et intellectuels (lire notre article).
Le texte d’Antoine Vauchez est souvent très stimulant, aux yeux de ceux que le déficit démocratique de l’Union ne cesse d’inquiéter. Mais si le diagnostic d’ensemble séduit, le manque d’ampleur des propositions visant à repolitiser ces « indépendantes » (par exemple en renforçant les contrôles de la politique de la BCE par le parlement, ou encore en imaginant une représentativité des syndicats au sein de la Commission et de la Cour), laisse sceptique. Ce grand écart entre la justesse du constat et l’extrême modestie des solutions avancées en dit long, à sa manière, sur la difficulté à déboucher l’horizon européen – même avec de très bonnes volontés.
Antoine Vauchez
Démocratiser l’Europe
La République des idées-Le Seuil, 112 pages, 11,80 euros
Partager la publication "Démocratiser l’Europe, peine perdue?"