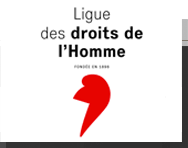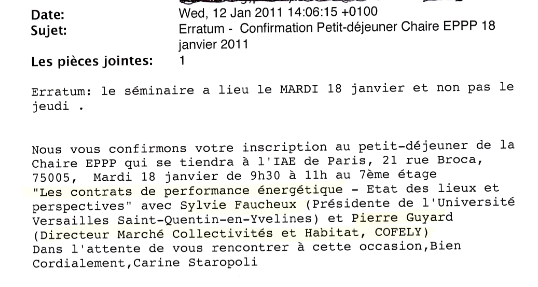D’un SMS, Farida Belghoul, fer de lance des journées de retrait de l’école, et sa nébuleuse, ont fini d’ébranler la confiance en l’Éducation nationale de centaines de familles, majoritairement musulmanes, dans les cités populaires. À Clermont-Ferrand, un absentéisme record a été enregistré dans les ZEP.
Clermont-Ferrand, de notre envoyée spéciale
C’est l’histoire de « la rumeur », comme ils l’appellent. Une campagne d’opinion qui en dit long sur les crispations gangrénant la société française et sur le schisme entre une partie des classes populaires et l’école républicaine. Elle a commencé à se répandre il y a un peu plus d’un an, au moment du débat sur le mariage pour tous. Elle a ciblé précisément les familles de confession musulmane à la périphérie des villes, dans les zones défavorisées, au pied des barres en béton des cités, où tous les voyants sont au rouge en matière d’emploi, de santé, d’éducation, de sécurité et de foi en la République.
Sortie d’école dans les quartiers nord de Clermont-Ferrand. © Rachida El Azzouzi
Des bruits, des voix, des sons, des tracts, venus d’un peu partout, amplifiés par les réseaux sociaux et le bouche à oreille, se sont mis à dire que l’école allait apprendre « l’homosexualité », « la masturbation », « la théorie du genre » aux enfants dès la maternelle, dès la crèche, « des mots qui sont interdits et qui font peur dans notre communauté », souffle une maman musulmane. À la rentrée de septembre, « la rumeur » a de nouveau enflé aux abords des groupes scolaires, des mosquées, des marchés, des associations de quartier, affolant les parents. Certains ont posé la question aux instituteurs. D’autres n’ont pas osé tant on touche à des tabous, ou parce qu’ils ne parlent pas ou pas assez bien le français, n’ont jamais mis le nez dans les programmes scolaires.
Puis il y a eu, fin janvier, à deux mois des élections municipales, « le SMS » de Farida Belghoul, l’apôtre des Journées de retrait de l’école (JRE), cette ex-figure de la lutte antiraciste, passée à l’extrême droite, nouvelle égérie de la réacosphère, vent debout contre l’enseignement de l’ABCD de l’égalité qui vise à lutter contre les stéréotypes de genre entre filles et garçons (lire ici notre enquête). Ardemment relayé par ses comités locaux, avec cette phrase, attribuée à tort à la sénatrice socialiste Laurence Rossignol : « Les enfants n’appartiennent pas à leurs parents mais à l’État », son SMS a fini d’ébranler la confiance en l’école républicaine de centaines de familles musulmanes à travers l’Hexagone.
En Auvergne, l’académie de Clermont-Ferrand (l’une des dix académies qui expérimentent en France l’ABCD de l’égalité) n’y a pas échappé. Dans cette ville de 140 000 habitants, ouvrière et de gauche, où il fait bon vivre, même dans ses quartiers nord fantasmés, sans comparaison avec les banlieues parisiennes ou marseillaises, l’appel national au boycott des classes de Farida Belghoul a été particulièrement suivi. Le 24 janvier dernier, pour la première JRE, un absentéisme record, avec des pics à 40 % par endroits, a été enregistré, de la maternelle au CM2 et même au collège, dans une quinzaine d’établissements des quartiers nord clermontois, mais aussi dans le bassin de Thiers, plus rural.
Le rectorat évoque un « phénomène minoritaire », refuse de donner des chiffres précis, arguant qu’il ne peut dissocier les absents pour cause de « rumeur » ou d’épidémies hivernales, mais ni la grippe ni le retour de la gale ne sauraient suffire à expliquer cette défection soudaine. Particularité de ces écoles, principalement en zone d’éducation prioritaire, qui ne sont souvent pas concernées par l’expérimentation de l’ABCD de l’égalité : elles concentrent une forte communauté turque, celle qui a localement reçu et relayé la première le SMS du mouvement de Farida Belghoul auprès des familles, selon tous les témoignages recueillis.
Les Turcs. La « galaxie Belghoul » n’a pas visé n’importe quelle diaspora. C’est l’une des plus puissantes, avec 5 000 ressortissants en Auvergne dont 3 000 dans le Puy-de-Dôme, pour la plupart originaires d’Anatolie centrale. Très structurée, très organisée, très solidaire, c’est aussi l’une des plus conservatrices et des plus fermées. « On ne se marie et ne prie qu’entre soi, dans ses propres lieux de culte, deux mosquées dont l’une sous l’égide de Milli Görus, réseau turc paneuropéen », décrypte un acteur social.
La dernière enquête Trajectoires et origines de l’Ined et l’Insee, qui compare les parcours scolaires au sein des immigrations récentes d’Afrique subsaharienne, de Turquie et d’Asie du Sud-Est, avec des immigrations plus anciennes comme celle du Maghreb, pointe une déscolarisation précoce des jeunes filles turques et un accès au bac et à l’enseignement supérieur très limité (lire ici et là nos décryptages).
Difficile, cependant, d’identifier les relais locaux de la nébuleuse Belghoul qui, sous la pression de la médiatisation, a fait disparaître « les contacts régionaux » de son site internet dès le lendemain de la première JRE. « Ce n’est pas parti de nos mosquées », assure Sahin Arif, un des représentants de l’amicale culturelle des Turcs d’Auvergne. Il a été alerté de « la rumeur » par des enseignants turcs qui ont reçu « le SMS » en tant que parents d’élèves, s’est interrogé sur son origine, son mécanisme, sans trouver de réponse. De nombreuses sources, qui revendiquent l’anonymat tant le sujet est « explosif », pointent aussi du doigt « l’islam des caves à Croix-de-Neyrat », l’un des quartiers nord de Clermont où des religieux, barbes broussailleuses et prêches rigoristes, seraient à l’œuvre et auraient encouragé la déscolarisation des enfants le 24 janvier.
Né en Algérie, marié à une Française, l’architecte Karim Djermani, secrétaire général de la grande mosquée d’Auvergne (sur la ligne de la grande mosquée de Paris), qui se dit aussi proche du plus fidèle des sarkozystes, Brice Hortefeux, que du maire Serge Godard, le baron socialiste local, éclate de rire : « Clermont est très loin de l’intégrisme, de Kaboul et d’Argenteuil ! Il y a certainement des associations opportunistes qui manipulent les esprits dans les quartiers, tentent d’implanter un islam qui n’est pas le nôtre, mais c’est une infime minorité. » Il n’a pas reçu le SMS, n’a « retiré personne de l’école ». Pour lui, « le problème, ce n’est pas de savoir qui l’a diffusé. Il faut arrêter de résumer le peuple musulman à des moutons de Panurge, des chiens de Pavlov. Je ne connais pas cette Farida Belghoul ».
« Si la confiance est rompue avec l’école », assène-t-il, véhément, « c’est parce que les musulmans de France partagent les mêmes craintes que les catholiques et les juifs devant la remise en cause de valeurs qui nous sont sacrées, la famille, la religion. C’est le gouvernement, Peillon, Vallaud-Belkacem qui sont dans une forme de fondamentalisme, de propagande. C’est à eux de revoir leur copie et d’ailleurs, sous la pression, ils ont fait marche arrière. Si leur projet est de gommer les différences sexuelles, nous disons non. Ce n’est pas être homophobe. Il y a d’autres chantiers plus urgents dans ce pays : l’économie, l’emploi, l’intégration. »
« Pour nous, l’école, c’est fait pour enseigner, apprendre à lire, écrire, compter »
Pourtant, ce matin-là du 24 janvier, la manipulation des esprits était criante dans les quartiers nord-clermontois. Sur le trottoir de l’école, en déposant son enfant, Gérald, permanent dans une association d’éducation populaire, a pris « une claque » lorsqu’il a vu qu’un SMS, « pas des partis politiques, des syndicats », pouvait conduire « des Français normaux, pas des fascistes », à retirer leurs bambins de l’école du jour au lendemain. Jamais il n’aurait imaginé voir émerger un tel mode d’action : « Cela veut dire que des familles ne perçoivent plus les enjeux de l’école, que le ministère, les enseignants ne communiquent pas, qu’ils prennent de haut les parents et que des groupuscules jouent avec le feu en attisant les peurs et les fantasmes. »
Même lui, qui connaît par cœur ces quartiers nord où il vit « dans un coin encore relativement mixte, d’HLM et de résidences pavillonnaires », n’a « rien vu venir ». Jusqu’à ce que des familles l’encerclent, lui, « le Blanc », responsable du collectif des parents d’élèves : « Alors c’est vrai ? Ils vont enseigner la théorie du genre à nos enfants dès la crèche, qu’ils peuvent choisir entre être une fille ou un garçon ? »
Au même moment, à quelques encablures de là, dans la cité de la Gauthière, « c’était l’hystérie », se souvient une habitante. Les familles s’étaient levées comme elles s’étaient couchées : dans la panique à cause de « la rumeur » arrivée quelques jours auparavant, exclusivement sur les téléphones portables de la communauté musulmane, d’abord les Turcs puis les Maghrébins, les Tchétchènes…
La cité de la Gauthière, à Clermont-Ferrand © Rachida El Azzouzi
Tout le monde, les hommes comme les femmes, hésitait à mettre les enfants à l’école, ne parlait plus que de « la théorie du genre » sans trop savoir ce que cela signifiait. On ne prononçait jamais d’ailleurs vraiment son nom ou alors du bout des lèvres avec le rouge qui monte aux joues, la honte de devoir évoquer un sujet qui appelait le tabou de la sexualité y compris dans la sphère familiale. « Chez nous, on ne parle jamais de sexe, on n’embrasse pas son épouse devant les enfants, on change de chaîne au moindre baiser entre un homme et une femme devant un téléfilm », confie un père de famille algérien tellement gêné d’en parler qu’il regarde ses pieds.
Dans les cages d’escalier, les mamans, voilées ou dévoilées, en hidjab ou jeans, selon les générations, leur vision de l’islam, le poids des traditions, s’interpellaient devant les enfants qui ne comprenaient rien aux enjeux. « Tu es folle de les envoyer aujourd’hui à l’école ! Ils vont recevoir la visite d’un sexologue et d’une psychiatre qui va leur apprendre « hum hum » (ndlr : pour ne pas dire « sexe ») », lançait une jeune Turque à sa voisine tunisienne, anéantissant sa journée. « Je l’ai passée à prier et à angoisser », décrit cette dernière jusqu’à ce que ses têtes brunes rentrent de l’école et lui apprennent que l’événement de la journée, c’était la galette des rois, qu’il n’y a jamais eu de sexologue…
Parti travailler aux aurores, tracassé par tous ces commérages qui parasitaient depuis des mois la cité, le mari d’Inès (*), fonctionnaire, avait laissé la responsabilité de la décision à sa femme : « En tant que déléguée de parent d’élève, tu sauras prendre la bonne. » Le couple, quatre enfants de 3 à 10 ans, en avait cependant discuté : « Pour nous, l’école, c’est fait pour enseigner, apprendre à lire, écrire, compter. L’éducation sexuelle, c’est notre rôle, cela se passe à la maison, dans l’intimité du foyer selon nos cultures, nos religions, à l’âge où l’on décide d’en parler. »
Dans leur appartement avec vue sur l’usine Michelin et la chaîne des volcans d’Auvergne, Inès, Française d’origine algérienne, musulmane non pratiquante, qui ne porte pas le voile et ne fait « pas de cirque s’il n’y a pas de viande halal à la cantine », avait fini par trancher : « Les gosses resteront à la maison en attendant de connaître le projet véritable du gouvernement. » Elle s’était fait « une opinion » après une nuit blanche devant le site internet JRE2014 et sa page Facebook où Farida Belghoul déroule ses postulats les plus délirants sur l’enseignement supposé d’une théorie du genre.
Inès, qui a grandi en banlieue parisienne, en Seine-Saint-Denis, où ses parents illettrés lui ont martelé que l’école était sa seule porte de sortie avant d’échouer comme beaucoup d’enfants d’immigrés dans un lycée professionnel « parce qu’on nous considérait comme des cancres », commençait à croire aux thèses de cette « Farida Bel machin qui parle bien » et dont elle ignorait à ce moment-là tout de la vie, du parcours, des rancœurs, des frustrations. Elle ne voulait pas aussi « se mettre à dos la communauté musulmane », « les copines turques en particulier », les plus virulentes dans cette affaire, qui la harcelaient de textos et de coups de fil depuis des jours : « T’as vu la rumeur, les SMS ? Il faut que tu retires tes enfants de l’école, que tu sois solidaire. »
Un mois plus tard, la jeune maman, bac + 2 en recherche d’emploi, se mord les doigts d’avoir osé retirer un jour durant ses enfants de l’école de la République sur une rumeur complètement folle alors qu’elle ne l’a jamais fait pour réclamer l’ouverture d’une classe, le remplacement d’un professeur malade, une meilleure réussite scolaire dans les ZEP. « J’ai été manipulée par un SMS et j’ai perdu quinze euros de cantine ce jour-là », se désole-t-elle ce vendredi 21 février devant la maternelle où est scolarisée l’une de ses filles.
Elle sort « soulagée et rassurée » de la réunion tant réclamée entre l’inspecteur d’académie de la circonscription et les directrices du groupe scolaire sur « les incompréhensions qui ont alimenté les rumeurs » : « On aurait aimé une réunion publique ouverte à tous les parents mais on nous a dit que la salle était trop petite. » En tant que représentante des parents d’élèves, elle fait partie de la dizaine de mamans triées sur le volet qui ont pu y assister et sur lesquelles le rectorat compte pour aller porter la « désintox » et rétablir la vérité dans les différentes communautés.
Elle s’y attelle déjà devant une assistance tout ouïe, en s’appuyant sur le document que leur a distribué l’inspecteur, un tract du ministère du droit des femmes : « Non, la théorie du genre n’existe pas. Il existe des études de genre conduites par des chercheurs qui mettent ainsi en lumière les inégalités sociales entre hommes et femmes. Non, l’ABCD de l’égalité ne vise pas à supprimer la différence des sexes, à influencer la sexualité des enfants. Non, on ne lit pas le livre Papa porte une robe aux enfants dans les modules ABCD. »
« Le pire, c’est qu’on a perturbé nos gamins car on a été obligé de leur parler du tabou du sexe »
Inès se réjouit du dialogue retrouvé avec l’institution : « Finalement, quand l’école parle aux parents, cela va beaucoup mieux. » Elle crie aussi à la manipulation : « C’est très bien que l’on enseigne à mes enfants l’égalité hommes-femmes, que ma fille peut jouer avec des camions, mon fils faire le ménage. Nous avons été bernés par des extrémistes qui profitent de notre ignorance pour attiser nos peurs à la veille d’échéances électorales et nous sommes tombés comme des bœufs. » Désormais, lance-t-elle à la cantonade, elle ne se laissera « plus embrouiller l’esprit par les intégristes de tous bords, les politiques et les médias ». Elle changera aussi de chaîne de télévision si le visage de Farida Belghoul réapparaît.
Catho, Simone (en doudoune grise) n’a pas reçu le SMS, mais si elle l’avait reçu, elle aurait retiré ses enfants de l’école. © Rachida El Azzouzi
Nora (*), une jeune maman voilée, finit par être convaincue. Elle a « mal à la tête » lorsqu’elle regarde les chaînes d’information en continu, « le spectacle des politiques qui l’emporte sur les vrais problèmes ». Elle clame qu’elle ne participera à aucune élection, ni les municipales, ni les européennes. « Cela ne sert à rien. Nous sommes “rien”. J’ai voté Sarkozy, Hollande. Le second est pire que le premier et il n’est même pas marié. Il trompe sa compagne et on ne parle que de cela dans les journaux. Il fait la guerre au Mali, en Centrafrique où l’on élimine les musulmans. Il n’y a pas de travail pour les jeunes des quartiers, les prix, les impôts, la misère continuent d’augmenter. Par contre, il vote le mariage pour tous. Je ne suis pas homophobe, mais ce n’était pas la priorité et il ne fallait pas l’appeler mariage. »
Derrière elle, Simone, la quarantaine, quatre enfants, baptisés et non baptisés, acquiesce en allumant une cigarette : « Tu mélanges tout mais tu as raison. » « Blanche et catho », pas du genre à aller à la messe, elle n’a « comme par hasard pas reçu le SMS qui avait ses cibles : les Arabes et les Turcs ». Si elle l’avait reçu, elle aurait retiré ses enfants de l’école « car il y a des limites, la sexualité, c’est notre affaire ». Déléguée des parents d’élèves, elle est l’une des rares à témoigner à visage découvert, et l’une des rares catholiques dans cet établissement qui concentre des enfants d’immigrés de confession musulmane. « Le pire, dit-elle, c’est qu’on a perturbé nos gamins car on a paniqué sous leurs yeux et on a été obligé de leur parler du sujet tabou, le sexe. Résultat : l’autre jour, le petit de madame… est entré en classe en menaçant la maîtresse de quitter l’école si on lui parlait de zizi. »
Quelques poussettes plus loin, Seher (*) et cinq autres mamans françaises, originaires de la même région en Turquie, ne décolèrent pas. Elles ont quitté la réunion avec l’inspecteur d’académie comme elles y sont entrées : furieuses. « Je ne veux pas qu’on me photocopie le courrier du ministre de l’éducation nationale envoyé aux établissements, je veux un courrier du ministre aux parents qui dit que la théorie du genre ne sera jamais enseignée à nos gamins », répète Seher. Inès et Simone partent à sa rencontre, tentent de la « désintoxiquer ». En vain. La jeune maman, en jean slim et voile bleu, campe sur ses positions, parle d’un « complot européen venu d’Allemagne » et tourne les talons. « On peut (lui) couper les allocations familiales », elle retirera un vendredi par mois ses enfants de l’école tant qu’elle n’aura pas « le tampon du ministre »…
© Rachida El Azzouzi
Signe que « la rumeur » serait retombée pour le rectorat de l’académie de Clermont-Ferrand : la deuxième Journée de retrait de l’école, le 10 février dernier, a été nettement moins suivie, 18 écoles touchées sur une académie qui en compte 1 400 et un taux d’absentéisme de 5,3 %. Mais sur le terrain, malgré les explications de texte entre parents, professeurs, directeurs, inspection académique ; malgré l’appel des imams « à remettre les enfants à l’école » – tout en demandant, cependant, à leurs fidèles « de rester vigilants sur le projet du gouvernement », à l’image du mufti de l’une des deux mosquées turques de la ville –, la confiance est loin d’être rétablie.
« La rumeur a diffusé son poison lentement, sûrement. Je n’ai jamais connu une telle défiance. Tous les jours, je dois m’expliquer avec des familles qui délirent sur le genre », s’étrangle une institutrice. Elle témoigne sous couvert d’anonymat tant le sujet est « brûlant » et parce que la consigne venue d’en haut est « de ne pas répondre à la presse pour ramener la sérénité dans les écoles ».
Enfant des quartiers nord où elle a choisi de rester vivre et travailler, pur produit de la méritocratie républicaine, fille d’ouvrier immigré, « musulmane ouverte » qui ne fait pas la prière mais respecte les rites comme le ramadan, elle avait senti « une fracture au moment du mariage pour tous qui a ravivé des peurs irrationnelles dans certaines franges de la communauté ». Si elle peut « comprendre les interrogations de certaines familles liées aux cultures, aux religions », elle reste « choquée que des parents, dont certains instruits, qui ne s’alarment pas que la pornographie soit en accès illimité sur Internet mais osent imaginer que nous allons faire l’éducation sexuelle de leurs gosses ».
« En matière d’apprentissage de la sexualité en primaire, on en reste aux basiques, à Jules Ferry, à l’œuf, le poussin. Même le mariage tout court entre un homme et une femme, on ne l’aborde pas. C’est ce que je répète aux parents qui jusque-là ne m’avaient jamais posé la question », abonde à son tour un directeur d’école, « pas surpris par la fronde réac». Lui aussi s’exprime sous couvert d’anonymat. Trente ans qu’il enseigne dans ces cités défavorisées, observe leur évolution ou plutôt leur repli communautaire, « la montée des intégrismes sur fond de crise sociale », « le retour du foulard chez des femmes de plus en plus jeunes », « ses anciennes élèves aujourd’hui voilées, déscolarisées et mariées très jeunes »…
Pour lui, l’une des questions cruciales, ce n’est pas l’absence de dialogue entre l’institution et les familles, le ministère et les équipes pédagogiques, encore moins l’islam, mais la ghettoïsation croissante de ces quartiers délaissés des pouvoirs publics, où pour une partie de la deuxième génération descendant d’immigrés, l’école n’a jamais été l’ascenseur social promis.
« Il est fini, le temps du vote musulman massif et aveugle acquis au parti socialiste »
À l’autre bout de la ville, c’est le débat qui enflamme ce vendredi soir Chérif Bouzid, éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse et ses copains d’enfance, sept pères de famille d’origine marocaine, des « grands frères » tous issus des quartiers nord. « Depuis vingt ans, la mixité sociale a disparu des banlieues, favorisant le repli identitaire de communautés acculées par la crise, le chômage. On a concentré la misère et en concentrant la misère, on a concentré l’ignorance, ouvrant un boulevard aux pires mouvances. Il est là, l’échec, et la gauche porte une lourde responsabilité sur l’état de nos banlieues comme la droite sur l’état dans lequel se trouve l’école aujourd’hui, en particulier dans les zones d’éducation prioritaire », constate plein d’amertume le plus politique de la bande.
Attablés dans l’un des principaux kebabs de la ville, chez « Moustache », l’un des patriarches de la communauté turque, ils ont entre 30 et 40 ans, appartiennent à « la deuxième génération ». Ils travaillent dans le social, l’enseignement, la recherche, ont fait des études, courtes ou longues, réussi leur vie professionnelle, personnelle, s’investissent dans la scolarité de leurs enfants, les devoirs, les activités extrascolaires, mais ils n’oublient pas les stigmatisations et les discriminations endurées « de la naissance à l’âge adulte », qui encore aujourd’hui leur laissent l’impression d’être des « citoyens de seconde zone ».
© Rachida El Azzouzi
Certains se sont « arrachés » du quartier, d’autres sont incapables d’en partir, trop attachés au béton de leur adolescence, à la famille, à la vie de village. Ils se souviennent des années 1980, quand, dans les tours HLM, « la mixité était réelle ». « Aujourd’hui, les Blancs ont presque disparu. On a parqué les communautés au fur et à mesure des vagues d’immigration, on a fabriqué l’entre-soi. Plus personne ne se mélange. Les Chinois traînent avec les Chinois, les Algériens avec les Algériens, les Turcs avec les Turcs, les Blacks avec les Blacks… »
Tous avouent avoir été « déstabilisés » par « la rumeur », l’un de leurs principaux sujets de discussion ces dernières semaines. La plupart n’ont pas déscolarisé leurs enfants lors des JRE, à l’exception de deux d’entre eux, qui décrivent aussi une autre réalité : les menaces de sanctions, de couper les allocations familiales aux parents frondeurs, les gamins méprisés par le corps enseignant. « Alors comme ça, aujourd’hui, tes parents ne t’ont pas retiré de l’école », s’est entendu dire un de leurs fils.
« Le genre à l’école, c’est un programme risqué, épineux, qui nécessite de consulter les citoyens, de faire de la pédagogie auprès des parents mais pas sur les plateaux télé de BFM. Même les chercheurs ne sont pas d’accord entre eux. » Si, comme la majorité des habitants des quartiers nord, Chérif n’attend « pas grand-chose de la gauche ni de François Hollande », il espérait « un vrai face-à-face avec les parents sur la refondation de l’école, l’ABCD de l’égalité, la question du genre », de la part du ministre de l’éducation nationale et de son homologue du droit des femmes.
Au loin, les Vergnes, l’un des quartiers nord les plus excentrés de Clermont. © Rachida El Azzouzi
Démarre une discussion où, pêle-mêle, ils abordent les capitulations du pouvoir en place qui ont creusé un peu plus le divorce avec la gauche dans ces périphéries oubliées, comme le droit de vote des étrangers, la lutte contre les contrôles au faciès, mais aussi Valls et l’affaire Dieudonné, la crise et l’absence de mobilité sociale dans les quartiers, le chômage des jeunes issus de l’immigration, la droite aux manettes pour récupérer les voix des millions de Français musulmans ou les pousser à l’abstention, cette réserve de voix de la gauche qui, selon eux, n’en est plus une.
« Dans les cités, nous ne sommes plus analphabètes comme nos parents. Nous savons penser par nous-mêmes. Il y a une élite. Il est fini, le temps du vote musulman massif et aveugle acquis au parti socialiste grâce en partie au clientélisme. Aujourd’hui, il y a des musulmans de droite, d’extrême droite, des centristes. Oui, demain, des Arabes vont voter FN et personne ne s’affole à gauche », lance une voix à l’autre bout de la table. « Le PS nous a rendus fous et idiots dans les quartiers populaires », réplique un autre.
À Clermont-Ferrand, où le Front national n’a jamais percé, un candidat s’invite, pour la première fois depuis 1989, dans la course à la mairie : Antoine Rechagneux, un agriculteur inconnu du grand public, qui se dit « déçu de la gauche ». Le 11 février dernier, Marine Le Pen est venue galvaniser ses troupes, promettant de « tutoyer la tranche 15-18 % » dans la capitale auvergnate. Dans ce bastion socialiste qui n’a pas connu l’alternance depuis soixante ans, où après dix-sept ans de règne, le maire, Serge Godard, bientôt 78 ans, n’a décemment pas rempilé pour un énième mandat (il y a pensé), la présence d’une liste FN alarme autant que le spectre de l’abstention à moins d’un mois du premier tour des municipales. Encore plus dans le contexte actuel de malaise national, d’impopularité présidentielle record et de progression d’une droite extrême et populiste.
Tandis que la droite se déchire sans que Brice Hortefeux ne réussisse à les souder (aucun accord n’ayant pu être conclu avec l’UMP Jean-Pierre Brenas, le MoDem Michel Fanget et l’ancien premier adjoint socialiste Gilles-Jean Portejoie font liste commune, soutenus par l’UDI et avec des adhérents UMP), la gauche essaie de se réunir autour d’Olivier Bianchi, 43 ans, l’adjoint à la culture investi par le PS après des primaires verrouillées en interne. Tous les sondages donnent gagnant cet homme d’appareil, ancien de l’UNEF-ID, élu depuis 25 ans, qui critique ouvertement le bilan de son maire dans les quartiers populaires : « Nous avons mis beaucoup d’argent dans l’ANRU pour ne faire que de l’urbanisme, pas de l’accompagnement des personnes. Nous avons joué l’ambiguïté avec les communautés, le clientélisme. »
Mais l’homme refuse de crier victoire, craint une abstention très forte, en particulier dans les classes populaires dont il a mesuré la défiance et la dépression lors des porte-à-porte, découvrant la force de frappe de « la rumeur », son SMS et la fracture avec l’école républicaine des familles musulmanes et pas seulement. « Clermont n’est pas en dehors de la France et du monde. Nous sommes dans un temps de régression, de remise en cause de la parole publique institutionnelle. »
Au marché de Montferrand, « le marché des quartiers nord », on interpelle les quelques candidats et militants présents qui tractent sur « la rumeur et la défiance envers l’école », UDI, Front de gauche et PS. Tous bottent en touche, s’agacent : « Ce n’est pas le problème, le problème, c’est l’emploi » ; « C’est un problème pour la presse parisienne ». Personne ne veut rebondir sur cette « bombe ». « Tout le monde est très mal à l’aise. Cela renvoie à des rapports culturels, familiaux, émotifs très intimes », avoue Olivier Bianchi.
Les SMS les plus troubles, eux, continuent de circuler dans les cités. Le dernier en date promet l’ouverture d’écoles privées musulmanes. Seher, la trentaine, cette maman turque que l’inspecteur d’académie n’a pas convaincue lors de la réunion d’information consacrée à l’ABCD de l’égalité, déterminée à retirer ses enfants un vendredi par mois, l’a reçu. Elle n’a pas son portable sur elle pour le montrer à ses copines mais « je vais vous l’envoyer, ce serait génial, nos enfants seront entre de bonnes mains comme dans les écoles catholiques »…
La boîte noire :Cette enquête a été réalisée ces trois dernières semaines. Toutes les personnes citées ont été rencontrées sur le terrain ou jointes par téléphone. Je me suis rendue à Clermont-Ferrand du 19 au 23 février et entretenue avec près d’une vingtaine de familles destinataires du SMS prônant la déscolarisation des enfants une fois par mois pour protester contre l’enseignement d’une prétendue théorie du genre dès la maternelle.
Le sujet étant extrêmement sensible, la plupart des personnes ont requis l’anonymat. Les prénoms suivis d’un astérisque sont des prénoms d’emprunt, à la demande des personnes interrogées. J’ai souhaité assister à la réunion de parents d’élèves organisée le vendredi 21 février dans l’un des groupes scolaires frappés par un fort absentéisme lors de la première journée de retrait de l’école mais le rectorat m’a opposé son refus, arguant une réunion interne à l’école qui n’était, par ailleurs, pas ouverte à l’ensemble des parents d’élèves, ce que beaucoup de parents ont déploré.