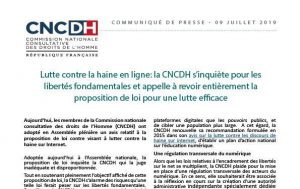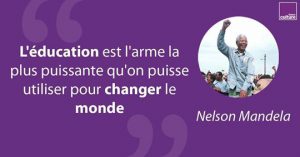Ce texte est issu du guide « Idées fausses sur la justice des mineurs : déminons le terrain ! 10 réponses pour en finir avec les préjugés ». Le texte complet est disponible à cette adresse.
Idée reçue n°1 : L’ordonnance du 2 février de 1945 [qui définit la justice des mineurs] n’est plus adaptée aux jeunes d’aujourd’hui
Le texte de 1945 […] a été profondément réécrit au gré des alternances politiques. 90% de ses 80 articles ont été modifiés et, pour certains, plusieurs fois.
Certes il n’y a jamais eu de refonte globale et le texte est complexe car composé d’un mille feuille de dispositions votées par à coups. Pour autant sa philosophie reste aujourd’hui d’actualité. Elle repose sur quelques idées simples : un mineur délinquant est un enfant en danger, plus que l’acte ce qui importe c’est le contexte du passage à l’acte, un mineur est un être en évolution, les réponses éducatives doivent précéder toute réponse coercitive, la procédure et les peines doivent protéger la vie privée du mineur et permettre sa réinsertion. Certes les infractions ont changé, les mineurs – et les majeurs – ne sont plus les mêmes. Pour autant, ces grands principes d’hier restent contemporains. Sauf à considérer qu’un enfant délinquant n’est plus un enfant [1].
Idée reçue n°2 : Les jeunes entrent dans la délinquance de plus en plus tôt
Les délinquants sont « de plus en plus jeunes et de plus en plus violents » : On lit et on entend cela depuis (au moins) la fin du 19ème siècle. On pourrait donc s’attendre à ce que, bientôt, les nourrissons braquent les banques ! Si certaines données font apparaître un rajeunissement des délinquants ces vingt dernières années, c’est parce que les prises en charge des mineurs délinquants se font de plus en plus tôt, et non parce qu’il y a désormais des braqueurs de banque dès la maternelle ! Exemple : le harcèlement mobilise aujourd’hui les pouvoirs publics dès l’école primaire, cela ne signifie pas que les comportements concernés soient nouveaux ni plus nombreux.
Quant à l’évolution des modes d’éducation parentale et des relations entre adultes (plus d’anonymat, moins de solidarité) qui conduit parfois à un relâchement des cadres éducatifs et un affaiblissement de l’autorité des adultes, elle n’est pas centrale en matière de délinquance. Les jeunes qui basculent durablement dans la délinquance sont déterminés par d’autres facteurs : carences affectives précoces, violences intrafamiliales, échec scolaire, facteurs collectifs d’entraînement dans le quartier, absence de perspective d’insertion…
Aujourd’hui comme hier, ces « carrières délinquantes » (au sens d’un engagement durable et assumé dans la délinquance) se fixent en moyenne vers l’âge de 15 ans. Le débat public se désintéresse d’une autre question autant sinon plus importante : quand est-ce que la délinquance s’arrête ? Le chômage de masse qui frappe les jeunes peu ou pas diplômés constitue un obstacle majeur à la réinsertion. Il est ainsi probable que l’on assiste non pas à un rajeunissement mais plutôt à un vieillissement de la délinquance.
Idée reçue n°3 : La justice des mineurs est lente
Pour juger un jeune en devenir il est essentiel de comprendre sa situation familiale et sa personnalité par une évaluation approfondie, et de lui permettre d’évoluer dans le cadre de mesures d’accompagnement : suivi éducatif , dispositifs permettant d’engager une formation professionnelle, de travailler sur des addictions (cannabis, alcool, jeux vidéos…), parfois placement. Un temps de maturation est nécessaire pour que le mineur prenne conscience des conséquences de son acte pour les victimes, pour son entourage et puisse s’interroger sur les raisons de cet acte, mal être, difficultés à gérer ses émotions, influence du groupe…
Une sanction n’a évidemment de sens pour le jeune et pour la société que si cette prise de conscience est intervenue, permettant une insertion sociale de l’intéressé et une lutte efficace contre la récidive. Tout cela prend du temps, d’autant que le manque de moyens de certains services éducatifs et tribunaux peut aboutir à ce que le tribunal pour enfants ait des difficultés à juger toutes ses affaires dans le délai souhaité. Mais si le jugement de l’affaire a lieu lui plusieurs mois après la commission des faits, une réponse rapide est toujours donnée au mineur : rappels à la loi pour les petites affaires, convocations remises par les services de police, présentation du mineur au juge à la sortie de la garde à vue.
La première rencontre avec un éducateur et un juge des enfants intervient au plus tard dans les semaines suivant l’interpellation et permet de reprendre avec le mineur les conséquences de son acte et d’instaurer une évaluation, une réparation ou un suivi éducatif. Le mineur est informé ce jour là que le jugement dépendra de son évolution dans les mois suivants. En cas de suivi éducatif, le mineur et sa famille doivent rencontrer le service dans les cinq jours. La réponse donnée par la justice des mineurs est donc rapide malgré la pauvreté des moyens attribués.
Idée reçue n°4 : La justice des mineurs est laxiste et inefficace
Le taux de réponse pénale est plus élevé pour les mineurs que pour les majeurs. La société ne tolère plus les incivilités et le parquet ne classe quasiment plus d’affaires sans suite pour les mineurs. Les mesures éducatives sont exigeantes et parfois s’enchaînent : réparation pénale, suivi éducatif, activité de jour, placement en foyer, ou en centre éducatif renforcé. De véritables peines sont régulièrement prononcées par les tribunaux pour enfants. Les enfants peuvent aller en prison à partir de 13 ans, et 4703 peines d’emprisonnement ferme ont été prononcées à leur encontre en 2015.
A ce jour plus de 700 mineurs sont incarcérés, et parfois pour de longues années. Récemment, une cour d’assises a rejeté l’excuse de minorité pour condamner à la réclusion criminelle à perpétuité… sous les applaudissements du public. Cependant si la justice pénale des mineurs est efficace, ce n’est pas parce qu’elle est de plus en plus sévère, c’est grâce à la spécialisation des intervenants, à la prévention, à la prise de risque et à la diversité des réponses.
Idée reçue n°5 : Les filles sont plus violentes et de plus en plus nombreuses à commettre des délits
Les médias, ces dernières années, semblent être unanimes à montrer l’évolution explosive et dramatique de la violence et de la délinquance juvéniles féminines. On assisterait là, au mieux, à un effet logique de la fin de la différence des sexes, au pire, à une crise morale si profonde que même les filles deviendraient des sauvageonnes. En regardant les statistiques sur un temps long on observe en fait que les femmes et les filles sont ultra-minoritaires dans les statistiques de la délinquance. Pour les mineures cela oscillent entre 10 % et 15 % des poursuites, et moins de 2% pour l’incarcération et ce de manière fort stable. Ces chiffres attestent davantage des inflexions des politiques pénales que de l’évolution des illégalismes réellement commis.
L’annonce des chiffres de la délinquance féminine juvénile depuis 2010 témoigne surtout d’un emballement médiatique qui confine à la « panique morale ». En réalité, la violence des filles fait régulièrement événement dans l’histoire ce qui prouve qu’elle a toujours existé – elle est alors perçue comme une nouvelle menace. L’émotion que suscite son surgissement est à la hauteur de son invisibilité sociale, laquelle est avant tout la conséquence d’une domination politique. Reconnaître aux filles la possibilité de se comporter avec violence, ce serait aussi leur reconnaître un statut dans la cité.
Idée reçue n° 6 : Les enfants roms sont tous des voleurs
En Île-de-France, selon la police, sur l’ensemble des voleurs mineurs, ceux qui vivent en bidonville seraient 400. Rapporté au nombre d’enfants vivant dans la région en bidonville, qui ne sont pas tous des Roms, ce chiffre représente 5 à 10 %. La très grande majorité des enfants Roms, donc, ne sont pas des voleurs. Quand on étudie de plus près le phénomène des mineurs voleurs en Île de France, on s’aperçoit qu’ils viennent de quelques quartiers ou villages particuliers. Il y a ainsi 34 groupes en région parisienne, connus des services de police, qui pratiquent l’exploitation de jeunes enfants, les contraignant à la mendicité, au vol. On est là face à un phénomène de traite, comme il en existe dans d’autres populations, et qui devrait être combattu comme tel.
Mais la tendance est de plus en plus à considérer qu’on ne saurait être à la fois délinquant et en danger. Aucun mineur victime de vol forcé n’a jusqu’à présent été reconnu comme victime ! Et lorsque l’une de ces petites victimes est découverte, la « réponse » pénale apportée est généralement l’incarcération… non de l’adulte coupable d’avoir poussé, obligé au vol, mais de l’enfant ! Les enfants Roms victimes d’exploitation restent pour la plupart d’entre eux sans protection, ce qui permet d’entretenir le mythe, régulièrement réactivé, du Rom par nature voleur.
Idée reçue n°7 : Les jeunes délinquants sont tous originaires des quartiers populaires
Il existe plusieurs formes de délinquance juvénile :
 La délinquance « initiatique », qui implique des préadolescents et des adolescents originaires de tous les milieux sociaux, qui n’ont pas nécessairement de problèmes familiaux ni scolaires, mais qui, souvent sous la pression du groupe, commettent des transgressions. Bagarres, vols, dégradations… Les faits sont rarement graves mais cela concerne une bonne partie d’une classe d’âge.
La délinquance « initiatique », qui implique des préadolescents et des adolescents originaires de tous les milieux sociaux, qui n’ont pas nécessairement de problèmes familiaux ni scolaires, mais qui, souvent sous la pression du groupe, commettent des transgressions. Bagarres, vols, dégradations… Les faits sont rarement graves mais cela concerne une bonne partie d’une classe d’âge.
 La délinquance « pathologique », qui concerne au contraire une petite minorité de jeunes qui ont des problèmes d’équilibre psychologique et de contrôle des émotions. Les causes sont d’ordre familial, elles s’enracinent dans diverses formes de carences et/ou de traumatismes vécus durant l’enfance (carences affectives précoces, violences psychologiques, physiques et/ou sexuelles…). Les psychologues en parlent mieux que les sociologues. Ces pathologies peuvent se rencontrer également dans tous les milieux sociaux mais elles sont plus fréquentes dans les familles pauvres car, comme l’ont montré de nombreuses études, la précarité désinsère les individus des normes et des rythmes de la vie sociale, elle les enferme dans leurs problèmes personnels et elle exacerbe les conflits conjugaux et familiaux.
La délinquance « pathologique », qui concerne au contraire une petite minorité de jeunes qui ont des problèmes d’équilibre psychologique et de contrôle des émotions. Les causes sont d’ordre familial, elles s’enracinent dans diverses formes de carences et/ou de traumatismes vécus durant l’enfance (carences affectives précoces, violences psychologiques, physiques et/ou sexuelles…). Les psychologues en parlent mieux que les sociologues. Ces pathologies peuvent se rencontrer également dans tous les milieux sociaux mais elles sont plus fréquentes dans les familles pauvres car, comme l’ont montré de nombreuses études, la précarité désinsère les individus des normes et des rythmes de la vie sociale, elle les enferme dans leurs problèmes personnels et elle exacerbe les conflits conjugaux et familiaux.
 La délinquance « d’exclusion », qui concerne les grands adolescents et les jeunes adultes qui font véritablement carrière dans la délinquance, quelque part entre 15 et 30 ans, et qui constituent la « clientèle » ordinaire des services de police et de justice. Les jeunes de ce type sont clairement surreprésentés dans les quartiers populaires des villes et dans les familles pauvres des villages. La raison principale est qu’ils cumulent deux exclusions sociales. La première est l’exclusion scolaire (ce sont des jeunes précocement en échec), la seconde l’exclusion économique (ce sont des jeunes qui n’ont pas de véritables perspectives d’insertion professionnelle donc d’intégration sociale).
La délinquance « d’exclusion », qui concerne les grands adolescents et les jeunes adultes qui font véritablement carrière dans la délinquance, quelque part entre 15 et 30 ans, et qui constituent la « clientèle » ordinaire des services de police et de justice. Les jeunes de ce type sont clairement surreprésentés dans les quartiers populaires des villes et dans les familles pauvres des villages. La raison principale est qu’ils cumulent deux exclusions sociales. La première est l’exclusion scolaire (ce sont des jeunes précocement en échec), la seconde l’exclusion économique (ce sont des jeunes qui n’ont pas de véritables perspectives d’insertion professionnelle donc d’intégration sociale).
Idée reçue n°8 : Les mineurs étrangers isolés trichent sur leur situation
Le climat de suspicion qui sévit depuis plusieurs années en France tend à faire de tous les étrangers des fraudeurs dont le seul souci serait de profiter des avantages que leur procurerait leur statut. Les mineurs n’échappent pas à ces stéréotypes honteux, et pourtant… Le recours aux tests osseux est aujourd’hui la méthode la plus utilisée pour déterminer l’âge des mineurs qui sollicitent la prise en charge par l’État au titre de l’enfance en danger. Ils consistent essentiellement en une radiographie du poignet et de la main gauche de l’intéressé et une comparaison de ce document à un atlas de référence élaboré dans les années 1930 à partir de radiographies d’enfants et d’adolescents américains blancs issus de classes moyennes.
La liste est longue des institutions qui ont dénoncé le manque de fiabilité de ces tests osseux, dont il est avéré qu’ils intègrent une marge d’erreur d’au moins 18 mois [2]. D’ailleurs, les conclusions des rapports médicaux s’expriment toujours sous la forme d’une fourchette approximative « entre 17 et 22 ans ». Sage précaution mais lourde de conséquences, puisque selon que le juge retient la fourchette basse ou la fourchette haute, la minorité du jeune est reconnue ou non et sa prise en charge acceptée ou rejetée.
L’autre élément qui peut amener à considérer que le jeune « ment » repose sur l’examen des actes d’état civil qu’il présente. Souvent, les papiers détenus par le jeune sont considérés, à priori, comme faux, alors même qu’ils sont rédigés selon la forme en usage dans le pays concerné. Par ailleurs et dans tous les cas, la charge de la preuve en cas de contestation relative à un acte d’état civil étranger repose sur l’administration, c’est à dire sur la partie qui conteste la validité de l’acte. Dans les faits, le jeune mineur se trouve pourtant sommé de démentir les accusations de « falsification » dont il fait l’objet, alors même que de par sa situation même, il est souvent bien démuni pour entreprendre de telles démarches.
Idée reçue n°9 : La menace de peines lourdes peut enrayer la délinquance juvénile
L’idée commune selon laquelle un durcissement des peines permettrait de réduire la délinquance s’appuie entre autres sur une théorie criminologique dite « de la dissuasion ». Celle-ci postule que l’on peut empêcher quelqu’un de commettre un délit ou un crime par la crainte de ses conséquences. Cette représentation du délinquant est pourtant très éloignée des formes les plus concrètes de l’engagement (et du désengagement) des adolescents dans des carrières délinquantes.
Comme le concluait il y a maintenant plus de soixante ans la première vaste enquête sur le devenir des jeunes autrefois dits « anormaux », menée entre 1947 et 1950 par des psychiatres de l’enfance, les principaux facteurs de non engagement ou de désengagement de la délinquance sont à rechercher du côté des « événements de la vie » : mariage, possibilité d’étude, travail, etc. Ces résultats, inédits à l’époque mais aujourd’hui corroborés par de nombreux travaux sociologiques consacrés aux déviances et à la délinquance juvénile, ont justifié la mise en place d’un modèle de justice qui devait être prioritairement fondé, non sur la punition ou la menace de la punition, mais sur le suivi des jeunes aussi proche que possible de leur milieu habituel de vie, de manière à les accompagner dans leur passage vers la vie adulte.
Les travaux menés en sociologie de la prison permettent d’enfoncer le clou : loin de dissuader, l’incarcération tend, au contraire, à consolider l’identité délinquante de jeunes en quête de repères, tout en faisant obstacle, par la stigmatisation qu’elle produit, aux opportunités de réinsertion. Ainsi doit-on comprendre l’une des principales ambitions de l’ordonnance du 2 février 1945, consistant à inscrire dans le droit la nécessité d’une réflexion sur les origines socio-économiques et psychosociales de la délinquance juvénile.
Idée reçue n°10 : Un passage par la prison apportera aux jeunes un cadre et les remettra dans le droit chemin
Si le nombre de mineurs incarcérés reste globalement stable, la privation de liberté a pris de l’ampleur ces dernières années avec le basculement de certaines prises en charge du milieu ouvert sur des structures plus ou moins fermées. Le nombre de placements annuels en centres éducatifs fermés montre la place croissante accordée à l’enfermement dans la justice des mineurs, qui n’échappe pas au vent répressif qui souffle sur la justice pénale en général. Il semble ainsi admis que, pour certains, une incarcération permettra de mettre un coup d’arrêt à une carrière délinquante.
Mais le pédopsychiatre Boris Cyrulnik met en garde : si une coupure peut être utile, la prison est « la pire des réponses : elle provoque l’isolement sensoriel, l’arrêt de l’empathie, l’augmentation de l’angoisse, entretient les relations toxiques, l’humiliation ». Pour la juge des enfants Laurence Bellon, « concentrer en un même lieu une population uniquement constituée d’adolescents délinquants pose de très grandes difficultés ».
Des difficultés de prise en charge d’abord : proposer un travail éducatif individualisé dans un environnement où le collectif est omniprésent et entravé par des contraintes pénitentiaires s’avère compliqué. Ainsi, les mineurs détenus au Quartier mineurs de Fleury Mérogis n’ont en moyenne que deux à trois heures de cours par semaine et « une majorité reste en cellule une vingtaine d’heures par jour », précise une éducatrice de l’établissement.
Si les moyens investis dans les établissements pénitentiaires pour mineurs (EPM) créés par la loi de 2002 sont beaucoup plus conséquents, avec une prise en charge pluridisciplinaire, l’accompagnement se heurte tout de même à une logique pénitentiaire et à des contraintes organisationnelles importantes. Surtout, avec des durées de détention majoritairement inférieures à trois mois, l’impact sur la trajectoire des jeunes ne peut être que limité. « Le risque est de voir les enfants prendre les habitudes du milieu carcéral », pointe une éducatrice.
Un milieu carcéral est avant tout caractérisé par la violence, où les tensions et rapports de forces sont exacerbés. Un ancien détenu témoigne ainsi d’une ambiance tendue « toujours dans la provocation. Qui va s’imposer, être le plus gros caïd, qui a commis le pire ? » Au final, l’incarcération va le plus souvent avoir tendance à accélérer l’ancrage dans la délinquance : elle fragilise les liens familiaux, socialise dans un milieu criminogène, y confère un statut, etc. Selon une étude sur les sortants de prison, le taux de re-condamnation dans les cinq ans des mineurs est de l’ordre de 70%, plus élevé encore que chez les majeurs (63%).
| Auteur.es : Christophe Daadouch (juriste), Laurent Mucchielli (sociologue), Odile Barral (présidente du tribunal pour enfants de Toulouse), Eric Bocciarelli (magistrat à Nancy), Véronique Blanchard (éducatrice à la PJJ), Violaine Carrere (Gisti), Guy Hardy (assistant social), Françoise Dumont (présidente de la ligue des droits de l’homme), Nicolas Sallée (sociologue), Cécile Marcel (directrice de l’observatoire international des prisons). |
 Les « Idées fausses sur la justice des mineurs » sont une initiative soutenue par les syndicats FSU et UGFF-CGT, la Ligue des droits de l’Homme, l’Observatoire international des prisons, le Syndicat des avocats de France et le Syndicat de la magistrature. Le texte original est disponible à cette adresse.
Les « Idées fausses sur la justice des mineurs » sont une initiative soutenue par les syndicats FSU et UGFF-CGT, la Ligue des droits de l’Homme, l’Observatoire international des prisons, le Syndicat des avocats de France et le Syndicat de la magistrature. Le texte original est disponible à cette adresse.
 Illustration : Cc Jared Rodriguez / t r u t h o u t
Illustration : Cc Jared Rodriguez / t r u t h o u t