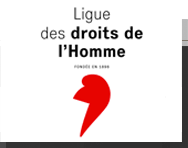Attention! Ne pas confondre cireurs de chaussures avec cireur de pompes des médias!
Boulots de merde : « On revient à une économie de type féodale, une économie de la domesticité »
30 NOVEMBRE 2016 / Bastamag
Produire ou servir plus, avec moins : c’est l’injonction faite à tous les travailleurs, des chaînes de montage automobiles aux couloirs des hôpitaux, en passant par les salles de classe ou les bureaux de poste. A la souffrance de ces boulots dégradés, s’ajoute la précarité grandissante de travailleurs qui quittent le salariat pour la « liberté » de l’auto-entrepreunariat. Une violence sociale féroce dans laquelle les journalistes Julien Brygo et Olivier Cyran ont plongé pour écrire leur ouvrage Boulots de merde. Ils y décrivent l’âpre quotidien de celles et ceux qui exercent des métiers difficiles et souvent utiles, à comparer avec certains boulots très bien payés et plutôt confortables, mais qu’ils jugent socialement nuisibles. Entretien.
Basta ! : Le titre de votre livre, Boulots de merde, se réfère au texte de l’anthropologue David Graeber sur les « bullshit jobs » [1]. Il y décrit les métiers absurdes qu’induit le capitalisme financier, tels que ceux exercés par les avocats d’affaire, lesquels s’ennuient prodigieusement au travail. Mais pour vous, les bullshit jobs ne concernent pas que les cols blancs, loin s’en faut. Pourquoi ?
Julien Brygo et Olivier Cyran [2] : Nous avons été séduits par cette idée de David Graeber selon laquelle, dans le capitalisme financier, des millions d’individus sont employés à ne rien faire d’utile, comme effectivement les avocats d’affaire : ils sont bien payés et très reconnus socialement, mais ils s’ennuient tellement au travail qu’ils passent leur temps à télécharger des séries ou à réactualiser leur page Facebook. Ceci dit, il nous semble que les « vrais » boulots de merde, ce sont quand même plutôt ceux qui sont exercés en bas de l’échelle sociale dans les secteurs du nettoyage, de la restauration, de la livraison à domicile, de la distribution de prospectus publicitaires, etc. Bref : des métiers pénibles où l’on paie de sa personne, qui participent à la croissance du PIB et à la baisse des chiffres du chômage.
Nous pouvons y ajouter les boulots « utiles » comme les infirmières, les professeurs ou les facteurs, dont les conditions se sont tellement dégradées qu’ils deviennent vraiment « merdiques » eux aussi. Nous avons voulu incarner ces vies et tracer un lien avec les gestionnaires de patrimoine et autres héros financiers tels que les journalistes boursiers, qui exercent des métiers nuisibles socialement : les gestionnaires de patrimoine font partie des organisateurs de ce qui est appelé béatement « l’optimisation fiscale » et qui prive la collectivité des recettes de l’impôt.
« À la faveur de l’entassement des richesses dans les mains d’une élite de plus en plus dodue et capricieuse, le secteur des tâches domestiques où l’on s’abaisse devant son maître se répand », dites-vous. Pouvez-vous détailler ?
Entre 1995 et 2010, dans le monde, le nombre de travailleuses domestiques a grimpé de plus de 60 %. 52 millions de femmes exercent ces « métiers ». Cette hausse correspond à la montée des inégalités. On revient à une économie de type féodale, une économie de la domesticité dans laquelle les plus riches sous-traitent leur confort en employant une nounou, ou bien une, deux ou trois bonnes. Le tout avec le soutien de l’État puisque, par exemple, la gauche plurielle de Lionel Jospin a instauré en France le subventionnement de tous ces métiers via les crédits d’impôts.
Des métiers que l’on croyait disparus, parce que réservés à une époque de semi-esclavagisme, refont leur apparition, comme les cireurs de chaussures, parfois avec l’étiquette « économie sociale et solidaire ». Suite à un appel à projets lancé en 2012 dans le département des Hauts-de-Seine, sous l’égide de Jean Sarkozy, le réseau « les Cireurs » a ainsi obtenu 50 000 euros de subvention au titre de « l’aide à l’économie sociale et solidaire ». Fondé par une diplômée d’école de commerce, ce réseau réunit des individus qui, en contrepartie du droit d’usage de l’enseigne (censée appâter le chaland), acceptent d’être auto-entrepreneurs. Pas d’indemnités en cas d’arrêt maladie, aucun droit aux allocations chômage.
Au lieu d’un salaire, le cireur touche un cachet horaire sur lequel il doit payer lui même une taxe de 23 %. De son côté, la structure démarche des centres commerciaux pour leur vendre l’implantation de ses « artisans cireurs ». Les cireurs paient de leur poche le matériel et l’habillement. S’ils n’ont pas les moyens d’investir, ils peuvent obtenir un prêt accordé par l’association pour le droit à l’initiative économique à un taux d’intérêt compris entre 6 et 8 % ! Au final, la rémunération du cireur est maigre, sa précarité totale. Mais on nous vend un métier « renouvelé », avec des gens qui travaillent « pour eux », sous prétexte qu’ils ne sont pas salariés.
« Je ne gagne pas un Smic, ça c’est clair », dit un cireur de chaussures que vous citez. Mais les auto-entrepreneurs ne sont pas les seuls à travailler à bas coût. Vous expliquez que des millions de salariés travaillent bien en-deçà du Smic.
On entend partout que le Smic c’est « l’ennemi de l’emploi ». Mais le Smic n’existe plus depuis longtemps. Il existe de nombreuses manières de passer outre le salaire minimum. Par exemple, le CDI à temps partiel, avec la pré-quantification du temps de travail. C’est ce qui a été négocié par les géants de la distribution de prospectus publicitaires, Adrexo et Médiapost. Les salariés que nous avons rencontrés travaillent 30% de plus en moyenne que ce qui est indiqué sur leur contrat, et que ce qui leur est payé. Un couple de retraités touchait à peine trois euros de l’heure, soit deux fois et demi moins que le Smic ! La convention collective de la restauration est un autre moyen de faire travailler les gens gratuitement : les heures supplémentaires ne sont pas payées. Résultat ? Les salariés sont payés 24 heures, et en font 60. Le reste étant – parfois – payé au black. Dans les secteurs où la France est championne – le tourisme, la grande distribution, l’hôtellerie-restauration… –, il y a au moins deux millions d’emplois payés entre 25 et 80 % du Smic !
Il y a en fait une vraie fascination du patronat pour le travail gratuit, et les dirigeants politiques s’empressent de leur donner des outils juridiques qui légalisent cette gratuité : prenons le service civique payé deux fois moins qu’un Smic – et même seulement 1/10ème du Smic pour l’employeur – ; ou encore le contrat de professionnalisation auquel recourt beaucoup la grande distribution : pour 150 heures de formation théorique – qui consiste en fait à remplir des rayons ou à faire du nettoyage – l’entreprise touche 2 250 euros par contrat. Le dispositif coûte des millions d’euros aux contribuables chaque année.
Y a-t-il là une spécificité française ?
La grande distribution, c’est une spécialité française. Et le secteur est friand de boulots dégradés. Le projet Europacity (immense centre commercial à proximité de Paris, ndlr), du groupe Mulliez et de sa filiale Immochan, c’est la promesse de 10 000 boulots de merde. Autre secteur passionné par cette économie du « larbinat » : le tourisme. Dans les Alpes, des vallées entières sont de véritables réservoirs à larbinat : tout le monde travaille pour les quelques privilégiés qui peuvent se payer des sports d’hiver. Il y a des contrats prévus pour les CDI à temps partiels, les intermittents, les apprentis, les stagiaires, etc. Précisons que la France est aussi championne du monde des anti-dépresseurs et des médicaments, notamment pour supporter tous ces travaux infernaux.
Le secteur privé n’est pas le seul à malmener les travailleurs. Les fonctionnaires sont eux aussi essorés par les « restructurations » de services et les suppressions de postes en pagaille. Que vous-ont raconté les fonctionnaires que vous avez rencontrés ?
L’obsession pour la réduction des effectifs est un drame. Tout le monde semble s’accorder pour dire qu’il est important de réduire le chômage. C’est constamment dans la bouche des responsables politiques. Mais la phrase d’après, c’est : « Je m’engage à virer 500 000 fonctionnaires ». Parce qu’ils n’arrivent pas à se figurer que des métiers qui ne dégagent pas de marge financière puissent néanmoins être utiles. Tout doit être « rentable ». Nous payons des années de convergence idéologique entre les élites politiques et les détenteurs du capital. Les gens chargés de « réorganiser » drastiquement le CHU de Toulouse, où nous avons fait un reportage, sortent d’écoles de commerce. Ils ont officié chez Carrefour, Pimkie et Danone. Ils se retrouvent à gérer sur ordinateur de l’humain, alors qu’ils ne connaissent que les chiffres.
Les aides soignantes et les infirmières sont censées remplir des chiffres bêtement sans se poser de questions. Elles doivent soigner tant de malades en une journée, peu importent les spécificités des personnes malades ou les imprévus. Elles ont tant à faire en si peu de temps que leur travail est devenu impossible (Ndlr : lire notre article sur le sujet : Sauver des vies en temps de crise : le difficile quotidien des infirmiers). En fin de journée, elles sont épuisées et complètement stressées parce qu’elles ne savent plus si elles ont posé correctement telle perfusion, donné tel médicament à la bonne personne au bon moment…
Tous les services publics sont touchés par cette recherche de rentabilité. Les facteurs se sont ainsi transformés en vendeurs de systèmes de télésurveillance, ou en promeneurs de chiens. L’objectif est de soutirer de l’argent à cette importante manne financière que sont les vieux en France. Cela porte évidemment atteinte à la dignité des facteurs, qui ont toujours aidé les plus anciens au cours de leurs tournées, mais gratuitement ! Les policiers de leur côté sont devenus des machines à gazer des manifestants ou des réfugiés. Certains en ressentent un certain malaise. Être obligé de reconduire tant de migrants à la frontière chaque année, cela n’est pas sans conséquences mentales sur les personnes.
Vous expliquez que tous ces « remaniements » de services publics sont inspirés du « lean management », une méthode élaborée dans les années 1950 au Japon par les ingénieurs de Toyota, et revue par le très libéral Massachusetts Institute of Technology (MIT) aux États-Unis au début des années 1990. Comment cela se traduit-il dans le monde du travail ?
Le « lean management » est devenu la marotte des directions de ressources humaines, et s’immisce et se propage dans tous les secteurs du monde du travail : dans les multinationales ou les services publics, chez les gros industriels et les sous-traitants. Il consiste à imposer aux salariés de faire plus avec moins, en s’attaquant notamment à tous les temps morts : les pauses jugées superflues, les respirations qualifiées d’improductives, toutes les minutes qui ne sont pas « rentables ». Dans nos reportages, tout montre que les travailleurs n’arrivent pas à faire face à cette intensification du travail. Ce qu’on leur impose en terme de rythme et d’objectifs n’a plus de sens. Nous nous dirigeons vers un état de souffrance au travail généralisée. Il y a des vagues de suicides partout. Et on parle là des secteurs de la santé ou de l’éducation : ce sont des secteurs fondamentaux de notre vie sociale.
Tout cela ne se fait-il pas avec le prétendu assentiment des salariés, que l’on somme de participer au changement organisationnel ?
Si. C’est toute la perfidie du « lean management ». On donne aux salariés l’illusion qu’ils peuvent changer le système ; en fait on les oblige à accepter de se faire humilier. C’est le principe de la bonne idée rémunérée chez PSA : 300 euros pour l’idée simple, 500 euros pour la super idée, 1 000 euros pour l’excellente idée. On fait croire aux salariés qu’ils sont d’accord et qu’ils valident le système. Alors que c’est faux, bien entendu. Neuf salariés sur dix pensent qu’ils ont besoin de plus de collègues, et de plus de temps pour pouvoir bien faire les choses. Un infirmer de Toulouse nous a expliqué qu’il a besoin de moins de produits anesthésiants lorsqu’il prend le temps de parler avec ses patients avant de les endormir. Mais ce n’est pas du tout intégré par la nouvelle organisation. Il doit faire vite, endormir tant de patients en une journée, peu importe si pour cela il doit consommer plus de produits. Toute cette organisation du travail a des effets criminels : il y a eu quatre suicides cet été à l’hôpital de Toulouse.
En France, la « loi travail », qui a fait l’objet d’une intense mobilisation durant l’année 2016, a-t-elle pour conséquence d’entériner ces méthodes ?
Avec cette loi, qui vise à faire passer le code du travail au second plan, on s’éloigne encore davantage du principe « une heure travaillée = une heure payée ». Elle est taillée sur mesure pour les entreprises qui veulent en finir avec le salariat. L’article 27 bis précise par exemple qu’il n’y a pas de lien de subordination entre les plate-formes de mise en relation par voie électronique comme Uber et les auto-entrepreneurs qui travaillent pour elles. C’est ce lien qui définit le salariat et permet entre autres aux travailleurs d’aller aux Prud’hommes faire valoir leurs droits. On désarme complètement les travailleurs, alors qu’ils subissent un vrai lien de subordination – ce sont les plate-formes qui leur donnent du travail, évaluent les travailleurs et les sanctionnent – sans les compensations garanties par le statut salarié.
Un livreur à vélo pour une « appli » de repas à domicile le souligne dans notre livre :« Pour arriver à un salaire intéressant, il faut travailler une soixantaine d’heures par semaine. Sur ce revenu, il faut payer environ 23% d’impôts au titre de l’auto-entrepreneuriat. L’arnaque totale. T’es taxé alors que eux, tes patrons, ils ne paient aucune cotisation sociale. » Les livreurs sont incités à aller très vite, quitte à frôler les accidents, étant donné qu’ils sont payés à la course. Et celui qui tombe de son vélo, il se fait non pas virer, mais « éliminer ». Il « quitte le jeu », en quelque sorte. Il ne touche plus aucun salaire, ni aucune indemnité. C’est un système d’une violence incroyable, qui se fait passer pour cool, jeune et dynamique. Les livreurs n’ont pas le droit au scooter, ils ne doivent rouler qu’à vélo – qu’ils doivent se procurer eux-mêmes – parce que cela donne une image écolo à l’entreprise…
Vous reprochez aux médias leur complicité avec ces conceptions très libérales du travail…
Les médias jouent un rôle central dans la diffusion de cette idée sous-jacente que la précarisation est nécessaire. Il faut travailler pour avoir une existence sociale quels que soient l’emploi et les conditions de travail. Le fait de donner chaque mois les chiffres du chômage nous plonge dans une vision statisticienne du monde, avec cet objectif de faire baisser le chômage quoi qu’il en coûte. Les journalistes relaient avec beaucoup de zèle cette idée selon laquelle « mieux vaut un mauvais travail que pas de travail du tout ». Cela devient légitime d’accepter un boulot de merde simplement parce qu’il est proposé. Évidemment, pour rien au monde les journalistes ne feraient ces boulots de merde. Nous avons là une vision de classe.
Les médias jouent aussi beaucoup avec la culpabilisation du chômage, en répétant sans cesse à quel point c’est honteux de ne pas travailler, et en enchaînant les « Une » sur les avantages de l’auto-entreprenariat. Nous sommes étonnés de constater, même autour de nous, à quel point les gens ont honte de dire qu’ils touchent des prestations sociales. Alors que cet argent, les gens l’ont cotisé, via leurs boulots antérieurs. Ce sont des garde-fous qui ont été mis en place pour éviter que des gens ne tombent dans la misère totale.
Les médias sont par ailleurs très sévères quand ils décrivent les luttes sociales, comparant volontiers les grévistes avec des preneurs d’otages, ou les manifestants avec des casseurs. Entre ces jugements très négatifs et la répression qui va grandissante, les luttes collectives peuvent-elles se faire une place, et redonner du sens au travail ?
Il nous semble que le patronat va tout faire pour imposer l’idée selon laquelle il faut qu’on accepte cette société de mini-jobs, sans salaire minimum, avec des contrats « modernes », c’est-à-dire au rabais, davantage proche de l’auto-entrepreunariat que du salariat avec ses « acquis » sociaux qu’ils jugent « insupportables ». Au niveau juridique et législatif, tout est bouché. L’inspection du travail est attaquée de front. Les procédures prud’hommales engendrent parfois plus de cinq ans d’attente – et de paperasse – pour obtenir réparation et se faire rembourser l’argent volé. C’est un combat très inégal.
La criminalisation des mouvement sociaux et la répression des luttes collectives répondent à l’obsession politique clairement formulée qui vise à désarmer la CGT : ils veulent empêcher les travailleurs de reprendre le contrôle de leur travail et d’exercer leur capacité de nuisance sociale afin d’inverser un rapport de force. Cela indique que le patronat et ses relais politiques sont prêts à un affrontement, qu’ils exigent même la violence de cet affrontement.
Ils veulent faire sauter les derniers verrous, ils veulent une société sans filets, où quelques privilégiés auront accès à des métiers survalorisés socialement et correspondant même à des compétences, tandis qu’en bas, ils poseront les jalons d’une société de logisticiens du dernier mètre payés à la tâche, esclaves des machines et de l’auto-exploitation auquel le capitalisme les auront assignés presque naturellement. Et lorsque le logisticien sera remplacé, il pourra toujours louer sa maison, sa guitare, sa voiture, pourquoi pas vendre père et mère, pour ne pas sombrer dans la misère ni « vivre avec la honte » d’être un « assisté ». On va sans doute aller vers une radicalisation des mouvements sociaux. Avec une grande répression derrière. C’est la seule possibilité pour le libéralisme économique de continuer à structurer nos vies : par la force.
Propos recueillis par Nolwenn Weiler
 Julien Brygo et Olivier Cyran, Boulots de merde, du cireur au trader. Enquête sur l’utilité et la nuisance sociale des métiers, éditions La Découverte, septembre 2016, 240 pages.
Julien Brygo et Olivier Cyran, Boulots de merde, du cireur au trader. Enquête sur l’utilité et la nuisance sociale des métiers, éditions La Découverte, septembre 2016, 240 pages.
Ldh91-R.André