Au nom de la lutte contre les « loups solitaires » et le départ de Français pour le djihad en Syrie, les députés s’apprêtent à voter un projet de loi qui, en voulant censurer des sites faisant « l’apologie du terrorisme » et sanctionner « la préparation » d’un attentat sur internet, restreindra aussi les libertés numériques et offrira de nouveaux pouvoirs aux forces de police.
C’est en urgence que les députés entament, lundi 14 septembre, l’examen d’un projet de loi de lutte contre le terrorisme destiné à lutter contre le nouvel « ennemi intérieur », « sans doute la menace la plus importante » pesant sur la France, au prix d’un coup de canif sans précédent dans les libertés numériques. Un texte qui a de fortes chances de passer sans coup férir malgré la mobilisation d’un collectif rassemblant La Quadrature du net, la Ligue des droits de l’homme, Reporters sans frontières, le Syndicat de la magistrature… et les fortes réserves du Conseil national du numérique.
Face à la multiplication des faits divers impliquant des « loups solitaires », ce terroriste isolé, auto-radicalisé sur internet et ayant combattu à l’étranger, le ministre de l’intérieur a en effet demandé une procédure accélérée pour ce texte présenté comme vital pour arrêter le départ à l’étranger de Français partis pour combattre avec les islamistes. Tout d’abord incarné par Mohamed Merah, l’auteur des tueries de Toulouse de 2012 et formé aux côtés d’al-Qaïda en Afghanistan, ce terroriste d’un nouveau type est devenu, avec l’enlisement de la guerre en Syrie, la priorité numéro un du gouvernement. « Nous n’avons jamais été confrontés à un tel défi », martelait le 3 juin dernier le premier ministre Manuel Valls.
Ces derniers mois, quasiment pas une semaine ne passe sans que la presse relate le cas d’un de ces Français partis mener le djihad contre le régime de Bachar al-Assad. Au mois d’avril dernier, à l’occasion de la libération des quatre journalistes retenus en otages en Syrie, le ministre des affaires étrangères Laurent Fabius affirmait ainsi que plusieurs de leurs geôliers parlaient « français ». Le 6 juin, plusieurs médias révélaient que l’un d’entre eux ne serait autre que Mehdi Nemmouche, auteur du quadruple meurtre du Musée juif de Bruxelles du 24 mai dernier. Et le lendemain, Libération affirmait même qu’il projetait de commettre « une attaque à la Merah » 14 juillet dernier, une information toutefois démentie par le ministère de l’intérieur.
Difficile de connaître le danger réel que représentent pour la France ces djihadistes. Régulièrement, le gouvernement avance des chiffres parfois très précis et souvent incohérents. Au mois de janvier, Manuel Valls les estimait à 700, dont 150 en transit. Au mois d’avril, Laurent Fabius évoquait quant à lui le chiffre de 500 combattants français. En juin, Manuel Valls avançait cette fois « le nombre de 800 Français ou citoyens résidant en France qui sont concernés par la Syrie, soit parce qu’ils y combattent, soit parce qu’ils y sont morts – une trentaine –, soit parce qu’ils en sont revenus, soit parce qu’ils veulent y aller ». « Il s’agit de surveiller des centaines et des centaines d’individus français ou européens qui aujourd’hui combattent en Syrie », poursuivait le ministre qui se disait convaincu qu’il y a, en France « plusieurs dizaines de Merah potentiels ».
Le 22 juillet dernier, le ministre de l’intérieur Bernard Cazeneuve donnait aux parlementaires une comptabilité plus détaillée : « En six mois, les effectifs combattants sont passés de 234 à 334, comprenant au moins 55 femmes et 7 mineurs ; le nombre des individus plus généralement impliqués dans les filières djihadistes, en incluant les personnes en transit, celles qui sont de retour en France et les individus ayant manifesté des velléités de départ, est passé de 567 à 883 sur la même période, soit une augmentation de 56 %. Ces chiffres sont comparables à ceux constatés dans d’autres pays de l’Union européenne ; ils montrent la gravité du phénomène ; ils nous obligent à prendre les mesures qui s’imposent pour l’endiguer. »
Face cette menace aussi diffuse que médiatisée, le gouvernement a décidé de s’attaquer à ce qui serait l’un des outils vitaux de ces nouveaux terroristes : internet. C’est en effet sur des sites islamistes que ces jeunes Français s’auto-radicaliseraient et c’est sur des forums que les recruteurs de l’État islamique les enrôleraient. Internet – où l’on peut si facilement apprendre à fabriquer une bombe et commander des produits explosifs – serait également devenu incontournable dans la préparation même des attentats.
Ainsi, sur les dix-huit articles que compte le projet de loi une moitié d’entre eux visent, directement ou indirectement, internet.
L’article 4 s’attaque plus globalement à la liberté d’expression en proposant de réformer la loi de 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse prévoyant un régime spécial pour certaines infractions. Désormais, les infractions d’apologie et de provocations aux actes de terrorisme seront sanctionnées par un nouvel article du code pénal, le 421-2-5, par une peine de cinq années d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
Cet article, comme d’autres du projet de loi, pose le problème de la relativité de la notion « d’apologie » du terrorisme. Si les cas médiatiques mis en avant par le gouvernement relèvent incontestablement du terrorisme, ce texte s’appliquera à bien d’autres groupes radicaux qu’islamistes. Or, en fonction des régimes, même démocratiques, la définition de « terroriste » peut très sensiblement varier. Un site de soutien au groupe de Tarnac, un blog indépendantiste ou de soutien à un mouvement palestinien pourraient très bien être considérés par certains responsables politiques comme faisant « l’apologie du terrorisme ». Outre les dangers qu’il représente en matière de liberté d’expression et de droit l’information, ce texte menace plus particulièrement internet où les peines sont aggravées et passent à sept années de prison et 100 000 euros d’amende.
« L’entreprise terroriste individuelle » et « l’apologie du terrorisme »
L’article 5 consacre la figure du « loup solitaire » en ajoutant un autre article au code pénal, le 421-2-6, sanctionnant « l’entreprise terroriste individuelle ». Celui-ci est censé permettre l’interpellation du suspect dès la phase de « préparation » de l’attentat. Dans la première version du texte, le législateur avait défini cette notion particulièrement vague par « le fait de détenir, de rechercher, de se procurer ou de fabriquer des objets ou des substances de nature à créer un danger pour autrui ». Mais devant les risques de voir sanctionnés des internautes ayant effectué de simples recherches sur internet, la commission des lois a amendé l’article. Désormais, pour matérialiser l’infraction, il faudra un deuxième élément : « recueillir des renseignements relatifs à un lieu, à une ou plusieurs personnes », recevoir « un entraînement ou une formation » « au maniement des armes », « à la fabrication ou à l’utilisation d’explosifs » ou « au pilotage d’aéronefs » mais également « consulter habituellement un ou plusieurs services de communication au public en ligne provoquant directement à la commission d’actes de terrorismes ou en faisant l’apologie ».
Ainsi, une personne qui aurait visité régulièrement des sites considérés par les autorités comme faisant « l’apologie du terrorisme » et possédant chez lui des produits chimiques pouvant servir à la fabrication d’explosif tomberait sous le coup de cet article. Or, de nombreux produits chimiques entrant dans la composition d’explosifs artisanaux sont en vente libre et utilisés pour d’autres applications, comme le peroxyde d’hydrogène, utilisé dans l’imprimerie, l’agriculture, l’aéronautique ou encore comme désinfectant.
Visiblement conscients des risques en terme de droit à l’information qu’implique l’article 5, les députés ont exclu de son champ d’application les consultations de sites qui résultent « de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public, intervient dans le cadre de recherches scientifiques ou est réalisée afin de servir de preuve en justice. Ainsi, ce nouveau délit ne pourra entraver le travail des journalistes ou des chercheurs universitaires », précise l’exposé des motifs du texte. Restent les cas des « non professionnels », juste passionnés ou curieux. Enfin, cet article pose la question de la pénalisation d’une simple intention et de l’arrestation préventive d’une personne en vertu d’une liste de signes extérieurs de culpabilité, au risque de placer dans l’illégalité de nombreux internautes simplement curieux, ou passionnés cherchant uniquement à s’informer ou à se documenter.
L’article 9 relance un débat récurrent, celui du blocage des sites internet faisant l’apologie du terrorisme par une autorité administrative sur le modèle du dispositif existant pour les sites pédophiles. Le projet de loi prévoit la création d’une autorité administrative chargée d’établir une liste des sites qu’elle considère comme faisant l’apologie du terrorisme et dont elle souhaite voir interdire l’accès depuis la France. Pour cela, cette autorité sera aidée par une personne qualifiée désignée par la Cnil (commission nationale de l’informatique et des libertés) et qui sera chargée « de vérifier que les contenus dont l’autorité administrative demande le retrait ou que les sites dont elle ordonne le blocage sont bien contraires aux dispositions du code pénal sanctionnant la provocation au terrorisme, l’apologie du terrorisme ou la diffusion d’images pédopornographiques ». Ce représentant de la Cnil n’aura qu’un pouvoir de recommandation mais pourra « saisir la juridiction administrative » « si l’autorité administrative ne suit pas » son avis.
Cette disposition est sans doute celle qui est la plus critiquée, et pas seulement par les associations de défense des libertés. Saisi au mois de juin dernier par Bernard Cazeneuve, le Conseil national du numérique (CNNum) avait rendu, au mois de juillet, un avis sévère sur cet article, dénonçant un dispositif « techniquement inefficace », « inadapté aux enjeux de la lutte contre le recrutement terroriste » et n’offrant pas « de garanties suffisantes en matière de libertés ». Le CNNum soulignait par ailleurs qu’il existe « des alternatives plus efficaces et protectrices ». Le 10 septembre, le directeur général de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi), Guillaume Poupard, s’est lui-même dit « très réservé sur ces mesures d’un point de vue technique » et a affirmé avoir « signalé le problème de l’efficacité de ces mesures ».
L’article 10 modifie les règles régissant l’accès à un système informatique dans le cadre d’une perquisition en ajoutant un alinéa à l’article 57-1 du code de procédure pénale afin de permettre à la police de saisir les données stockées hors du domicile du suspect, par exemple sur un « cloud ». Jusqu’à présent l’accès à « des données intéressant l’enquête en cours » devait se faire depuis « un système informatique sur les lieux où se déroule la perquisition ». Désormais, cet accès peut se faire depuis « un système informatique implanté dans les locaux d’un service ou d’une unité de police ou de gendarmerie ».
L’article 11 offre de nouveaux pouvoirs aux policiers face au chiffrement des données, pratique permettant de communiquer et de stocker ses données en toute sécurité, particulièrement en vogue depuis les révélations d’Edward Snowden. Le texte autorise les officiers de policier judiciaire à faire appel à « toute personne qualifiée pour mettre au clair des données chiffrées ».
L’article 12 sort de la stricte lutte contre le terrorisme en aggravant les peines prévues contre les hackers. Le texte introduit la qualification « en bande organisée » comme circonstance aggravante des atteintes aux systèmes automatisés de données. La crainte des hacktivistes est que cette nouvelle infraction permette de réprimer, comme des terroristes, les militants qui, tels les Anonymous, s’organisent pour bloquer l’accès à un site lors de manifestations virtuelles.
L’article 15, enfin, modifie le code de la sécurité intérieure pour porter de 15 à 30 jours la durée de conservation des interceptions de sécurité dont le régime avait été fortement étendu par la loi de programmation militaire.
Un «tournant dans l’institution de sociétés de la suspicion»
Ce tour de vis sécuritaire sans précédent sur internet a suscité la mobilisation des principales associations de défense des libertés sur internet : La Quadrature du net, la Ligue des droits de l’homme, Reporters sans frontières, le Syndicat de la magistrature ou encore l’April. Réunies au sein d’un collectif, elles ont lancé au début du mois de septembre une « campagne citoyenne » accompagnée d’un site, Presumes-terroristes.fr, proposant une analyse détaillée du projet de loi et incitant les internautes à contacter leur député.
Celui-ci a également été l’objet de vifs débats à l’Assemblée nationale au sein de la Commission de réflexion et de propositions sur le droit et les libertés à l’âge du numérique, composée de parlementaires et de personnalités du monde de l’internet. Dans une contribution publiée sur l’édition participative de Mediapart consacrée aux travaux de cette commission, « Libres enfants du numérique », le cofondateur de la Quadrature du net, et membre de la commission, Philippe Aigrain s’est livré à une analyse, article par article, du texte. « Le risque principal qui pèse sur le débat en séance plénière sur le projet de loi terrorisme à venir à l’Assemblée nationale est celui d’une prise d’otage de la délibération du fait de l’invocation d’une urgence sécuritaire », écrit-il. « Le projet de loi manifeste une exploitation de la situation pour faire passer des dispositions réclamées depuis longtemps par certains services de sécurité et de police, en particulier en matière du contournement du judiciaire », poursuit Philippe Aigrain. « Il met par ailleurs en place une dissuasion et une répression préventive des « parcours de radicalisation » qui est un véritable tournant dans l’institution de sociétés de la suspicion. (…) Il est non seulement légitime mais indispensable de prendre en compte les dérives qui peuvent résulter des dispositions proposées, dans d’autres situations dépassant leur objet initialement affiché. C’est pourquoi il me paraît nécessaire d’appeler les députés qui auront à débattre du PJL terrorisme à la mi-septembre à prendre le recul indispensable sur ce texte. La représentation nationale ne peut être contrainte par l’invocation d’un impératif sécuritaire à accepter d’adopter des mesures contestables dans leur efficacité et inacceptables dans leurs conséquences. »
Ce véritable réquisitoire a valu à Philippe Aigrain une réponse virulente du président socialiste de la commission des lois de l’Assemblée nationale, Jean-Jacques Urvoas. « Est-il encore possible de légiférer sereinement pour adapter le dispositif judiciaire français de lutte antiterroriste ? » se plaint le député, dénonçant une « accumulation de tant de formules polémiques, d’explications dogmatiques et d’analyses simplificatrices, parfois même simplistes ». Au-delà du débat juridique, l’élu, ardent défenseur du projet de loi, assume les restrictions de libertés contenues dans ce texte. Et les justifie par les nouvelles menaces que feraient peser sur la sécurité nationale ces nouveaux terroristes. « Si nos adversaires s’adaptent en permanence en faisant évoluer les modalités de leurs interventions, à la fois pour se dissimuler, pour échapper à nos services de sécurité, et par conséquent à la justice », affirme Jean-Jacques Urvoas, « il semble logique, si nous voulons être efficaces, que nous adaptions nos propres outils. » « La démocratie est à la fois forte et fragile », estime-t-il. « Forte de la vitalité inépuisable de ses principes et fragile face aux messages sans paroles que sont les attaques terroristes (…). Nous ne saurions donc les affronter avec une main liée dans le dos. »
Cette approche sécuritaire d’internet est largement partagée sur les bancs de l’Assemblée nationale. Et il y a de fortes chances pour que le projet de loi sur le terrorisme soit adopté sans modification substantielle, comme le fut au mois de décembre dernier la loi de programmation militaire qui avait déjà élargi l’accès des services de renseignements français aux données des opérateurs de communications électroniques, des fournisseurs d’accès à Internet et des hébergeurs de sites. Malgré, déjà, une forte mobilisation des associations, des réticences du CNNum et l’opposition de quelques députés, le texte avait finalement été adopté par 164 voix contre 146.
Un espoir subsiste cependant concernant le blocage des sites internet, sujet sur lequel l’exécutif aurait été sensible aux multiples critiques. En fin d’année 2013, le gouvernement avait déjà tenté d’imposer ce filtrage de sites internet dans le cadre de l’examen du projet de loi de lutte contre la prostitution. Mais il avait finalement fait marche arrière en retirant cette mesure à la dernière minute. Deux amendements visant l’article 9 ont déjà été déposés. L’un déposé par des députés du groupe écologiste vise tout simplement à annuler cette disposition. L’autre, déposé les élus UMP Lionel Tardy et Laure de La Raudière, propose de réintroduire le juge judiciaire dans la décision de blocage. « Seul un juge doit pouvoir ordonner le blocage d’un site internet à l’issue d’un débat contradictoire, qui peut très bien être mené en urgence en la forme des référés », suggèrent les députés.
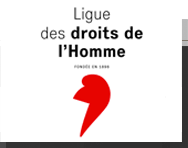
 06 80 34 67 73
06 80 34 67 73


