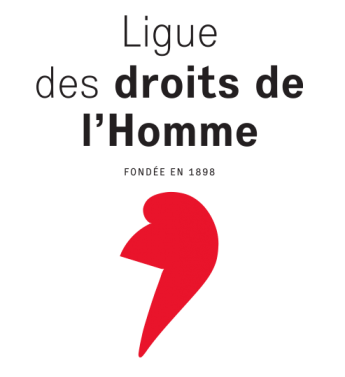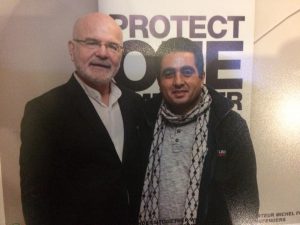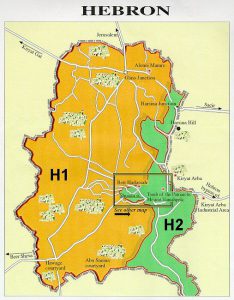A l’automne 2017, la plupart des Français ont découvert avec surprise la vigueur du processus indépendantiste en Catalogne et la réaction violente de l’État espagnol. Début juin 2018, les principaux leaders indépendantistes sont toujours en prison préventive ou en exil. Mais la motion de censure votée au Parlement espagnol contre Mariano Rajoy (Parti populaire, PP) et l’élection de Pedro Sanchez (Parti socialiste ouvrier espagnol, PSOE) pour former un nouveau gouvernement donnent l’occasion de faire le point sur la situation de la démocratie en Catalogne et en Espagne.
La tradition catalane contre l’héritage du franquisme
Il est sans doute utile de rappeler brièvement aux lecteurs français que l’histoire de l’Espagne et de la France sont par certains aspects très différents et que par conséquent, la spécificité catalane ne peut pas s’apprécier en y projetant les catégories franco-françaises. La Catalogne s’adosse à une profondeur historique séculaire pour manifester avec constance des formes d’autonomie, se concrétisant notamment dans l’institution de la Generalitat, son rejet du pouvoir central castillan (et autoritaire) et de la monarchie Bourbon héritée du roi de France Louis XIV. La Catalogne revendique avec fierté sa tradition démocratique et républicaine, sa culture littéraire, artistique et commerciale et sa langue propre. Au contraire du processus vécu en France, où la 3e République a éradiqué les langues régionales, certes violemment, mais dans un cadre intégrateur et globalement démocratique, l’État espagnol, pour administrer les différentes composantes de la péninsule ibérique, n’a jamais bénéficié d’un cadre ni démocratique, ni républicain, sur une longue durée. Le démantèlement de l’empire colonial espagnol a donné lieu à une succession de soubresauts monarchiques et dictatoriaux. Jusqu’aux dernières années, l’expérience de la démocratie a toujours été courte et achevée dans la violence. Au 20e siècle, l’éphémère 2e République – proclamée en 1931 et qui tentait, entre autres, une forme de reconnaissance des différentes autonomies catalane, basque et galicienne notamment – a été renversée par le coup d’État militaire mené par le Général Franco (1936). Après une guerre civile meurtrière, Franco a instauré une dictature qui a duré une quarantaine d’années, jusqu’à sa mort en 1975. Pendant cette longue dictature, toutes les formes d’autonomie sont niées et en Catalogne, par exemple, la langue catalane est interdite dans l’espace public. Ainsi, l’affirmation de l’identité catalane est un moyen d’incarner et la résistance et la république contre la dictature.
Le régime actuel est issu directement d’un compromis délicat entre les héritiers directs du général Franco (notamment, le roi Bourbon qu’il a rétabli sur son trône, l’armée, la hiérarchie de l’église catholique et les créateurs du parti politique qui deviendra le PP) et les représentants de l’opposition (les partis de gauche issus de la République et les partis nationalistes périphériques, catalans notamment). La volonté de ne pas rouvrir les blessures du passé, d’éviter une nouvelle guerre civile et la perspective de réinsérer l’État espagnol dans un nouveau cadre démocratique européen se sont traduites dans une construction constitutionnelle faisant l’équilibre entre d’un côté, le maintien de l’ordre par la monarchie et de l’autre côté, le pluralisme politique et la reconnaissance d’autonomies à géométrie variable. La justice espagnole est encore aujourd’hui marquée par ce double héritage. Certaines juridictions et la hiérarchie des différents parquets sont directement issues de la dictature alors que certains juges luttent contre leurs institutions pour faire prévaloir une justice indépendante du pouvoir politique.
Au contraire de la situation française, où la constitution est régulièrement amendée en fonction des évolutions politiques (24 révisions constitutionnelles entre 1958 et 2008, dont 19 depuis 1992), la révision de la constitution espagnole est considérée comme un tabou. La constitution de 1978 semble cristallisée et toute proposition de modification semble susceptible de porter atteinte à l’équilibre magique de la transition démocratique, de rouvrir les plaies du passé et d’exposer l’État espagnol à de graves dangers. La constitution espagnole a été révisée seulement 2 fois.
Le rejet du statut de la Catalogne comme déclencheur du processus indépendantiste
Alors que précédemment, des référendums ont été organisés dans les communautés autonomes (et notamment, en Catalogne, pour l’adoption du projet de nouveau statut de la Catalogne, en 2006), et que d’autres États (comme le Royaume-Uni, pour l’Ecosse, en 2014) ont organisé des référendums d’autodétermination, celui de la Catalogne a été jugé anticonstitutionnel par le tribunal constitutionnel, ce qui pose une importante difficulté politique et a justifié la répression depuis quelques mois.
Comment en est-on arrivé à la situation de l’automne 2017 ? Il s’agit d’assurément d’une crise du régime espagnol doublé par une profonde remise en question citoyenne sur le mode de fonctionnement politique de l’État central.
En 2006, un nouveau statut de la Catalogne est adopté après négociations entre le gouvernement Zapatero en Espagne et les institutions politiques catalanes, approbation par le parlement catalan et par le parlement espagnol et ratification par un referendum du peuple catalan.
En 2010, après une mobilisation du PP mené par Mariano Rajoy, le nouveau statut est jugé anticonstitutionnel par le tribunal constitutionnel. Émerge alors en Catalogne la volonté d’affirmer un « droit à décider » (principe d’autodétermination) qui se manifeste par de gigantesques marches pacifiques. L’indépendantisme, jusqu’alors très minoritaire, devient une option politique pour de plus en plus de citoyen-ne-s. Une succession de déclarations au parlement, d’élections anticipées et de tentatives de consultations du peuple catalan sont organisées entre 2010 et 2017. Les indépendantistes catalans deviennent majoritaires pour la première fois au parlement catalan. Entre temps, une grave crise économique a affecté l’État espagnol et ses communautés autonomes et Mariano Rajoy est arrivé au pouvoir à Madrid. M. Rajoy reste sourd à toutes les demandes de négociation de la part des autorités de la Catalogne. La montée de l’indépendantisme en Catalogne lui permet de mobiliser en retour le nationalisme espagnol contre le séparatisme. Le nationalisme est également utilisé pour tenter de faire oublier les affaires de corruptions qui ont touché, de façon généralisée, le PP au pouvoir à Madrid et aussi à son niveau, l’ancienne coalition catalaniste Convergencia i Unió, au pouvoir à Barcelone.
Conformément au mandat donné par les élections anticipées de septembre 2015, les nouvelles autorités catalanes organisent le 1er octobre 2017 un référendum d’autodétermination. Conformément à son engagement d’empêcher toute consultation mettant en péril l’unité de l’Espagne, M. Rajoy interdit le référendum. Une importante mobilisation de milliers de citoyen-ne-s anonymes permet la tenue du vote, malgré la répression violente des forces de sécurité espagnoles. Un millier de blessé-e-s sont dénombré-e-s. Les images de la police matraquant sans discernement des personnes voulant juste « voter » font le tour du monde.
Une révolution pacifique et républicaine réprimée dans le silence de l’Europe
Les événements s’enchaînent. D’un côté, les indépendantistes catalans se prévalent de la répétition des votes et des mobilisations pacifiques en faveur de leur projet pour demander un dialogue, refusé par Madrid, une médiation européenne, refusée par Bruxelles, puis enfin proclamer une déclaration unilatérale d’indépendance, sans reconnaissance internationale. De l’autre côté, M. Rajoy commence par nier qu’un référendum ait eu lieu avant de saisir l’opportunité de la déclaration d’indépendance pour activer l’article 155 de la constitution et pour destituer le gouvernement catalan, prendre le contrôle de la Generalitat, dissoudre le parlement catalan et convoquer de nouvelles élections en Catalogne.
Parallèlement, la machine judiciaire s’active pour réprimer les leaders indépendantistes catalans : arrestation de Jordi Sanchez et Jordi Cuixart, responsables associatifs, dès la mi-octobre, puis, début novembre, de certains membres du gouvernement catalan, notamment Oriol Junqueras, vice-président catalan et Joaquim Forn, en charge de l’intérieur. Le président de la Generalitat, Carles Puigdemont, part en exil en Belgique avec d’autres conseillers. Les charges pesant contre les responsables catalans sont très lourdes : rébellion, sédition, malversation de fonds pour l’organisation du processus indépendantiste.
Début juin 2018, J. Sanchez, J. Cuixart, O. Junqueras et J. Forn sont toujours en prison préventive depuis plus de 7 mois. Cinq autres responsables politiques sont également emprisonné-e-s depuis le 23 mars ou d’autres encore se sont exilées dans plusieurs pays européens. Rappelons que la seule violence qui a été perpétrée l’a été par les forces de sécurité espagnole et qu’au contraire, les responsables associatifs et politiques catalan-e-s emprisonné-e-s (ou en exil) ont toujours mis en avant une stratégie strictement pacifique et politique. C’est la mobilisation citoyenne non-violente qui s’est exprimée massivement et de manière répétée ces dernières années que l’on tente de museler par les poursuites judiciaires.
Le 21 décembre 2017, les élections au parlement catalan sont marquées par une très forte participation et donnent une nouvelle fois une courte majorité en sièges aux listes indépendantistes. Néanmoins, il a fallu plus de 5 mois pour que cette majorité électorale puisse se concrétiser. En effet, les entraves mises par le gouvernement Rajoy, les poursuites menées contre certain-e-s élu-e-s (en prison ou en exil) ont différé à plusieurs reprises l’élection d’un nouveau président de la Generalitat et ensuite, la composition de son nouveau gouvernement. Joaquim Torra a finalement été élu le 14 mai et le gouvernement catalan est finalement entré en fonctions le 2 juin, le jour même de la motion de censure contre M. Rajoy.
Une nouvelle étape ?
Le remplacement de M. Rajoy par P. Sanchez, la levée de l’article 155 et d’un nouveau gouvernement en Catalogne marquent incontestablement un changement d’étape. Mais sur le fond, les problèmes posés politiquement par la volonté d’indépendance d’une partie importante de la population catalane restent sans solution politique immédiate. Le traitement qui en a été donné par l’État espagnol jusqu’à présent est plutôt de nature judiciaire et policière. Les principaux leaders indépendantistes sont tous en prison ou en exil, menacés de lourdes peines de prison (30 ans pour le motif de rébellion). C. Puigdemont a été brièvement arrêté en Allemagne et reste sous le coup d’un mandat d’arrêt européen. Les justices écossaise, belge, allemande et suisse ont chacune été saisies par la justice espagnole pour remise des responsables catalan-e-s poursuivi-e-s. Jusqu’à présent, elles n’y ont pas donné suite mais la situation demeure incertaine.
P. Sanchez est arrivé à renverser M. Rajoy en coalisant des groupes politiques dont le seul accord a été de mettre un terme au gouvernement Rajoy. C’est le jugement de l’affaire Gürtel touchant à un énorme scandale de corruption publique mettant en cause le PP qui a déclenché la décision du PSOE de renverser M. Rajoy. Mais la nouvelle coalition regroupe à la fois le PSOE (qui a soutenu l’application de l’article 155 en Catalogne et annonce vouloir appliquer le budget récemment adopté par la droite), Podemos et Compromis (gauche alternative, qui défend l’idée d’une issue politique au conflit catalan par l’organisation d’un référendum), Nueva Canarias et le Parti nationaliste basque (qui ont dénoncé le 155 mais soutenu le budget de droite préparé par le PP) et les partis indépendantistes basque (EH-Bildu) et catalans (ERC, gauche républicaine catalane et PDeCat, centre droit). Ainsi, l’émergence d’une réponse cohérente au problème catalan n’est pas garantie.
A terme, l’organisation de nouvelles élections générales en Espagne pourrait redistribuer les cartes. Avant le vote de la motion de censure contre M. Rajoy, les sondages laissaient présager une victoire relative du parti nationaliste espagnol Ciudadanos, que d’aucuns qualifient en France de centre-droit mais qui défend en Espagne des positions conservatrices en matière sociale et culturelle, néolibérales en économie et réactionnaires vis-à-vis des revendications périphériques.
Face au mouvement citoyen catalan, globalement pacifique et républicain, l’État espagnol n’a pour le moment opposé qu’une réponse autoritaire et violente. La question qui est posée maintenant est de retrouver les voies du dialogue. Pour cela, la libération des prisonniers politiques et la levée des poursuites contre les responsables politiques et associatifs catalan-e-s est une première exigence. La deuxième exigence est de donner une réponse politique et d’ouvrir la voie vers une consultation du peuple catalan sur son avenir.