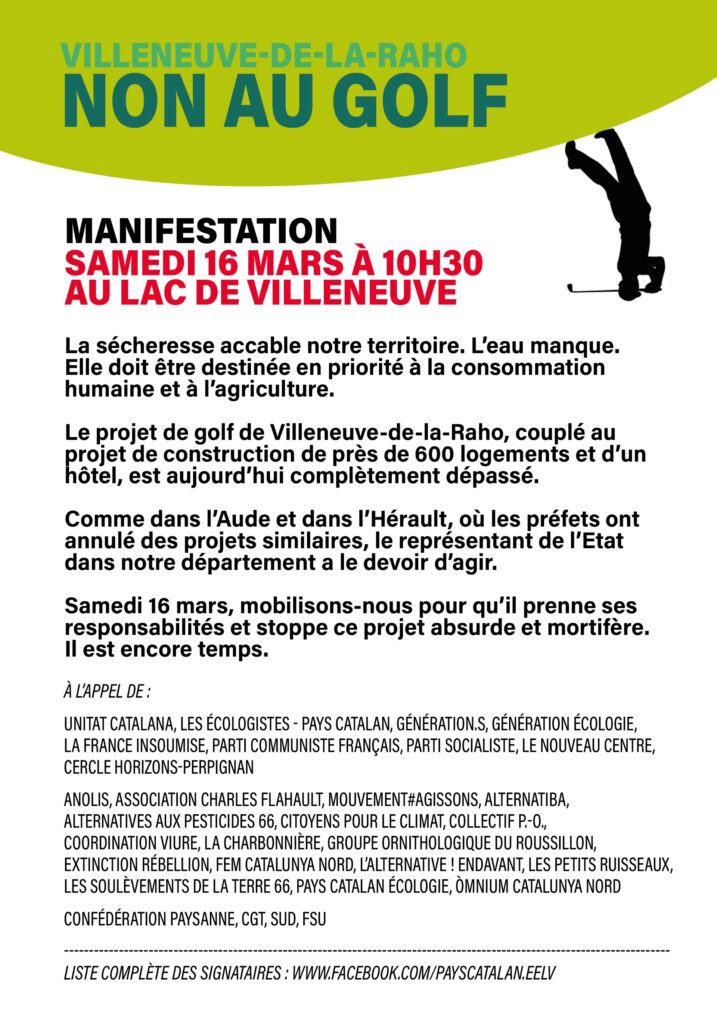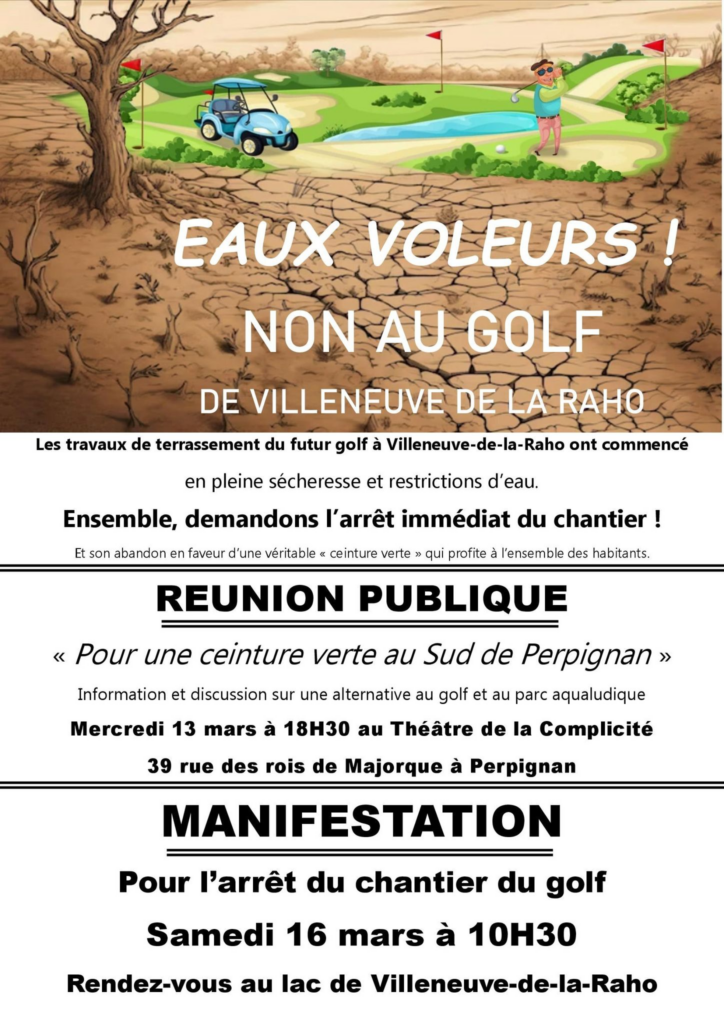Communiqué de presse de la LDH
Malgré la sècheresse dans les Pyrénées orientales, la Fédération Française de golf soutient un projet de golf 18 trous à Villeneuve de la Raho, commune où le lac est asséché et la réserve écologique menacée.
92 universitaires de Perpignan dénoncent dans une tribune un projet hors-sol.
La LDH appelle les citoyen.ne.s à s’opposer massivement à ce projet destructeur de l’environnement et de la biodiversité.
Samedi 16 mars manifestons nombreux pour l’arrêt du chantier du golf à l’appel de nombreuses associations.
Rendez-vous samedi 16 mars à 10h30 au lac de la Raho
La section de Perpignan et des Pyrénées orientales