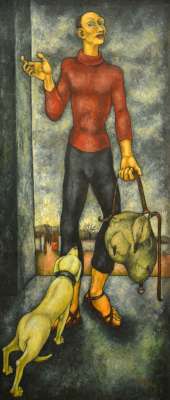Le 10 mai, nous célèbrons l’abolition de l’esclavage.
L’occasion d’éclairer une partie de notre histoire commune avec Haïti-Saint Domingue.
Saint Domingue en 1791 est une colonie française, dont 90% des habitants sont esclaves, et parmi ceux-ci, une majorité sont nés en Afrique, déportés par la traite. Depuis 1789, la promesse d’égalité contenue dans la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen a fait son chemin. Les esclaves se révoltent. Le 29 aout 1793 Toussaint LOUVERTURE déclare « Je veux que la liberté et l’égalité règnent à Saint Domingue ». L’esclavage est aboli localement à Saint Domingue.
Le 4 février 1794, «La Convention nationale déclare aboli l’esclavage dans toutes les colonies ; en conséquence, elle décrète que tous les hommes, sans distinction de couleur, domiciliés dans les colonies, sont citoyens français, et jouiront de tous les droits assurés par la Constitution.».
En 1801, Napoléon décide d’une expédition vers Saint Domingue et l’esclavage est rétabli le 20 mai 1802. Toussaint LOUVERTURE est fait prisonnier et déporté. La résistance des anciens esclaves et libres de couleur, unifiée au sein de l’Armée Indigène, triomphe avec une victoire décisive en novembre 1803. Les troupes françaises capitulent et évacuent Saint-Domingue.

En 1825, le 17 avril, Charles X, roi de France concède par ordonnance, aux habitants de la partie française de Saint-Domingue, l’indépendance pleine et entière. Cette partie Française prendra le nom d’Haïti. Mais il y a une condition : il faut dédommager les propriétaires d’esclaves. Le dédommagement demandé est de 150 millions de Francs Or. « cette somme représente environ 2% du revenu national français de l’époque, soit l’équivalent de plus de 40 milliards d’euros aujourd’hui si l’on considère une même proportion du revenu national de 2018 »1.
La jeune république Haïtienne n’a pas les moyens de payer. Elle doit emprunter. « Les créditeurs français sont parvenus à extraire du pays l’équivalent de 5% du revenu national Haïtien, par an , en moyenne ».2
Cette dette, avec les intérêts a maintenu « Haïti dans une position de dépendance et freiné son développement, transformant la brutalité de la colonisation et du système esclavagiste en une dépendance prolongée à l’égard de son ancienne métropole »
Le 17 avril, c’est le 20ème anniversaire de la « rançon d’Haïti ».
A cette occasion nous demandons au Président de la République de demander pardon au peuple haïtien au nom de la France pour plus de cent ans de colonisation, de traite et d’esclavage, et pour l’injustice redoublée qu’a été ensuite pour lui l’imposition de cette « double dette » qu’il a intégralement remboursée, à force de sacrifices.
Il doit aussi engager la France à agir en faveur d’Haïti dans un esprit de réparation, d’abord pour aider le pays à sortir de la crise actuelle, et ensuite pour l’accompagner sur le chemin de sa reconstruction.
Voir la lettre commune adressée en ce sens au Président de la République
Le 17 avril, le Président Macron a reconnu le poids injuste pour Haïti de cette dette imposée par la France en 1825. Il a institué une commission mixte institué mixte franco-haïtienne ayant pour mission d’explorer deux siècles d’histoire, y compris l’impact de l’indemnité de 1825 sur Haïti. A suivre….
Bernard Leclerc
Cet article est paru d’abord dans le numéro 103 de la lettre mosellane des droits de l’homme
1 Thomas PIKETTI Capital et idéologie Seuil p 263
2 La double dette d’Haïti (1825-2025) Note de la fondation pour la mémoire de l’esclavage