ASSEZ DE PROJETS DESTRUCTEURS DÉFENDUS PAR ALIOT ET LES PROMOTEURS IMMOBILIERS – À L’APPEL DES ORGANISATIONS PROGRESSISTES DU DÉPARTEMENT DONT LA LDH
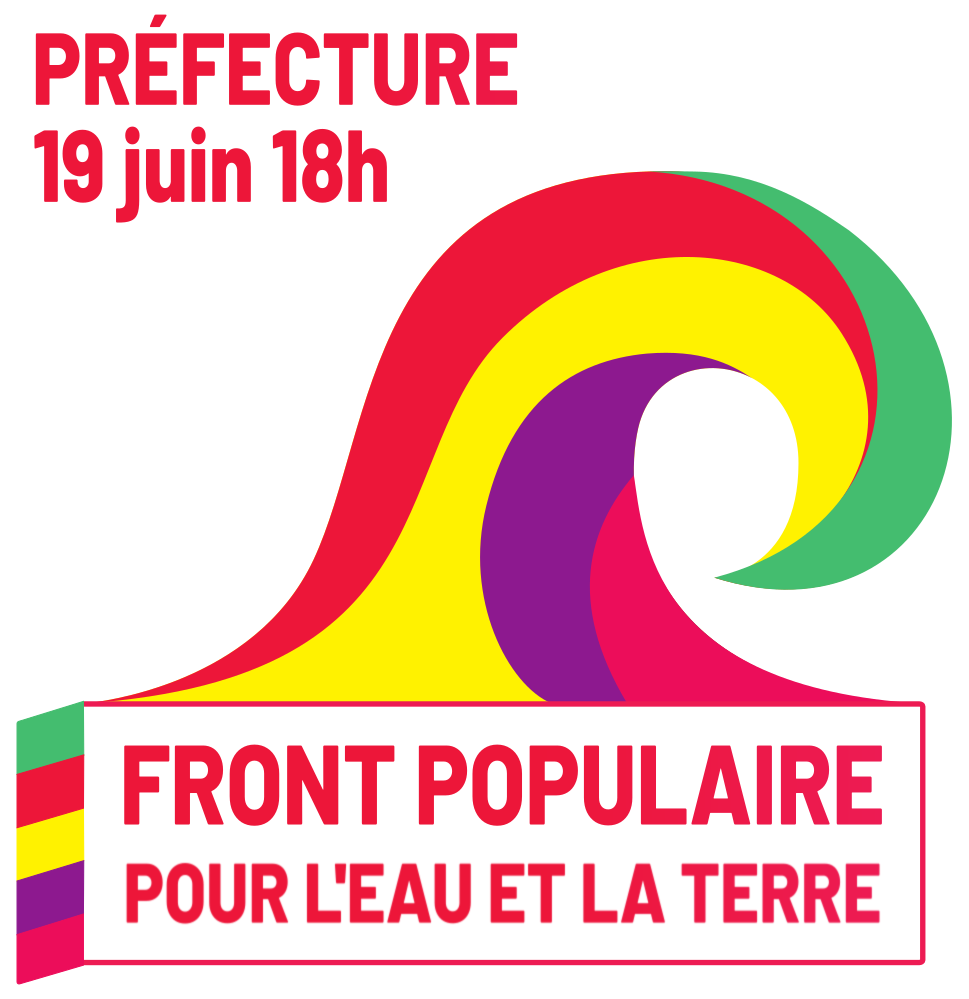
ASSEZ DE PROJETS DESTRUCTEURS DÉFENDUS PAR ALIOT ET LES PROMOTEURS IMMOBILIERS – À L’APPEL DES ORGANISATIONS PROGRESSISTES DU DÉPARTEMENT DONT LA LDH
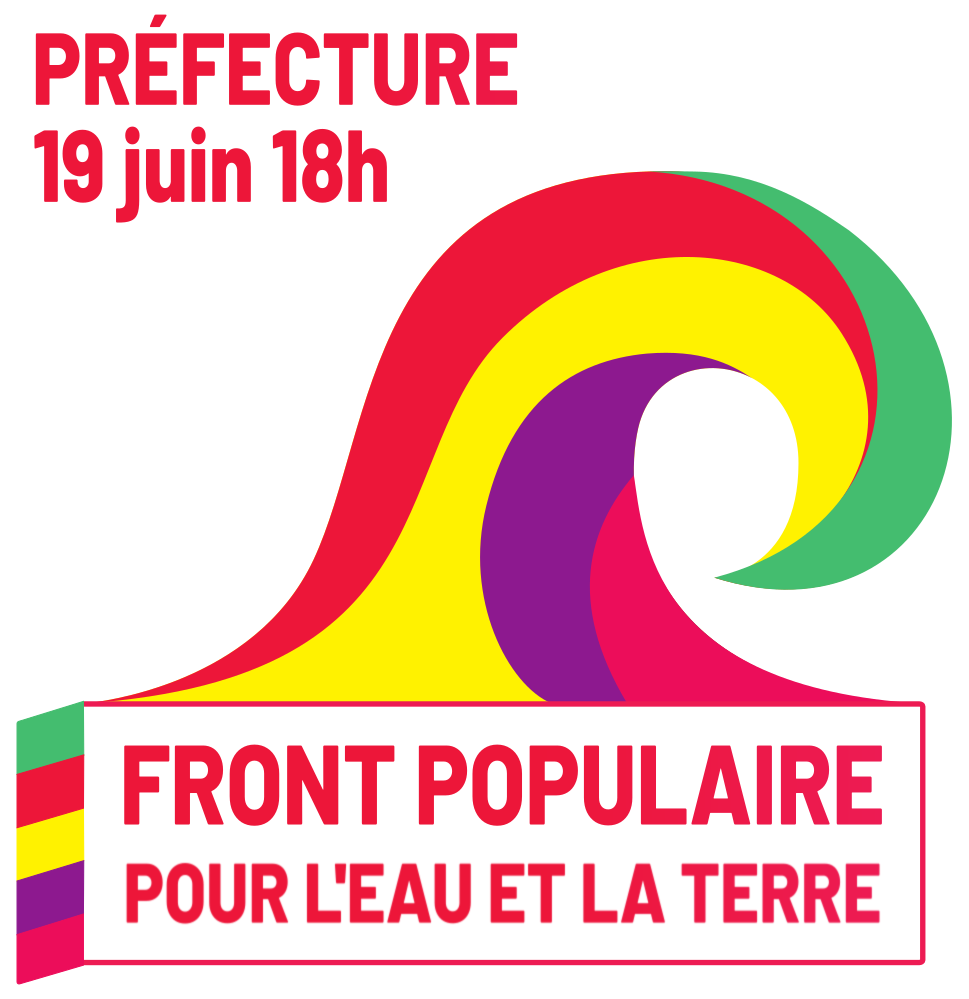
Les grandes banques françaises sont les principaux soutiens européens à la croissance des énergies fossiles. Que fait le gouvernement pour intervenir et que fait l’Europe ? Rien. Dans le contexte actuel de réchauffement climatique accéléré, il s’agit d’une politique criminelle qui devrait immédiatement être sanctionnée par les pouvoirs publics. Mais le néolibéralisme dominant au gouvernement priorise l’inaction : « laisser faire, laisser aller »…
Par Luc Chemla, AFP
Publié le jeudi 13 avril 2023

Cheminées et tours de refroidissement d’une centrale électrique au charbon libérant de la fumée et de la vapeur en Allemagne. © Getty – Schroptschop
Un rapport publié ce jeudi épingle les banques françaises. « Banking on Climate Chaos », auquel ont participé sept ONG dont Reclaim Finance et les Amis de la Terre, fait le constat qu’en 2022 les banques françaises ont été « les principaux soutiens européens à l’expansion des énergies fossiles »
Révéler « la vérité sur les engagements des banques en faveur du climat en examinant leur financement de l’industrie des énergies fossiles. » Voilà l’objectif du rapport annuel « Banking on Climate Chaos », publié ce jeudi et auquel ont participé sept ONG dont Urgewald, ReCommon, Banktrack, les Amis de la Terre France et Reclaim Finance. Ce rapport, le quatorzième du nom, est présenté comme « l’analyse mondiale la plus complète sur les activités bancaires liées aux énergies fossiles ». Les différentes ONG en profitent pour appeler « les banques européennes à cesser de soutenir l’expansion des énergies fossiles afin de préserver une chance de maintenir le réchauffement en dessous de 1,5˚C. »
De ce rapport, il en ressort qu’en 2022 les banques françaises ont été l’an dernier « les principaux soutiens européens à l’expansion des énergies fossiles » via le financement des grandes majors du pétrole et du gaz. Selon le rapport, les neuf premières entreprises pétrolières et gazières américaines et européennes, dont TotalEnergies, BP et Eni, ont reçu collectivement l’an dernier 11,9 milliards de dollars de financement de la part des banques françaises, principalement Crédit Agricole, BNP Paribas et Société Générale.
Mauvaises élèves à l’échelle européenne, les banques françaises restent cependant loin derrière leurs homologues nord-américaines en matière de financement des énergies fossiles, selon ce rapport. Crédit Agricole et BNP Paribas, comme l’italienne Unicredit, ont même augmenté leurs financements auprès de cette industrie en 2022 par rapport à 2021, assurent ces ONG, montants à l’appui. Les calculs portent sur les prêts accordés, mais aussi les émissions d’actions et d’obligations des entreprises du pétrole, du gaz et du charbon.
Selon les conclusions du rapport, « en 2022, les trois premiers soutiens européens des principaux développeurs d’énergies fossiles étaient Crédit Agricole (US$ 6,1 milliards), BNP Paribas (US$ 5,5 milliards) et Société Générale (US$ 3,4 milliards). » « Au niveau global, BNP Paribas est le quatrième plus grand soutien à l’expansion fossile depuis 2016, avec US$ 64,2 milliards de financement aux entreprises développant les énergies fossiles. »
« BNP Paribas apparaît cette année encore comme un leader mondial de l’expansion pétrolière et gazière » pointe dans le rapport Lorette Philippot, chargée de campagne aux Amis de la Terre France. « Malgré des promesses creuses et de nouveaux engagements faibles, la banque ne montre aucune intention de changer de cap et a même augmenté en 2022 son financement des énergies fossiles. » Lorette Philippot ajoute que « BNP Paribas est même un concurrent sérieux des banques nord-américaines dans leurs activités douteuses. Parce que miser sur le chaos climatique est totalement incompatible avec le respect de son devoir de vigilance climatique, BNP Paribas devra désormais en répondre devant la justice. »
Dans une déclaration transmise à France Inter, BNP Paribas réfute ce constat « sur la base d’un rapport dans lequel nous avons constaté de nombreuses erreurs et biais méthodologiques, en particulier sur la comptabilisation des crédits » qui lui sont attribués. La banque ajoute : « sur la base de données précises publiées dans notre Document d’enregistrement universel, la baisse de notre exposition de crédits sur l’exploration-production de pétrole et de gaz est de 12% entre le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2022, et de 15% sur l’exploration-production de pétrole. »
Une autre banque est également épinglé par le rapport, le Crédit Agricole, « dont les principaux clients sont TotalEnergies, Saudi Aramco et Eni, est entré dans le top 10 des banques finançant l’expansion des énergies fossiles en 2022. TotalEnergies, dont les principaux financiers sont les banques françaises Crédit Agricole, BNP Paribas et Société Générale, a plusieurs obligations arrivant à échéance dans les prochains mois qu’elle pourrait renouveler.«
Au-delà des chiffres, cette étude annuelle « montre l’échec des politiques adoptées par les acteurs financiers français« , déplore auprès de l’AFP Lucie Pinson, directrice de l’association Reclaim finance. Une banque française fait cependant exception : la Banque postale. En 2021, elle se présentait comme « la première banque au monde » à s’engager pour une sortie totale des secteurs du pétrole et du gaz d’ici 2030. Les banques françaises ont toutes pris des engagements de neutralité carbone d’ici 2050.
« La lutte contre le changement climatique est une priorité pour les banques françaises, qui mettent en place des politiques ambitieuses pour accompagner une transition socialement responsable, globale et durable« , se défend la Fédération bancaire française (FBF), qui dénonce comme l’an dernier une étude aux chiffres « fantaisistes« . Le 23 février, trois ONG de défense de l’environnement avaient assigné en justice BNP Paribas, première banque européenne, au titre de sa « contribution significative » au réchauffement climatique, à cause de ses clients pétroliers et gaziers.
Publié le 16/11/2023 sur Reporterre le media de l’écologie – La LDH 66 soutient Reporterre
Le glyphosate va être réautorisé pour dix ans à la suite d’un vote de l’UE le 16 novembre. Martin Dermine, de PAN Europe, alerte sur le fait que le pesticide a aussi des conséquences pour les plantes et les animaux.
Actualisation : le 16/11/23. Le glyphosate va être réautorisé pour dix ans par l’Union européenne.
Place au deuxième round. Le 16 novembre, les États membres de l’Union européenne s’apprêtent à voter une nouvelle fois sur la question du glyphosate. Objectif : approuver, ou non, la proposition de la Commission visant à autoriser la substance active pendant les dix prochaines années.
Le 13 octobre, le premier vote s’était soldé par l’absence de majorité qualifiée en faveur de l’adoption du texte. La France et l’Allemagne avaient d’ailleurs décidé de s’abstenir : « Sauf grande surprise, on s’attend au même résultat aujourd’hui », confie Martin Dermine, directeur de PAN Europe, un réseau d’ONG luttant contre les pesticides.
Or, s’il y a deux votes successifs sans majorité qualifiée, c’est ensuite à la Commission de décider : « Habituellement, elle reste cohérente en adoptant sa propre proposition. » Autrement dit, d’ici début décembre, l’approbation du glyphosate pour dix années supplémentaires pourrait être inscrite au Journal officiel.
Un hypothétique dénouement jugé dramatique par Martin Dermine, qui détaille dans cet entretien les dangers du glyphosate sur la biodiversité.
Reporterre — Peut-on affirmer avec certitude que le glyphosate est dangereux pour la biodiversité ?
Martin Dermine — Non. Le glyphosate, en tant que substance active, n’est pas très toxique pour l’environnement. En revanche, dès lors qu’il est associé à des coformulants pour créer des herbicides comme le Roundup, il devient tout de suite extrêmement nocif.
Des expériences sur les grenouilles l’ont démontré. En pulvérisant sur des spécimens les doses autorisées dans les champs, comme un tracteur pourrait le faire, un très haut taux de mortalité était observé. Non pas à cause du simple glyphosate, mais de tous les coformulants auxquels il est mélangé.
Cette problématique est parfaitement documentée, d’un point de vue scientifique. Pourtant, les agences réglementaires européennes et nationales continuent de fermer les yeux. Elles savent pertinemment que le jour où ces mélanges dans leur ensemble seront pris en compte, cela ouvrira la boîte de Pandore et mènera à une interdiction massive des pesticides.
Quels sont les êtres vivants les plus affectés par l’herbicide ?
Dans les milieux aquatiques, il perturbe la reproduction des amphibiens, s’attaque aux poissons, au phytoplancton et aux plantes hydrophytes. Et puis, il y a l’impact sur les fleurs. Les personnes âgées de plus 60 ans nous racontent leurs souvenirs d’enfance, avec des champs de céréales remplis de coquelicots et de bleuets. Désormais, nos générations en sont privées, excepté dans certaines cultures biologiques.
« Le glyphosate tue toutes les plantes sans discrimination »
La faute au glyphosate, notamment, qui est un herbicide total et tue donc toutes les plantes sans discrimination. Utilisé massivement, il a mené à la disparition de ces plantes sur les terres agricoles, et en périphérie. Car les pesticides ne restent jamais sur la seule bande de terre où ils ont été épandus. Ils se dissipent jusque dans les zones limitrophes, appauvrissant la diversité des plantes sauvages.
Cela réduit ainsi la disponibilité en hectares et en pollen pour les pollinisateurs et pour les autres insectes. Et par effet ricochet, pour les animaux se nourrissant d’insectes, comme les oiseaux et les amphibiens. Il n’y a pas d’étude en tant que telle disant que le glyphosate entraîne un appauvrissement de la biodiversité. Toutefois, une récente étude du CNRS met en évidence la décimation des populations d’oiseaux dans les zones d’agriculture intensive, au cours des dernières décennies.
Par quels mécanismes le glyphosate nuit-il aux plantes ?
Le glyphosate est enregistré en tant qu’herbicide, mais aussi en tant qu’antibiotique. C’est-à-dire qu’il est capable d’empêcher la croissance de certains microorganismes. Et les sols en pâtissent : la toxicité a été clairement établie sur le microbiote des sols. Or, celui-ci est fondamental pour la fertilité des sols, et interagit également avec les plantes par les racines pour augmenter la résistance et la santé de celles-ci.
Cela ne s’arrête pas là : le glyphosate est aussi enregistré en tant que chélateur de métaux. Cela signifie que la molécule se lie aux éléments minéraux métalliques, comme le cuivre ou le manganèse, et les rend indisponibles biologiquement. Elle empêche les plantes de les prélever dans le sol.
Alors certes, le cuivre est toxique pour les mammifères à haute dose, mais on en a quand même besoin en très faible quantité. Et les plantes, également, pour leur immunité. Sa présence en tant que résidus dans les sols va ainsi mener à un appauvrissement des plantes, et un affaiblissement de leur système immunitaire. Sans parler de la perte de valeur nutritive des aliments, puisque les fruits et les légumes sont privés des micronutriments.
