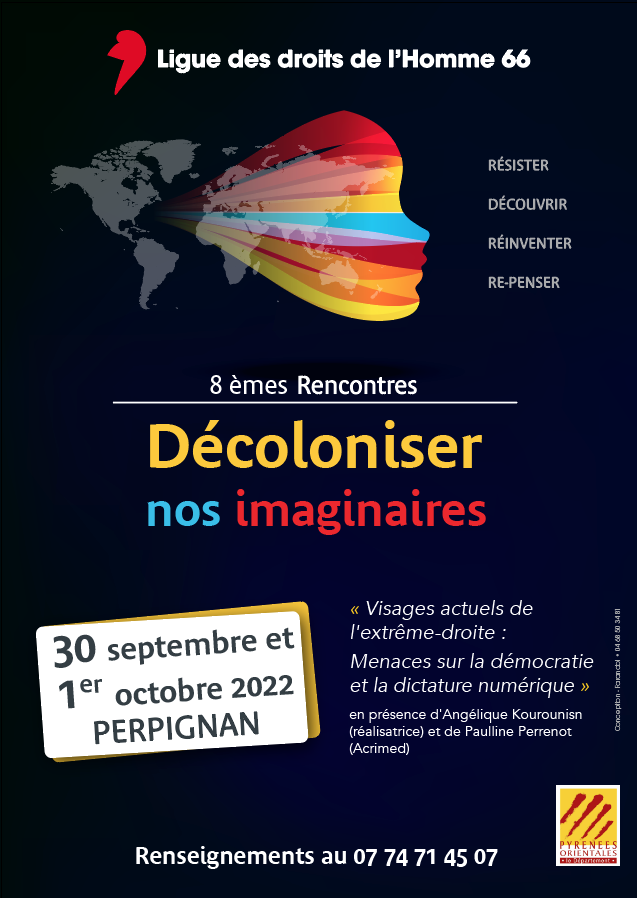
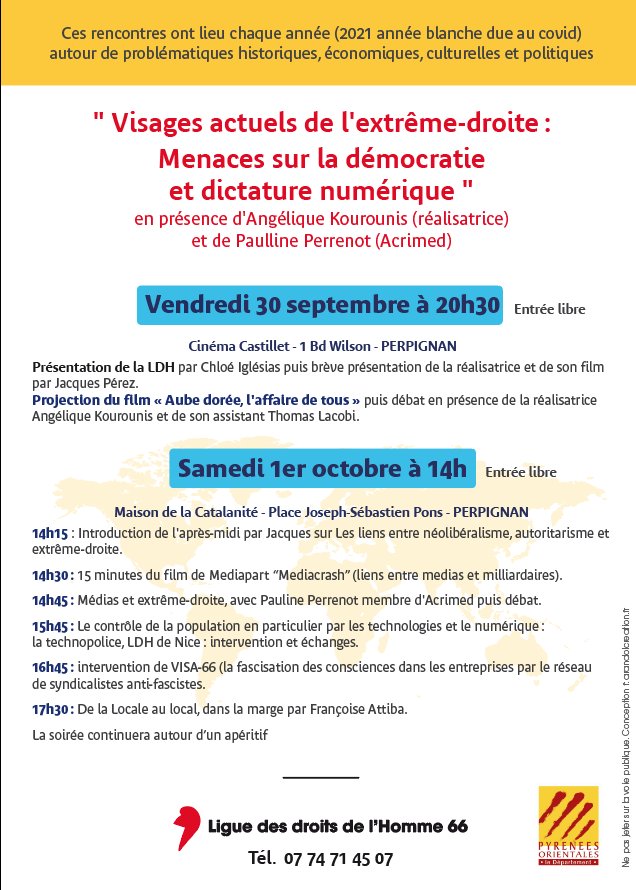
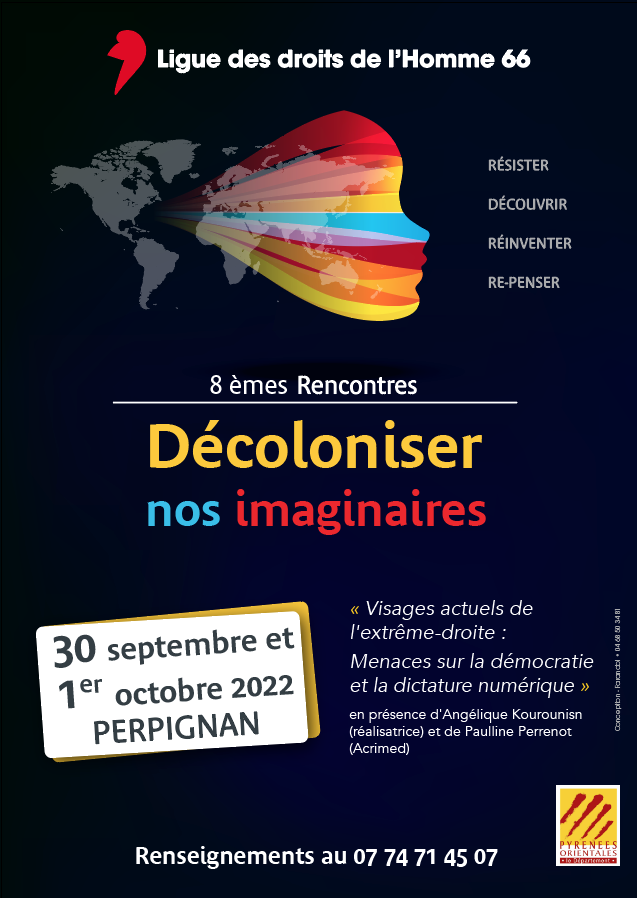
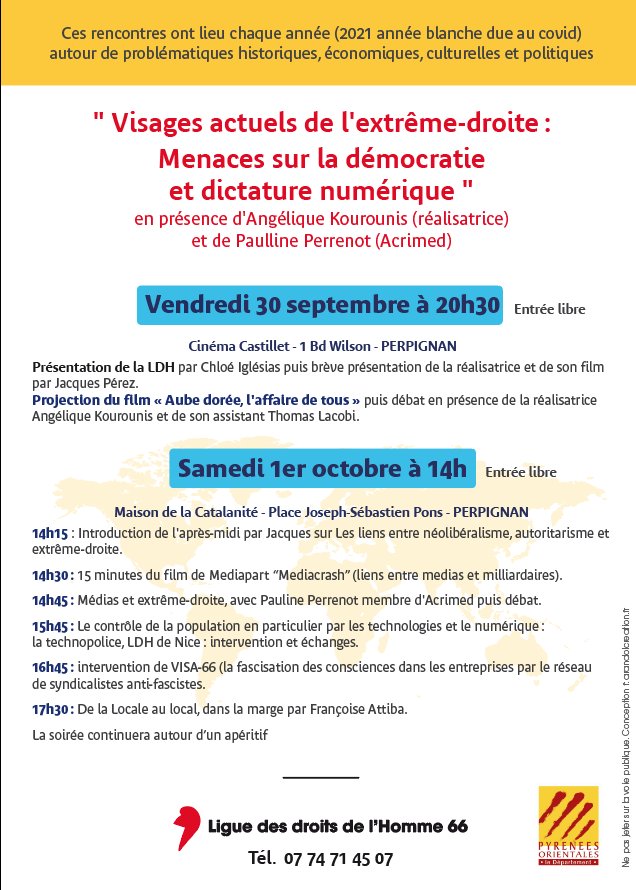
Alors que le projet de loi sur les « séparatismes » revient en dernière lecture au Parlement, plus de cinquante représentants d’associations s’inquiètent, dans une tribune au « Monde », à l’initiative du Mouvement associatif, de la « méfiance » du politique à l’égard de leurs organisations.
Publié sur lemonde.fr le 30 juin 2021
Tribune collective signée par Malik Salemkour, président de la LDH
Alors que le projet de loi sur les « séparatismes » revient en dernière lecture au Parlement, plus de cinquante représentants d’associations s’inquiètent, dont Malik Salemkour, président de la LDH, dans une tribune dans Le Monde, à l’initiative du Mouvement associatif, de la « méfiance » du politique à l’égard de leurs organisations.
La loi relative au contrat d’association dite « loi 1901 » fêtera le 1er juillet, son 120e anniversaire. C’est l’occasion de rappeler à tous combien les associations sont des actrices majeures de la société française. Mais c’est l’occasion de dire aussi combien ce principe de libre association à valeur constitutionnelle, acquis de longue date en France, peut être porteur de renouveau démocratique dès lors que les citoyennes et citoyens s’en saisissent pour défendre des idées, prendre soin des autres et de la nature, ou animer son territoire. Alors que le projet de loi confortant le respect des principes de la République devrait venir encadrer les libertés associatives, quelle ambition politique portons-nous pour les associations ?
Quelque 20 millions de Français et Françaises sont engagés bénévolement dans une ou plusieurs associations. Et 40% sont membres d’une association au moins. Bien que chacun individuellement n’en ait pas toujours conscience, cet engagement est créateur de lien social, de fraternité et de citoyenneté, dans la proximité et au-delà des frontières. Son importance sociétale est cruciale pour notre pays.
S’il en était besoin, la crise sanitaire que nous connaissons témoigne du rôle indispensable des acteurs associatifs au cœur de notre société. L’engagement bénévole est aussi générateur d’épanouissement personnel et collectif. Il rime avec l’envie d’être utile, de donner et de recevoir. Et il contribue à la concorde sociale et au bien-être de chacun comme le montre régulièrement études et sondages ([I]).
L’engagement associatif, à travers le temps et les continents, est également générateur de progrès social. Luttes ouvrières, lutte contre toute exclusion liée à la dépendance, droits des femmes, droits et protection de l’environnement, droits de l’Homme, libertés, éducation et soin pour tous, etc. Nos acquis sociétaux, nous les devons bien souvent à la liberté d’association. Dans un état autoritaire, c’est la première des libertés à être interdite, contrôlée, limitée ou entravée.
En France, il aura fallu plusieurs dizaines d’années et 33 projets, propositions et rapports avant l’adoption de la loi du 1er juillet 1901. Dans un rapport sénatorial en 1882, Jules Simon écrivait : « L’homme est si peu de chose par lui-même, qu’il ne peut faire beaucoup de bien ou beaucoup de mal qu’en s’associant. De là les jugements contradictoires dont l’association est l’objet. Les uns ne croient pas que la société puisse être en sécurité avec elle, et les autres n’admettent pas qu’on puisse se passer d’elle. Nous croyons qu’il n’y a pas d’armure plus solide contre l’oppression, ni d’outil plus merveilleux pour les grandes œuvres, ni de source plus féconde de consolation et de bonheur.“[I]
Où en est la liberté d’association 120 ans après ? Si l’on en croit le projet de loi gouvernemental confortant le respect des principes de la République, dont le Parlement entame actuellement la dernière lecture, les associations font toujours l’objet de méfiance. Le projet de loi vise en effet à instaurer un encadrement et un contrôle des associations dans l’objectif de lutter contre « les séparatismes » parce que – précise le gouvernement – « La République n’a pas suffisamment de moyens d’agir contre ceux qui veulent la déstabiliser ».
Pourtant, le projet de loi fait unanimement l’objet de critiques ; du Haut Conseil à la Vie Associative, au Conseil d’experts sur le droit en matière d’ONG de la conférence des OING du Conseil de l’Europe, à la Commission consultative des droits de l’Homme ou encore à la Défenseure des droits (Claire Hédon). D’une part, le corpus répressif existe déjà pour lutter contre « les associations séparatistes ». D’autre part, le projet de loi risque fort de manquer sa cible : car ce sont les associations de défense et promotion des causes et des droits, essentielles au débat démocratique, qui risquent de pâtir le plus des flous juridiques introduits par le texte.
A l’heure où la question de la participation des citoyen.ne.s au projet républicain se pose très concrètement, n’avons-nous pas plus à perdre à réduire l’espace d’expression civique que représente les associations ? Et au-delà du projet de loi, quelle ambition de société portons-nous pour les associations compte tenu de leur rôle démocratique, social, économique et territorial en France ?
Plus que tous les projets de loi, les associations sont l’expression de la fraternité et de la citoyenneté. Elles sont notre richesse et notre bien commun. C’est pourquoi, cent vingt ans après l’adoption de la loi « 1901 », cinquante ans après sa reconnaissance constitutionnelle et vingt ans après la signature de la première Charte des engagements réciproques, nous affirmons qu’il est nécessaire d’avoir confiance, plus que jamais dans la liberté associative. Comme le soulignait le philosophe Alexis de Tocqueville, « dans les pays démocratiques, la science de l’association est la science mère, le progrès de toutes les autres dépend des progrès de celle-là ».
Paris, le 30 juin 2021
Signataires : Claire Thoury, présidente du Mouvement associatif ; Alexandre Bailly, administrateur référent, Réseau national des maisons des associations ; Loris Birkenmeyer, président d’Animafac ; Marie-Andrée Blanc, présidente de l’Unaf ; François Bouchon, président de France Bénévolat ; Philippe Boulogne, président de Frene ; Olivier Bruyeron, président de Coordination Sud ; Stéphane Daeschner, président de l’Association prévention routière ; Michèle Demessine, présidente de l’Unat ; Anne-Claire Devoge, vice-présidente du Cnajep ; Brigitte Giraud, présidente du Celavar ; Dominique Marmier, président de Familles rurales ; Marie-Claire Martel, présidente de la Cofac ; Benoît Miribel, président du Centre français des fonds et fondations ; Nils Pedersen, président de La Fonda ; David Romieu, président du Réseau national des ressourceries ; Gilles Rouby, président du Collectif des associations citoyennes ; Malik Salemkour, président de la Ligue des droits de l’Homme ; Arnaud Schwartz, président de France Nature Environnement ; Pierre Siquier, président de France Générosités ; Marielle Thuau, présidente de Citoyens & Justice ; Jerome Voiturier, directeur général de l’Uniopss ; Michèle Zwang-Graillot, présidente de la Ligue de l’enseignement ; La Coalition pour les libertés associatives.
Paris, le 30 juin 2021
Depuis janvier les étudiants de la célèbre université du Bosphore à Istanbul refusent la nomination par Erdogan d’un recteur membre de son parti. Jusqu’à aujourd’hui le recteurs étaient élus. Cette contestation soutenue de plus en plus par la population est une épine insupportable au pouvoir de l’autocrate Erdogan qui n’a d’autre réponse que de taxer le mouvement étudiant de « terroriste ». Nous soutenons le mouvement de la jeunesse turque pour les droits et libertés démocratiques et contre la répression.
La jeunesse turque fait trembler Erdogan
Publié dans TDG La Tribune de Genève le 17 février 2021
Le campus de l’université Bogazici d’Istanbul, l’une des meilleurs de Turquie, a des allures de camp retranché depuis plusieurs semaines. Barricades érigées le long des rues attenantes, policiers en patrouille à la sortie du métro, canons à eau et bus d’unités antiémeutes sont massés dans le quartier. La nomination d’un nouveau recteur par le président Erdogan devait faire rentrer dans le rang cette forteresse libérale qui échappait encore à son contrôle. Elle a au contraire déclenché un mouvement universitaire d’une ampleur inédite.

«Nous savions que notre combat serait long, mais nous n’imaginions pas qu’il prendrait ces proportions», s’étonne encore Mehmet Altundag, étudiant en science politique et sociologie. L’université a pour tradition d’élire son recteur parmi son corps professoral. Une coutume violemment remise en cause par la nomination le 1er janvier de Melih Bulu, un homme d’affaires ayant pour seule référence une loyauté sans faille au Parti présidentiel de la Justice et Développement (AKP).
La mobilisation universitaire a pris des proportions nationales début février après la répression violente de plusieurs manifestations. Par ailleurs, l’exposition par des étudiants d’une œuvre représentant la Kaaba, le saint des saints de l’islam, orné d’un drapeau LGBT a déclenché la fureur du pouvoir. Le président Erdogan s’est enflammé, qualifiant les manifestants de «terroristes» et «vandales». «Ce pays ne sera pas un pays où les terroristes gagnent, nous ne l’accepterons jamais… La Turquie ne revivra pas les événements de Taksim Gezi», allusion au mouvement qui a fait vaciller son pouvoir en 2013. S’en est suivi un déferlement de propos homophobes et outranciers de plusieurs caciques du pouvoir.

Depuis, le mouvement sert de réceptacle aux colères et frustrations de larges pans de la population. «Nous recevons beaucoup de messages de soutien», explique Mehmet Altundag. D’après une enquête de l’institut MetroPoll publiée début février, 73% des personnes interrogées considèrent que les recteurs devraient être élus. «Le pouvoir nous traite de terroristes parce qu’il n’a rien à opposer à nos demandes: démocratie et méritocratie», explique l’étudiant.
«On peut déjà parler d’un succès du mouvement. Le problème n’est plus le problème des étudiants de Bogazici mais celui du gouvernement», analyse ainsi Rusen Cakir, journaliste du média Medyascope. «Le gouvernement aura utilisé tous les instruments à sa disposition: les journaux, la police, la justice, les accusations de terrorisme et finalement ça n’a pas réussi à atteindre les étudiants de Bogazici», ajoute-t-il.
Si la «bataille de Bogazici» suscite autant de passion, c’est que cette université est un concentré de symboles. Pour le régime qui tente vaille que vaille d’imposer au pays sa révolution conservatrice, cette institution incarne l’élite laïque qui a longtemps discriminé les islamistes. Les étudiants, eux, balaient les accusations d’élitisme et soulignent la diversité de leurs origines. «Je suis le premier de ma famille à faire des études», insiste Mehmet Altundag.
Fait déconcertant pour les autorités, adeptes de la polarisation à outrance, des étudiants musulmans font partie du mouvement. Ils ont exprimé leur désapprobation vis-à-vis de la peinture de la Kaaba mais ils demandent toujours la démission de Melih Bulu.
Ce mouvement témoigne ainsi de l’émergence de la génération dite Z comme objet politique en Turquie. Les étudiants de Bogazici n’ont jamais connu qu’Erdogan comme dirigeant. Celui-ci a d’ailleurs admis que son parti avait du mal à s’adresser aux jeunes, frappés de plein fouet par la crise économique mais également moins arc-boutés que leurs aînés sur le clivage religieux versus laïcards. «Nous sommes dépités par l’état de notre pays. Nous ne nous y sentons plus acceptés. C’est une accumulation de désillusions», explique Mehmet Altinda, qui se désole que les autorités ne répondent aux demandes de sa génération que par «la polarisation et les politiques identitaires.»